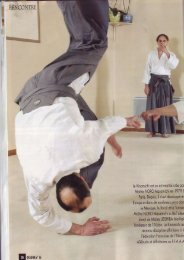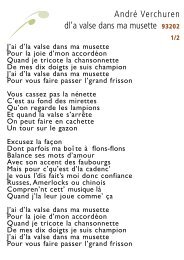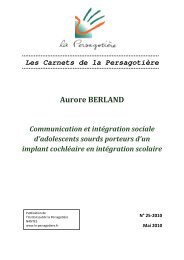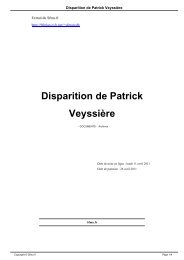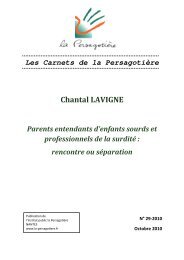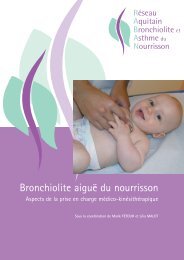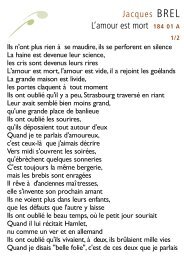You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
168<br />
CONFÉRENCE<br />
<strong>de</strong> Chapelain (XVII e siècle, cité par Ch. A. Beall, La fortune du Tasse <strong>en</strong><br />
Fran<strong>ce</strong>): l’aménité <strong>de</strong>s inv<strong>en</strong>tions extravagantes [du Tasse]… qui avai<strong>en</strong>t<br />
accoutumé le mon<strong>de</strong> à leur air. Ce qui reste <strong>de</strong> <strong>ce</strong>tte signification se<br />
retrouve, peut-être, dans l’expression l’air du temps* (ital. l’aria <strong>de</strong>l<br />
tempo) — à partir <strong>de</strong> laquelle fut fabriqué sans aucun doute le mo<strong>de</strong>rne<br />
et sophistiqué l’air du mois*. Cette expression, employée <strong>en</strong> tête <strong>de</strong> section<br />
<strong>de</strong> la Nouvelle Revue Française, fut introduite <strong>en</strong> 1933 à une époque<br />
où les affaires europé<strong>en</strong>nes franchissai<strong>en</strong>t un dangereux palier <strong>de</strong><br />
confusion et d’in<strong>ce</strong>rtitu<strong>de</strong> — dans lequel il était <strong>de</strong> plus <strong>en</strong> plus difficile<br />
<strong>de</strong> distinguer un « caractère dominant »*. Dès lors, l’expression l’air<br />
du mois* semblerait être une création ironique <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> critiques<br />
subtils qui cherchai<strong>en</strong>t à capter l’ess<strong>en</strong><strong>ce</strong> si vaporeuse <strong>de</strong> l’histoire<br />
d’un mois. — Air <strong>de</strong> cour*, <strong>en</strong> revanche, <strong>en</strong> référ<strong>en</strong><strong>ce</strong> à une atmosphère<br />
spirituelle, n’indiquait pas seulem<strong>en</strong>t un « caractère dominant »* :<br />
c’était aussi une expression <strong>de</strong>scriptive — <strong>de</strong>scriptive <strong>de</strong>s appar<strong>en</strong><strong>ce</strong>s.<br />
Ainsi, air pouvait signifier non seulem<strong>en</strong>t « ess<strong>en</strong><strong>ce</strong>, fond ess<strong>en</strong>tiel<br />
[gist] » (comme dans les exemples <strong>de</strong> Huguet) mais aussi « manière,<br />
appar<strong>en</strong><strong>ce</strong> ». Indubitablem<strong>en</strong>t, l’air mo<strong>de</strong>rne r<strong>en</strong>ferme <strong>ce</strong>tte signification<br />
(qu’on trouve habituellem<strong>en</strong>t dans l’expression figée avoir l’air<br />
[<strong>de</strong>]*) ; aujourd’hui, le mot est plutôt attribué aux personnes, mais il<br />
s’ét<strong>en</strong>dait auparavant aux choses ; on lit dans Montaigne : « C’est une<br />
ladrerie spirituelle qui a quelque air <strong>de</strong> santé » ; et dans Molière : « Vous<br />
<strong>de</strong>vriez un peu vous faire appr<strong>en</strong>dre le bel air <strong>de</strong>s choses » ; « Vos paroles,<br />
le ton <strong>de</strong> votre voix, vos regards, vos pas, votre action et votre ajustem<strong>en</strong>t<br />
ont je ne sais quel air <strong>de</strong> qualité qui <strong>en</strong>chante les g<strong>en</strong>s » (cf. Livet,<br />
Lexique <strong>de</strong> Molière). On peut remarquer que dans le second exemple, air<br />
est associé à la vague expression je ne sais quel (quoi)*, tant à la mo<strong>de</strong> au<br />
temps <strong>de</strong>s « spirituelles » précieuses*. Et <strong>en</strong> effet, Andry <strong>de</strong> Boisregard<br />
(1689), essayant <strong>de</strong> définir notre mot, est obligé d’avoir recours à <strong>ce</strong>tte<br />
expression : « [air =] je ne sais quoi qui paraît <strong>en</strong> un instant, que la nature<br />
donne et qu’on ne peut bi<strong>en</strong> définir » (<strong>ce</strong>tte chose indéfinissable étant<br />
<strong>ce</strong> que La Fontaine a appelé la grâ<strong>ce</strong> plus belle que la beauté* : « …que la<br />
nature donne » = grâ<strong>ce</strong>*). Ainsi, au départ air = « manière »* cont<strong>en</strong>ait<br />
quelque chose <strong>de</strong> l’aspect brumeux <strong>de</strong> l’air lui-même, <strong>de</strong> son intangibilité.<br />
— On doit <strong>ce</strong>p<strong>en</strong>dant noter une autre application intéressante<br />
d’une figure météorologique, laquelle dut jouer un rôle dans l’ultime<br />
évolution <strong>de</strong> air. Elle représ<strong>en</strong>te un con<strong>ce</strong>pt émanant du mysticisme<br />
amoureux du Moy<strong>en</strong> Âge (et <strong>de</strong> la R<strong>en</strong>aissan<strong>ce</strong>), un mysticisme qui<br />
n’excluait pas l’amour physique, quoique divinisant la femme, et<br />
même la femme. Et <strong>en</strong> tant que telle, elle était <strong>en</strong>tourée, d’après les<br />
poètes prov<strong>en</strong>çaux et itali<strong>en</strong>s, d’un halo, d’une « atmosphère », qui per-