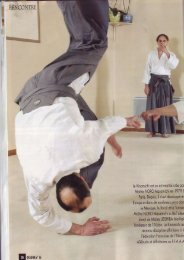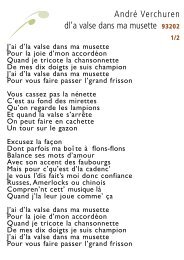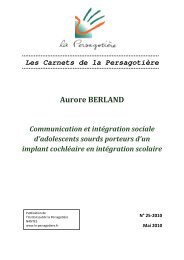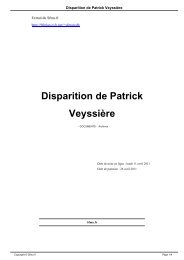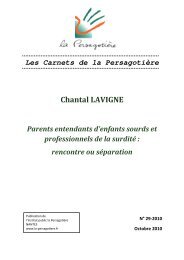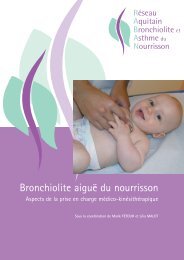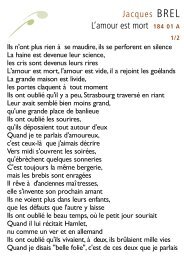You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LEO SPITZER<br />
« circulaire » au Moy<strong>en</strong> Âge, cf. Mo<strong>de</strong>rn Language Notes, LV, p. 995). Ainsi,<br />
un bâtim<strong>en</strong>t ou un moteur réalisé « par compas »* (à l’origine « <strong>de</strong><br />
manière ordonnée ») <strong>en</strong> vint à signifier « [fait] à l’ai<strong>de</strong> d’un compas ».<br />
Cf. <strong>en</strong> anci<strong>en</strong> prov<strong>en</strong>çal garandar « embrasser, r<strong>en</strong>fermer » (= « couvrir »<br />
[<strong>en</strong>compass], à propos du ciel), formé à partir du radical <strong>de</strong> « garantir »<br />
[to guarantee] à partir duquel le substantif garan est dérivé (garan — la<br />
juste mesure : a compas et a guaran) > « limite, <strong>ce</strong>rcle » — le <strong>ce</strong>rcle représ<strong>en</strong>tant<br />
la limite idéale. — Que le Moy<strong>en</strong> Âge ait eu t<strong>en</strong>dan<strong>ce</strong> à voir les<br />
choses à l’intérieur d’un cadre est démontré égalem<strong>en</strong>t par l’évolution<br />
du verbe <strong>de</strong>cliner <strong>en</strong> anci<strong>en</strong> français. Dans le <strong>de</strong>rnier vers très controversé<br />
<strong>de</strong> la Chanson <strong>de</strong> Roland (« Ci falt la geste que Turoldus <strong>de</strong>clinet »),<br />
<strong>ce</strong> verbe apparaît dans le s<strong>en</strong>s <strong>de</strong> « raconter, porter à la connaissan<strong>ce</strong>,<br />
exposer ». H. K. Stone, le comm<strong>en</strong>tateur le plus ré<strong>ce</strong>nt (Mod. Phil.,<br />
XXXIII, pp. 345 ff.), explique à juste titre <strong>ce</strong> s<strong>en</strong>s particulier <strong>de</strong> <strong>de</strong>cliner<br />
comme un usage ét<strong>en</strong>du d’un terme technique <strong>de</strong> grammaire (« décliner<br />
», cf. Fr. décliner son nom, It. <strong>de</strong>clinare il proprio nome), et sa thèse est<br />
étayée par la preuve cont<strong>en</strong>ue dans <strong>ce</strong> passage <strong>en</strong> anci<strong>en</strong> prov<strong>en</strong>çal<br />
(Flam<strong>en</strong>ca) : « Tot jorn recorda e <strong>de</strong>clina E <strong>de</strong>spon sos motz e <strong>de</strong>riva (!) ».<br />
Il n’est pas trop audacieux d’affirmer que l’homo litteratus médiéval (et<br />
<strong>en</strong> particulier le troubadour prov<strong>en</strong>çal) se p<strong>en</strong>sait grammaticus (voir les<br />
traités <strong>de</strong> Scheludko et <strong>de</strong> Curtius). — Mais <strong>ce</strong> qui échappe à M. Stone,<br />
c’est que l’idée profon<strong>de</strong> <strong>de</strong> raconter une histoire était p<strong>en</strong>sée comme<br />
un récit ordonné, progressant <strong>de</strong> son début jusqu’à sa fin, à la manière<br />
<strong>de</strong> la déclinaison d’un paradigme qui inclut et conti<strong>en</strong>t toutes les<br />
formes différ<strong>en</strong>tes d’un mot donné. L’idée d’un cadre général dans<br />
lequel le particulier doit s’insérer, quelle que soit la référ<strong>en</strong><strong>ce</strong>, n’était<br />
jamais abs<strong>en</strong>te <strong>de</strong> l’esprit <strong>de</strong>s poètes médiévaux. Ainsi, un passage tel<br />
que (Sainte-Foi) : « Hanc non fo s<strong>en</strong>z qu’il non.l <strong>de</strong>clin » (« jamais ne fut<br />
s<strong>en</strong>s qu’il [i.e. le livre qui servait <strong>de</strong> modèle au poète] ne l’expose »)<br />
n’est pas une exagération « absur<strong>de</strong> » comme le p<strong>en</strong>se M. Stone. C’est<br />
plutôt une allusion à <strong>ce</strong>tte totalité <strong>de</strong>s significations que tout livre idéal<br />
(parmi lesquels la Bible <strong>en</strong> est l’exemple primordial) doit compr<strong>en</strong>dre.<br />
De même, dans le passage tiré <strong>de</strong> Marcabru : « [avisé est] Cel qui <strong>de</strong><br />
mon chant <strong>de</strong>vina So que chascuns motz <strong>de</strong>clina », les significations <strong>de</strong><br />
chaque mot sont prés<strong>en</strong>tées comme intégrées à une totalité. (Ri<strong>en</strong> n’eût<br />
été plus étranger à la m<strong>en</strong>talité médiévale qu’un con<strong>ce</strong>pt comme <strong>ce</strong>lui<br />
qui sous-t<strong>en</strong>d l’évolution mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong> verbes comme to sketch<br />
[Fr. esquisser, etc.] vers la signification <strong>de</strong> to set forth [exposer].) — Dans<br />
son analyse <strong>de</strong> l’expression <strong>en</strong> A. Fr. chanter mauvaise chançon, parue<br />
dans Rom. Rev., XXXVIII, 241, E. Faral cite un passage <strong>de</strong> la Chanson du<br />
Chevalier au Cygne dans lequel un roi est blâmé pour crime dans les<br />
177