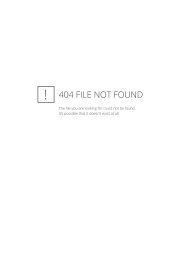La doctrine exprimée au "Grenelle <strong>de</strong> l’environnement"Voici ce qu’on peut lire <strong>dans</strong> le rapport du groupe "Préserver <strong>la</strong> biodiversité <strong>et</strong> <strong>les</strong>ressources naturel<strong>les</strong>" : « L’importance, notamment économique <strong>et</strong> culturelle, <strong>de</strong> <strong>la</strong>biodiversité apparaît <strong>de</strong> plus en plus c<strong>la</strong>irement à tous, au même titre que celle <strong>de</strong> préserverune stabilité climatique minimale. La diversité biologique <strong>et</strong> <strong>les</strong> ressources naturel<strong>les</strong>vivantes, produites par <strong>les</strong> écosystèmes, contribuent directement à plus <strong>de</strong> 40% <strong>de</strong> l’économiemondiale. 70 » C’est une vision très utilitariste <strong>de</strong> <strong>la</strong> biodiversité au service assez exclusif <strong>de</strong>sbesoins humains qui s’exprime ici. Elle rejoint une doctrine <strong>de</strong> <strong>la</strong> conservation exprimée parune frange d’écologues qui soutiennent que <strong>les</strong> « anciennes métho<strong>de</strong>s définissant <strong>les</strong> priorités<strong>de</strong>vraient être abandonnées, au profit d’une approche m<strong>et</strong>tant l’accent <strong>sur</strong> <strong>la</strong> sauvegar<strong>de</strong>d’écosystèmes précieux pour l’homme. » C’est <strong>la</strong> stratégie dite <strong>de</strong>s « services écologiques »qui aboutit à c<strong>et</strong>te conclusion foncièrement égoïste : « Il faut d’abord protéger <strong>les</strong>écosystèmes là où <strong>la</strong> biodiversité offre <strong>de</strong>s services aux personnes qui en ont besoin. »L’impérialisme <strong>de</strong> l’espèce humaine est ainsi remis au goût du jour sous <strong>de</strong>s auspiceshumanitaires. Rien d’étonnant à ce que le mon<strong>de</strong> <strong>de</strong>s affaires manifeste son enthousiasmepour c<strong>et</strong>te approche, comme le confie <strong>les</strong> auteurs 71 !Un préambule intitulé « une vision partagée pour <strong>la</strong> biodiversité », donné en annexe dumême rapport, reflète bien <strong>de</strong>s contradictions.« La conservation <strong>de</strong> <strong>la</strong> biodiversité ne peut ainsi plus se réduire à <strong>la</strong> <strong>protection</strong> <strong>de</strong>sespèces sauvages <strong>dans</strong> <strong>de</strong>s réserves naturel<strong>les</strong>. Elle doit sauvegar<strong>de</strong>r <strong>les</strong> grands écosystèmes<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>nète appréhendés comme <strong>la</strong> base <strong>et</strong> le support <strong>de</strong> notre développement. "Il ne s’agitdonc plus <strong>de</strong> geler une nature sauvage, maintenue <strong>dans</strong> son état primitif, à l’abri <strong>de</strong>sinterventions humaines. Au contraire, il faut préserver <strong>la</strong> capacité évolutive <strong>de</strong>s processusécologiques. Ce<strong>la</strong> implique d’harmoniser <strong>la</strong> préservation <strong>de</strong>s réserves naturel<strong>les</strong> avec <strong>les</strong>zones exploitées par l’homme, <strong>dans</strong> une gestion variée du territoire. Dans une telleconception, l’homme n’est pas extérieur à <strong>la</strong> nature, il en fait partie, il est membre actif d’unenature à <strong>la</strong>quelle il peut faire du bien, s’il se conduit <strong>de</strong> manière avisée, s’il en fait bon usage.C’est l’idée même <strong>de</strong> développement durable : il ne s’agit pas d’étendre <strong>la</strong> logique <strong>de</strong>production à l’environnement, mais au contraire <strong>de</strong> comprendre que nos activitéséconomiques sont incluses <strong>dans</strong> notre environnement naturel. 72 " Ceci est d’autant plus vrai enFrance où tous <strong>les</strong> paysages, réputés naturels ou non, sont le fruit d’une coévolution du travail<strong>de</strong> <strong>la</strong> nature <strong>et</strong> <strong>de</strong> l’homme.L’homme a divorcé <strong>de</strong>puis longtemps <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature : il doit maintenant se réconcilieravec elle, <strong>dans</strong> le cadre d’un progrès <strong>et</strong> d’un développement rénovés. Il faut sauver l’homme<strong>et</strong> <strong>la</strong> nature ensemble. Il nous faut signer un nouveau pacte avec <strong>la</strong> diversité du vivant. (…) I<strong>les</strong>t urgent d’agir : nous sommes sans doute <strong>la</strong> <strong>de</strong>rnière génération à pouvoir maintenir encore<strong>la</strong> majeure partie <strong>de</strong> <strong>la</strong> diversité biologique, mais, compte tenu du rythme d’érosion, nousn’avons que peu d’années pour inverser <strong>la</strong> tendance. »La première contradiction est <strong>de</strong> reconnaître le divorce <strong>de</strong> l’homme <strong>et</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature, <strong>et</strong> <strong>de</strong>poser <strong>les</strong> grands écosystèmes comme base <strong>et</strong> support <strong>de</strong> notre développement. Nous estimons70 Introduction, page 9.71 P<strong>et</strong>er Kareiva, directeur scientifique <strong>de</strong> l’organisation Nature Conservancy <strong>et</strong> Michelle Marvier, professeur àl’Université <strong>de</strong> Santa C<strong>la</strong>ra (Californie), directrice <strong>de</strong> l’Institut <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s environnementa<strong>les</strong>, « Repenserl’écologie », Pour <strong>la</strong> Science, février 2008.72 C<strong>et</strong>te phrase est empruntée à Catherine Larrère <strong>et</strong> Raphaël Larrère, Du bon usage <strong>de</strong> <strong>la</strong> nature, Pour unephilosophie <strong>de</strong> l’environnement, Aubier, 1997.54
<strong>de</strong> notre côté que le divorce évoqué trouve sa raison <strong>dans</strong> c<strong>et</strong>te volonté <strong>de</strong> l’homme <strong>de</strong> faire <strong>de</strong><strong>la</strong> nature le support exclusif <strong>de</strong> sa civilisation. Les écosystèmes sont aussi <strong>la</strong> base <strong>et</strong> le supportdu développement <strong>de</strong> toutes <strong>les</strong> autres formes <strong>de</strong> vie.La secon<strong>de</strong> est contenue <strong>dans</strong> <strong>la</strong> phrase <strong>de</strong> C. Larrère, agrégée <strong>de</strong> philosophie, <strong>et</strong> R.Larrère, ingénieur agronome, tous <strong>de</strong>ux travail<strong>la</strong>nt <strong>sur</strong> <strong>de</strong>s thèmes environnementaux. Elleprésente <strong>la</strong> nature sauvage préservée <strong>de</strong>s interventions humaines comme non dynamique,alors que c’est justement parce que <strong>les</strong> hommes <strong>la</strong>issent quelques territoires sans y toucherque <strong>les</strong> processus écologiques se développent librement.Bref, il n’est pas aisé d’y voir c<strong>la</strong>ir, comme si ce préambule avait été une confection <strong>de</strong>pièces <strong>de</strong>s uns <strong>et</strong> <strong>de</strong>s autres en fonction <strong>de</strong> leurs sensibilités. Encore l’auberge espagnole enquelque sorte. Si nous relevons qu’on défend avec raison <strong>la</strong> biodiversité banale, que neprotègent ni <strong>les</strong> parcs nationaux, ni <strong>les</strong> réserves naturel<strong>les</strong>, une évi<strong>de</strong>nce c<strong>la</strong>mée <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>slustres par <strong>les</strong> associations <strong>dans</strong> l’indifférence générale, nous nous inquiétons que l’État parie<strong>sur</strong> le milieu agricole qui <strong>de</strong>vrait mener une « révolution doublement verte » vers uneagriculture productive <strong>et</strong> écologique. On a connu <strong>la</strong> « révolution culturelle » chinoise, <strong>la</strong>« marche verte » marocaine, autant <strong>de</strong> concepts qui collent aux idéologies du temps toujoursnéfastes à <strong>la</strong> nature.Quant à <strong>la</strong> forêt, milieu privilégié <strong>de</strong> l’ours, il est question <strong>de</strong> protéger sa biodiversité <strong>et</strong><strong>de</strong> dynamiser <strong>la</strong> filière bois. « Dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> lutte contre l’eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> serre <strong>et</strong> <strong>la</strong> recherched’alternatives aux énergies fossi<strong>les</strong>, <strong>la</strong> forêt <strong>et</strong> le bois offrent <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s opportunités par leurcapacité à stocker le CO2. Le bois issu <strong>de</strong> nos forêts est un matériau mo<strong>de</strong>rne, renouve<strong>la</strong>ble <strong>et</strong>recyc<strong>la</strong>ble, qui répond parfaitement aux nouveaux enjeux <strong>de</strong> notre société en matière <strong>de</strong>développement durable. »Ce préambule strictement utilitariste étant posé, le rapport préconise une « gestionforestière durable <strong>et</strong> multifonctionnelle, qui perm<strong>et</strong>te à <strong>la</strong> fois <strong>de</strong> préserver <strong>la</strong> fonctionnalité<strong>de</strong>s écosystèmes forestiers <strong>et</strong> maintenir <strong>la</strong> ressource tout en l’exploitant ». C’est ainsi qu’onpeut lire c<strong>et</strong>te phrase stupéfiante : « L’ensemble du groupe s’accor<strong>de</strong> aisément pourencourager une production accrue du bois dès lors qu’elle perm<strong>et</strong> mieux <strong>de</strong> préserver <strong>la</strong>biodiversité <strong>et</strong> qu’elle favorise <strong>les</strong> services environnementaux. » Voilà au fond <strong>la</strong> poursuite <strong>de</strong><strong>la</strong> doctrine actuelle, reverdie au goût du jour, qui rend <strong>la</strong> France si pauvre en forêts dignes <strong>de</strong>ce nom <strong>et</strong> qui explique pourquoi en 2008 on peut encore écrire que <strong>la</strong> forêt primitive estimpénétrable.La biodiversité associée au pastoralisme <strong>dans</strong> le « P<strong>la</strong>n <strong>de</strong> restauration <strong>et</strong> <strong>de</strong>conservation <strong>de</strong> l’ours brun <strong>dans</strong> <strong>les</strong> Pyrénées françaises 2006-2009 »À l’occasion <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>scente du troupeau <strong>de</strong> brebis du lycée <strong>de</strong> Soeix (Oloron-Sainte-Marie), le préf<strong>et</strong> <strong>de</strong>s Pyrénées-At<strong>la</strong>ntiques déc<strong>la</strong>rait à l’automne 2007 :« Nous avons un discours mondial <strong>sur</strong> <strong>la</strong> biodiversité. Nous <strong>de</strong>vons l’avoir à notreéchelle. Ici, ce sont <strong>les</strong> acteurs du territoire qui ont fabriqué c<strong>et</strong>te biodiversité. On veut éviterqu’elle ne s’éro<strong>de</strong>. C’est ce que veut dire Natura 2000. 73 »C<strong>et</strong>te défense idéologique du pastoralisme, que le réseau Natura 2000, détourné <strong>de</strong> savocation initiale, élève au rang <strong>de</strong> fabricant <strong>de</strong> biodiversité imprègne le "P<strong>la</strong>n Ours". À <strong>la</strong>page 24, mais <strong>sur</strong>tout aux pages 78 <strong>et</strong> 79, le P<strong>la</strong>n abor<strong>de</strong> <strong>la</strong> question <strong>de</strong> <strong>la</strong> biodiversité <strong>et</strong> dupastoralisme. Ecrire que : « Sous nos <strong>la</strong>titu<strong>de</strong>s, le nombre d’espèces est généralement plus73 La République <strong>de</strong>s Pyrénées, 18 septembre 2007.55
- Page 1 and 2:
Rapport de Stéphan Carbonnaux comm
- Page 3 and 4: SOMMAIREI Le sens profond du retour
- Page 5 and 6: LE SENS PROFOND DU RETOUR DE L’OU
- Page 7 and 8: Cliché n° 1. Forêt primaire en S
- Page 9 and 10: Brisons quelques tabous :- la civil
- Page 11 and 12: « Une forêt sans ours n’est pas
- Page 13 and 14: Bouchet, la principale raison de la
- Page 15 and 16: Le Parc ne sait que faire pour prot
- Page 17 and 18: 1978. Publication du rapport L’ou
- Page 19 and 20: 1984. Le "Plan Ours" est lancé par
- Page 21 and 22: Jean Lassalle, conseiller général
- Page 23 and 24: octobre 1992, rende sa décision et
- Page 25 and 26: patrimoniale. Si les associations d
- Page 27 and 28: 27 mai. Une "Marche pour l’ours"
- Page 29 and 30: LA MORT DES DERNIERS OURS DES PYREN
- Page 31 and 32: venir que des Pyrénées (la logiqu
- Page 33 and 34: 1994. En novembre, lors d’une bat
- Page 35 and 36: Cette bonne volonté n’a jamais p
- Page 37 and 38: « réalité depuis des siècles ic
- Page 39 and 40: Une autre conclusion qui a sonné c
- Page 41 and 42: paysans pour tuer les sangliers : e
- Page 43 and 44: le Tiers-Monde) sur ce "Progrès",
- Page 45 and 46: Baylaucq écrivait : « L'ours brun
- Page 47 and 48: "Néré". C’est le retour au clan
- Page 49 and 50: C’est pourquoi, nous préférons
- Page 51 and 52: institution a été très imprudemm
- Page 53: valeur de l’élevage ovin ne peut
- Page 57 and 58: (surtout composée d’aurochs), le
- Page 59 and 60: Les parcs nationaux ne sont pas en
- Page 61 and 62: On aura donc compris que ces groupe
- Page 63 and 64: ce point, se trouver menacés par l
- Page 65 and 66: - Le pastoralisme et la biodiversit
- Page 67 and 68: Cliché n° 4 Cliché n° 5Asturies
- Page 69 and 70: et surtout les femelles deviennent
- Page 71 and 72: diversifiées : cerf, chevreuil, ch
- Page 73 and 74: de terrain, que les observations mo
- Page 75 and 76: cette biodiversité aux oubliettes
- Page 77 and 78: Ferus. En 1996, à Sofia-Antipolis
- Page 79 and 80: enseignements précieux sur ce suje
- Page 81 and 82: Dendaletche dans son Guide du natur
- Page 83 and 84: productiviste qui lui convient mal
- Page 85 and 86: La question des feux courants ou fe
- Page 87 and 88: onces, genêts où seuls les sangli
- Page 89 and 90: L’impact des feux sur la petite f
- Page 91 and 92: - Au moins pour un certain temps, i
- Page 93 and 94: outre que la reconstitution de popu
- Page 95 and 96: diminué, alors qu’entre temps la
- Page 97 and 98: Rappelons que M. Couturier a chass
- Page 99 and 100: Devant le refus de l’Etat de cré
- Page 101 and 102: Voici ce que Jean Lauzet, naturalis
- Page 103 and 104: - En Italie, le Parc national des A
- Page 105 and 106:
-¿De qué manera?De quelle manièr
- Page 107 and 108:
prioritaire au titre de la Directiv
- Page 109 and 110:
France de prendre « les mesures de
- Page 111 and 112:
Le témoignage de M. Didier Hervé
- Page 113 and 114:
L’ESPACE VITAL POUR L’OURS DANS
- Page 115 and 116:
Slovénie, Slovaquie et Suède. Ell
- Page 117 and 118:
2008). Rappelons que personne n’a
- Page 119 and 120:
Depuis quelques années à peine, l
- Page 121 and 122:
loin des sites fréquentés par les
- Page 123 and 124:
Cette région est un grand karst bo
- Page 125 and 126:
apport aux autres ours d’Europe,
- Page 127 and 128:
Aujourd’hui, alors que le "Plan O
- Page 129 and 130:
d’énergie pourrait avoir de fâc
- Page 131 and 132:
place par le F.I.E.P., en Haut-Béa
- Page 133 and 134:
Notons que contrairement à la popu
- Page 135 and 136:
Abruzzes serait à l’origine de l
- Page 137 and 138:
Chose en apparence paradoxale, le r
- Page 139 and 140:
La très grande majorité de nos co
- Page 141 and 142:
Pyrénées, l’ours n’est pas pr
- Page 143 and 144:
POUR UN OURS LIBRE SANS PUCE NI COL
- Page 145:
Mai 2008FERUSBP 11413 718 Allauch C