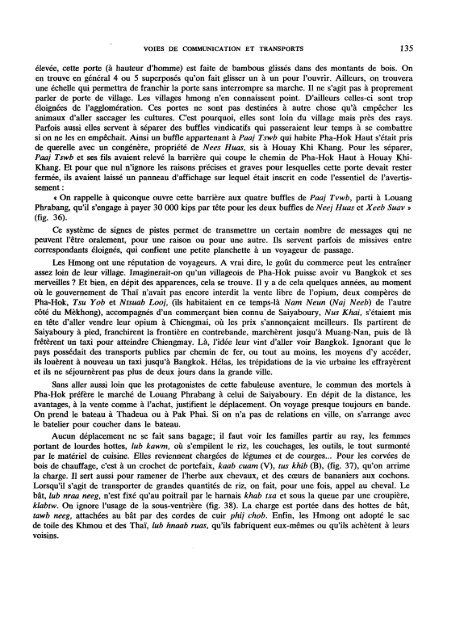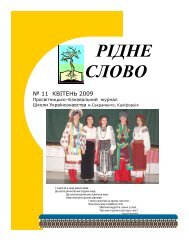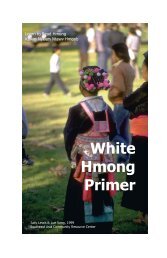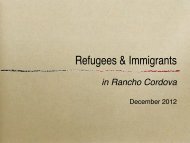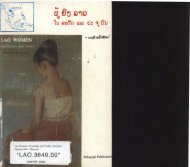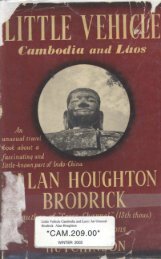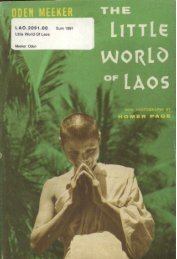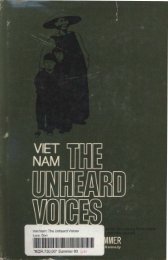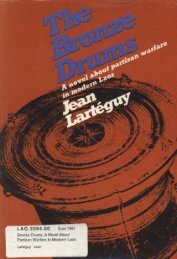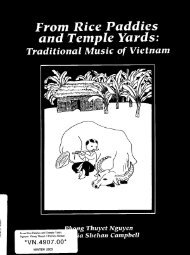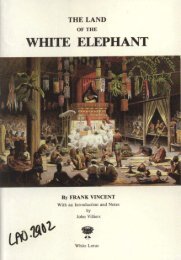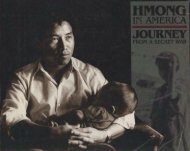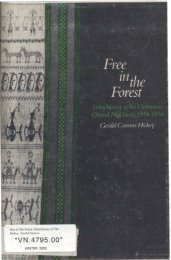un village hmong vert du haut laos
un village hmong vert du haut laos
un village hmong vert du haut laos
- TAGS
- village
- hmong
- vert
- laos
- renincorp.org
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
VOIES DE COMMUNICATION ET TRANSPORTS 135<br />
tlevte, cette porte (2 <strong>haut</strong>eur d'homme) est faite de bambous glissts dans des montants de bois. On<br />
en trouve en gCntral 4 ou 5 superpos6 qu'on fait glisser <strong>un</strong> B <strong>un</strong> pour l'ouvrir. Ailleurs, on trouvera<br />
<strong>un</strong>e Cchelle qui permettra de franchir la porte sans interrompre sa marche. I1 ne s'agit pas B proprement<br />
parler de porte de <strong>village</strong>. Les <strong>village</strong>s <strong>hmong</strong> n'en connaissent point. D'ailleurs celles-ci sont trop<br />
CloignCes de l'agglomkration. Ces portes ne sont pas destintes B autre chose qu'B empkcher les<br />
animaux d'aller saccager les cultures. C'est pourquoi, elles sont loin <strong>du</strong> <strong>village</strong> mais prb des rays.<br />
Parfois aussi elles servent 2 stparer des buffles vindicatifs qui passeraient leur temps B se combattre<br />
si on ne Ies en empkhait. Ainsi <strong>un</strong> buffle appartenant B Paaj Tswb qui habite Pha-Hok Haut s'ttait pris<br />
de querelle avec <strong>un</strong> congtnkre, proprittt de Nees Huas, sis B Houay Khi Khang. Pour les stparer,<br />
Paaj Tswb et ses fils avaient relevt la barrikre qui coupe le chemin de Pha-Hok Haut a Houay Khi-<br />
Khang. Et pour que nu1 n'ignore les raisons prhises et graves pour lesquelles cette porte devait rester<br />
fermk, ils avaient laisst <strong>un</strong> panneau d'affichage sur lequel Ctait inscrit en code l'essentiel de l'a<strong>vert</strong>is-<br />
sement :<br />
a On rappelle B quiconque ouvre cette barrikre aux quatre buffles de Paaj Tvwb, parti B Louang<br />
Phrabang, qu'il s'engage B payer 30 000 kips par tete pour les deux buffles de Neej Huas et Xeeb Suuv B<br />
(fig. 36).<br />
Ce systkme de signes de pistes permet de transmettre <strong>un</strong> certain nombre de messages qui ne<br />
peuvent l'ktre oralement, pour <strong>un</strong>e raison ou pour <strong>un</strong>e autre. 11s servent parfois de missives entre<br />
correspondants 6loignts, qui confient <strong>un</strong>e petite planchette B <strong>un</strong> voyageur de passage.<br />
Les Hmong ont <strong>un</strong>e rkputation de voyageurs. A vrai dire, le goOt <strong>du</strong> commerce peut les entrafner<br />
assez loin de leur <strong>village</strong>. Imaginerait-on qu'<strong>un</strong> <strong>village</strong>ois de Pha-Hok puisse avoir vu Bangkok et ses<br />
merveilles ? Et bien, en dtpit des apparences, cela se trouve. I1 y a de cela quelques anntes, au moment<br />
oii le gouvernement de ThaT n'avait pas encore interdit la vente libre de l'opium, dew compkres de<br />
Pha-Hok, Tsu Yob et Ntsuab Looj, (ils habitaient en ce temps-18 Nam Ne<strong>un</strong> (Naj Neeb) de l'autre<br />
c6tt <strong>du</strong> MSlchong), accompagnCs d'<strong>un</strong> commerGant bien connu de Saiyaboury, Nus Khai, s'ttaient mis<br />
en tkte d'aller vendre leur opium B Chiengmai, oii les prix s'annon~aient meilleurs. 11s partirent de<br />
Saiyaboury B pied, franchirent la frontikre en contrebande, marchkrent jusqu7B Muang-Nan, puis de 18<br />
frkt2rent <strong>un</strong> taxi pour atteindre Chiengmay. LB, I'idte leur vint d'aller voir Bangkok. Ignorant que le<br />
pays posskdait des transports publics par chemin de fer, ou tout au moins, les moyens d'y acctder,<br />
ils louhent B nouveau <strong>un</strong> taxi jusqu'8 Bangkok. Htlas, les tripidations de la vie urbaine les effraytrent<br />
et ils ne stjournkrent pas plus de deux jours dans la grande ville.<br />
Sans aller aussi loin que les protagonistes de cette fabuleuse aventure, le comm<strong>un</strong> des mortels B<br />
Pha-Hok prtf2re le march6 de Louang Phrabang B celui de Saiyaboury. En dtpit de la distance, les<br />
avantages, B la vente comme B l'achat, justifient le dCplacement. On voyage presque toujours en bande.<br />
On prend le bateau B Thadeua ou B Pak Phai. Si on n'a pas de relations en ville, on s'arrange avec<br />
le batelier pour coucher dans le bateau.<br />
Auc<strong>un</strong> dtplacement ne se fait sans bagage; il faut voir les familles partir au ray, les femmes<br />
portant de lourdes hottes, lub kawm, oh s'empilent le riz, les couchages, les outils, le tout surmontt<br />
par le mattriel de cuisine. Elles reviennent chargtes de ltgumes et de courges ... Pour les corvtes de<br />
bois de chauffage, c'est B <strong>un</strong> crochet de portefaix, kaab cuam (V), tus khib (B), (fig. 37), qu'on arrime<br />
la charge. I1 sert aussi pour ramener de l'herbe aux chevaux, et des cmurs de bananiers aux cochons.<br />
Lorsqu'il s'agit de transporter de grandes quantitts de riz, on fait, pour <strong>un</strong>e fois, appel au cheval. Le<br />
bit, lub nraa neeg, n'est fix6 qu'au poitrail par le harnais khab txa et sous la queue par <strong>un</strong>e croupikre,<br />
klabtw. On ignore l'usage de la sous-ventribre (fig. 38). La charge est portte dans des hottes de bst,<br />
tawb neeg, attachCes au b2t par des cordes de cuir phi; chob. Enfin, les Hmong ont adoptt le sac<br />
de toile des Khmou et des Tha'i, lub hnaab mas, qu'ils fabriquent eux-m&rnes ou qu'ils ach2tent B leurs<br />
voisins.