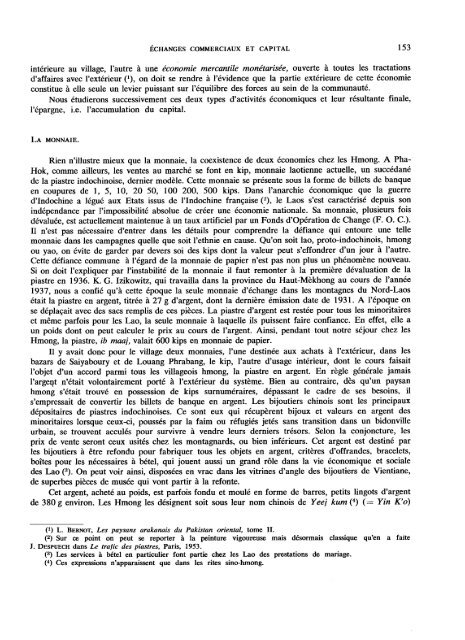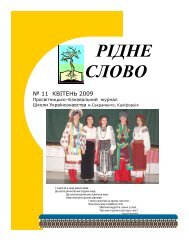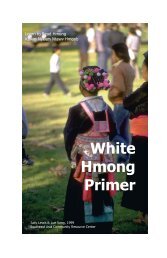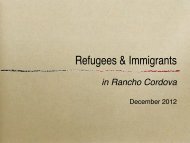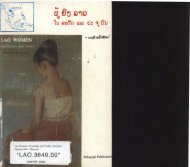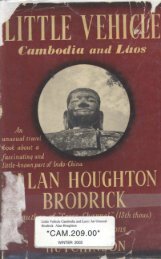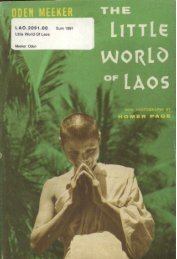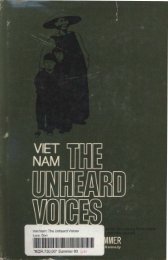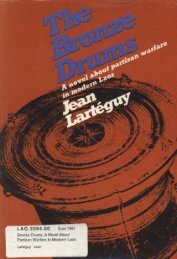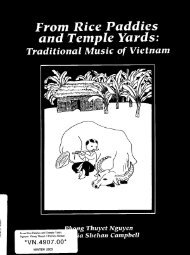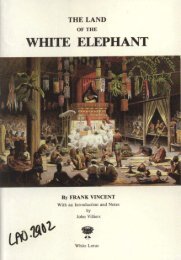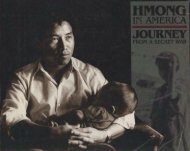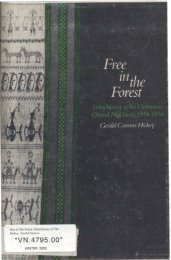un village hmong vert du haut laos
un village hmong vert du haut laos
un village hmong vert du haut laos
- TAGS
- village
- hmong
- vert
- laos
- renincorp.org
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CHANGES COMMERCIAUX ET CAPITAL 153<br />
intirieure au <strong>village</strong>, l'autre B <strong>un</strong>e kconomie mercantile monktariske, ou<strong>vert</strong>e toutes les tractations<br />
d'affaires avec l'exterieur (I), on doit se rendre B l'Cvidence que la partie extirieure de cette Cconomie<br />
constitue B elle seule <strong>un</strong> levier puissant sur l'tquilibre des forces au sein de la comm<strong>un</strong>autt.<br />
Nous Ctudierons successivement ces deux types d'activitis tconomiques et leur rksultante finale,<br />
l'tpargne, i.e. l'accumulation <strong>du</strong> capital.<br />
Rien n'illustre mieux que la monnaie, la coexistence de deux Cconomies chez les Hmong. A Pha-<br />
Hok, comme ailleurs, les ventes au march6 se font en kip, monnaie laotienne actuelle, <strong>un</strong> succCdanC<br />
de la piastre indochinoise, dernier modkle. Cette monnaie se prCsente sous la forme de billets de banque<br />
en coupures de 1, 5, 10, 20 50, 100 200, 500 kips. Dans l'anarchie Cconomique que la guerre<br />
d'Indochine a ItguC aux Etats issus de l'Indochine fran~aise (9, le Laos s'est caracttrist depuis son<br />
indtpendance par I'impossibilitt absolue de crter <strong>un</strong>e Cconomie nationale. Sa monnaie, plusieurs fois<br />
dCvaluCe, est actuellement maintenue B <strong>un</strong> taux artificiel par <strong>un</strong> Fonds d70pCration de Change (F. 0. C.).<br />
I1 n'est pas nCcessaire d'entrer dans les dttails pour comprendre la dCfiance qui entoure <strong>un</strong>e telle<br />
monnaie dans les campagnes quelle que soit l'ethnie en cause. Qu'on soit lao, proto-indochinois, <strong>hmong</strong><br />
ou yao, on Cvite de garder par devers soi des kips dont la valeur peut s'effondrer d'<strong>un</strong> jour B l'autre.<br />
Cette dtfiance comm<strong>un</strong>e B l'Cgard de la monnaie de papier n'est pas non plus <strong>un</strong> phCnomkne nouveau.<br />
Si on doit l'expliquer par I'instabilitC de la monnaie il faut remonter B la premikre dkvaluation de la<br />
piastre en 1936. K. G. Izikowitz, qui travailla dans la province <strong>du</strong> Haut-Mkkhong au cours de l'annCe<br />
1937, nous a confit qu'8 cette Cpoque la seule monnaie d'tchange dans les montagnes <strong>du</strong> Nord-Laos<br />
Ctait la piastre en argent, titrCe B 27 g d'argent, dont la dernikre tmission date de 193 1. A l'tpoque on<br />
se dtpla~ait avec des sacs remplis de ces pikces. La piastre d'argent est restte pour tous les minoritaires<br />
et mCme parfois pour les Lao, la seule monnaie B laquelle ils puissent faire confiance. En effet, elle a<br />
<strong>un</strong> poids dont on peut calculer le prix au cours de I'argent. Ainsi, pendant tout notre stjour chez les<br />
Hmong, la piastre, ih maaj, valait 600 kips en monnaie de papier.<br />
I1 y avait donc pour le <strong>village</strong> deux monnaies, I'<strong>un</strong>e destinke aux achats B l'extkrieur, dans les<br />
bazars de Saiyaboury et de Louang Phrabang, le kip, l'autre d'usage intkrieur, dont le cours faisait<br />
l'objet d'<strong>un</strong> accord parmi tous les <strong>village</strong>ois <strong>hmong</strong>, la piastre en argent. En rkgle gCnCrale jamais<br />
I'argept n7Ctait volontairement port6 B l'extkrieur <strong>du</strong> systkme. Bien au contraire, db qu'<strong>un</strong> paysan<br />
<strong>hmong</strong> s'ttait trouvC en possession de kips surnumtraires, dtpassant le cadre de ses besoins, il<br />
s'empressait de con<strong>vert</strong>ir les billets de banque en argent. Les bijoutiers chinois sont les principaux<br />
dCpositaires de piastres indochinoises. Ce sont eux qui rtcupkrent bijoux et valeurs en argent des<br />
minoritaires lorsque ceux-ci, poussts par la faim ou rCfugiCs jetts sans transition dans <strong>un</strong> bidonville<br />
urbain, se trouvent accults pour survivre B vendre leurs derniers trksors. Selon la conjoncture, les<br />
prix de vente seront ceux usitts chez les montagnards, ou bien infkrieurs. Cet argent est destinC par<br />
les bijoutiers 5 Ctre refon<strong>du</strong> pour fabriquer tous les objets en argent, critkres d'offrandes, bracelets,<br />
boites pour les ntcessaires B bCtel, qui jouent aussi <strong>un</strong> grand r61e dans la vie Cconomique et sociale<br />
des Lao C). On peut voir ainsi, disposCes en vrac dans les vitrines d'angle des bijoutiers de Vientiane,<br />
de superbes pihces de muste qui vont partir B la refonte.<br />
Cet argent, achett au poids, est parfois fon<strong>du</strong> et moulC en forme de barres, petits lingots d'argent<br />
de 380 g environ. Les Hmong les dtsignent soit sous leur nom chinois de Yeej kum (4) (= Yin K'o)<br />
(1) L. BERNOT, Les paysans arakanais <strong>du</strong> Pakistan oriental, tome 11.<br />
(2) Sur ce point on peut se reporter B la peinture vigoureuse mais dtsormais classique qu'en a faite<br />
J. DE~PUECH<br />
dans Le trafic des piastres, Paris, 1953.<br />
(3) Les services B betel en particulier font partie chez les Lao des prestations de mariage.<br />
(9 Ces expressions n'apparaissent que dans les rites sino-hrnong.