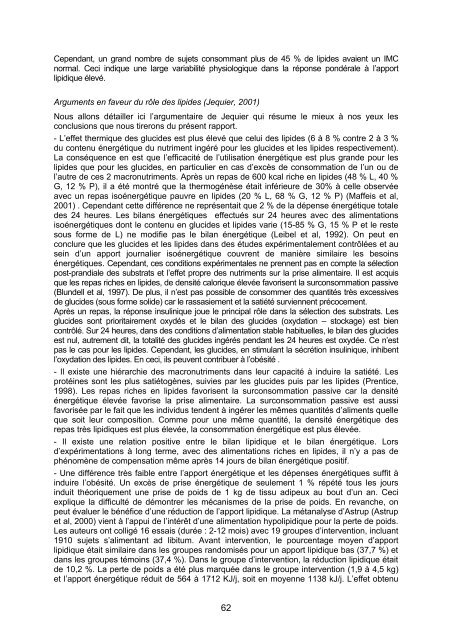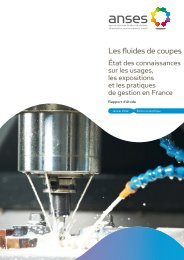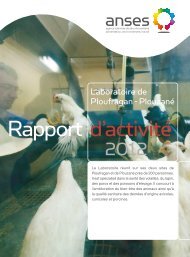Glucides et santé - Anses
Glucides et santé - Anses
Glucides et santé - Anses
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Cependant, un grand nombre de suj<strong>et</strong>s consommant plus de 45 % de lipides avaient un IMC<br />
normal. Ceci indique une large variabilité physiologique dans la réponse pondérale à l’apport<br />
lipidique élevé.<br />
Arguments en faveur du rôle des lipides (Jequier, 2001)<br />
Nous allons détailler ici l’argumentaire de Jequier qui résume le mieux à nos yeux les<br />
conclusions que nous tirerons du présent rapport.<br />
- L’eff<strong>et</strong> thermique des glucides est plus élevé que celui des lipides (6 à 8 % contre 2 à 3 %<br />
du contenu énergétique du nutriment ingéré pour les glucides <strong>et</strong> les lipides respectivement).<br />
La conséquence en est que l’efficacité de l’utilisation énergétique est plus grande pour les<br />
lipides que pour les glucides, en particulier en cas d’excès de consommation de l’un ou de<br />
l’autre de ces 2 macronutriments. Après un repas de 600 kcal riche en lipides (48 % L, 40 %<br />
G, 12 % P), il a été montré que la thermogénèse était inférieure de 30% à celle observée<br />
avec un repas isoénergétique pauvre en lipides (20 % L, 68 % G, 12 % P) (Maffeis <strong>et</strong> al,<br />
2001) . Cependant c<strong>et</strong>te différence ne représentait que 2 % de la dépense énergétique totale<br />
des 24 heures. Les bilans énergétiques effectués sur 24 heures avec des alimentations<br />
isoénergétiques dont le contenu en glucides <strong>et</strong> lipides varie (15-85 % G, 15 % P <strong>et</strong> le reste<br />
sous forme de L) ne modifie pas le bilan énergétique (Leibel <strong>et</strong> al, 1992). On peut en<br />
conclure que les glucides <strong>et</strong> les lipides dans des études expérimentalement contrôlées <strong>et</strong> au<br />
sein d’un apport journalier isoénergétique couvrent de manière similaire les besoins<br />
énergétiques. Cependant, ces conditions expérimentales ne prennent pas en compte la sélection<br />
post-prandiale des substrats <strong>et</strong> l’eff<strong>et</strong> propre des nutriments sur la prise alimentaire. Il est acquis<br />
que les repas riches en lipides, de densité calorique élevée favorisent la surconsommation passive<br />
(Blundell <strong>et</strong> al, 1997). De plus, il n’est pas possible de consommer des quantités très excessives<br />
de glucides (sous forme solide) car le rassasiement <strong>et</strong> la satiété surviennent précocement.<br />
Après un repas, la réponse insulinique joue le principal rôle dans la sélection des substrats. Les<br />
glucides sont prioritairement oxydés <strong>et</strong> le bilan des glucides (oxydation – stockage) est bien<br />
contrôlé. Sur 24 heures, dans des conditions d’alimentation stable habituelles, le bilan des glucides<br />
est nul, autrement dit, la totalité des glucides ingérés pendant les 24 heures est oxydée. Ce n’est<br />
pas le cas pour les lipides. Cependant, les glucides, en stimulant la sécrétion insulinique, inhibent<br />
l’oxydation des lipides. En ceci, ils peuvent contribuer à l’obésité .<br />
- Il existe une hiérarchie des macronutriments dans leur capacité à induire la satiété. Les<br />
protéines sont les plus satiétogènes, suivies par les glucides puis par les lipides (Prentice,<br />
1998). Les repas riches en lipides favorisent la surconsommation passive car la densité<br />
énergétique élevée favorise la prise alimentaire. La surconsommation passive est aussi<br />
favorisée par le fait que les individus tendent à ingérer les mêmes quantités d’aliments quelle<br />
que soit leur composition. Comme pour une même quantité, la densité énergétique des<br />
repas très lipidiques est plus élevée, la consommation énergétique est plus élevée.<br />
- Il existe une relation positive entre le bilan lipidique <strong>et</strong> le bilan énergétique. Lors<br />
d’expérimentations à long terme, avec des alimentations riches en lipides, il n’y a pas de<br />
phénomène de compensation même après 14 jours de bilan énergétique positif.<br />
- Une différence très faible entre l’apport énergétique <strong>et</strong> les dépenses énergétiques suffit à<br />
induire l’obésité. Un excès de prise énergétique de seulement 1 % répété tous les jours<br />
induit théoriquement une prise de poids de 1 kg de tissu adipeux au bout d’un an. Ceci<br />
explique la difficulté de démontrer les mécanismes de la prise de poids. En revanche, on<br />
peut évaluer le bénéfice d’une réduction de l’apport lipidique. La métanalyse d’Astrup (Astrup<br />
<strong>et</strong> al, 2000) vient à l’appui de l’intérêt d’une alimentation hypolipidique pour la perte de poids.<br />
Les auteurs ont colligé 16 essais (durée : 2-12 mois) avec 19 groupes d’intervention, incluant<br />
1910 suj<strong>et</strong>s s’alimentant ad libitum. Avant intervention, le pourcentage moyen d’apport<br />
lipidique était similaire dans les groupes randomisés pour un apport lipidique bas (37,7 %) <strong>et</strong><br />
dans les groupes témoins (37,4 %). Dans le groupe d’intervention, la réduction lipidique était<br />
de 10,2 %. La perte de poids a été plus marquée dans le groupe intervention (1,9 à 4,5 kg)<br />
<strong>et</strong> l’apport énergétique réduit de 564 à 1712 KJ/j, soit en moyenne 1138 kJ/j. L’eff<strong>et</strong> obtenu<br />
62