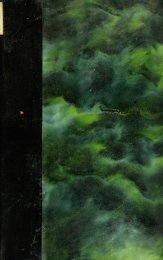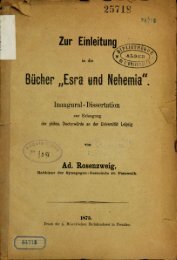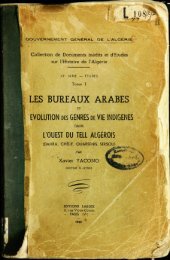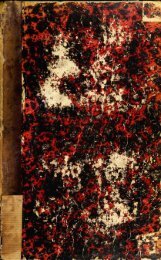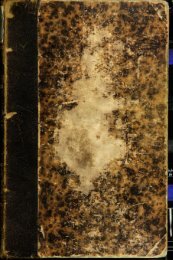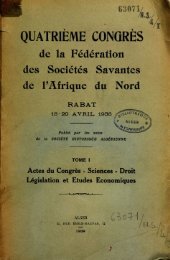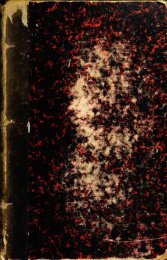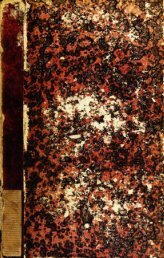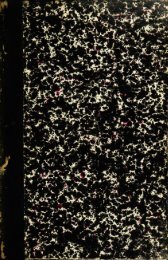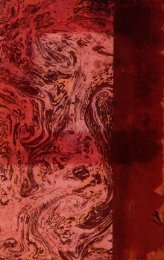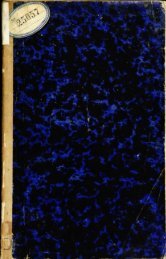1948 T.16 Bis - 2e Série.pdf
1948 T.16 Bis - 2e Série.pdf
1948 T.16 Bis - 2e Série.pdf
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
— — 99<br />
tuant plusieurs retours offensifs et prolongés, destmeTa"cTïsperser com<br />
plètement les assaillants. Nos généraux comprirent vite que les guer<br />
riers kabyles étaient peut-être moins dangereux que les Arabes : dé<br />
pourvus de leur mobilité qui nous avait fait tant de mal pendant les<br />
premières années,<br />
ces montagnards sédentaires étaient plus facile<br />
ment saisissables. Très attachés à leurs biens matériels,<br />
un moyen très<br />
sûr pour obtenir leur soumission (tout au moins momentanée), était<br />
de raser leurs vergers, de brûler leurs maisons, et de leur imposer de<br />
fortes amendes de guerre.<br />
Ces mesures de violence furent complétées par d'autres, plus paci<br />
fiques et plus efficaces : la construction de routes stratégiques, et de<br />
maisons de commandement qui nous permirent d'exercer une surveil<br />
lance directe et constante sur les populations, et par là, nous assurè<br />
rent la pacification définitive de la région.<br />
En 1870, la Kabylie Orientale possédait encore peu de routes ; ce<br />
pendant, de bonnes routes muletières reliaient déjà entre elles les<br />
villes du littoral et de l'intérieur. C'est en 1850, que le colonel de Lour-<br />
mel inaugurait la première route en pays kabyle, en échelonnant plu<br />
sieurs chantiers de travaillj&urs entre Sétif et Bougie. Elle fut conti<br />
nuée au cours des années 1852 et 1853, sous la direction du Général<br />
Maissiat ; les troupes qui y travaillaient servaient en même temps de<br />
corps, d'observation destiné à surveiller les populations de la région,<br />
tandis que Mac-Mahon opéraitj dans la vallée de l'Oued el-Kébir et que<br />
Randon entreprenait, l'année suivante, sa grande expédition dans les<br />
Babors. Quatre caravansérails furent construits, de distance en dis<br />
tance pour servir de gîtes d'étape aux voyageurs. Ce premier tracé pas<br />
sait par Ain Rouia, Dra-el-Arba et les crêtes des Béni Guifsar, pour<br />
aboutir dans la vallée de la Summam jusqu'à Bougie. Les travaux,<br />
suspendus pendant la guerre d'Orient, furent repris en 1856 et conti<br />
nués pendant trois ans consécutifs. Le passage par la tribu des Béni<br />
Guifser, s'étant révélé très difficile, avait été abandonné pour un autre<br />
tracé passant par les Béni Sliman, Barbacha et Béni Mimoun. Mais cette<br />
dernière route elle-même présentait de grands inconvénients : soumise<br />
aux intempéries d'un climat montagnard,<br />
elle était facilement dété<br />
riorée ; d'ailleurs elle manquait absolument de travaux d'art et de<br />
soins permanents. Aussi, dès 1861, l'autorité envisagea-t-elle la possi<br />
bilité de réunir Bougie à Sétif par une autre route empruntant des ré<br />
gions où la neige restait moins longtemps sur le sol. Le capitaine Cap-<br />
depont,<br />
chef de l'annexe de Takitount alla reconnaître les gorges de<br />
Chabet-el-Akhra, et y vit la possibilité d'établir une route aboutissant<br />
directement au littoral du golfe de Bougie pour longer ensuite cette<br />
Ville. Le gouvernement donna suite à ce projet et, le 17 décembre 1861,<br />
le Général Desvaux écrivait : « deux routes importantes ont été mises<br />
a l'étude : ce sont celles de Sétif à Bougie et de Sétif à Alger. Pour la<br />
première de ces routes, les travaux sont commencés. L'ensemble de la<br />
dépense est évalué à 3.800.000 francs. Avec les seules ressources du<br />
budget provincial, il faudra près de dix ans pour achever cette route