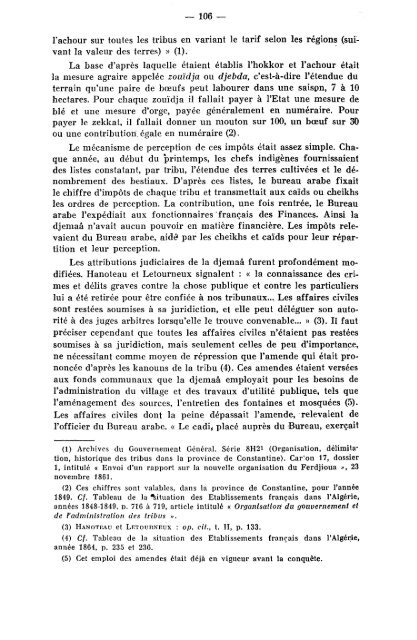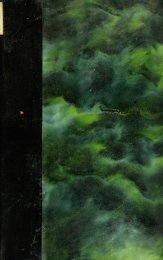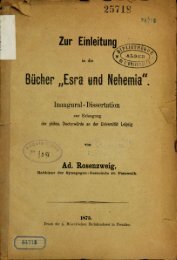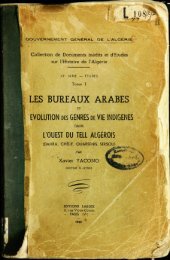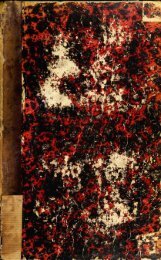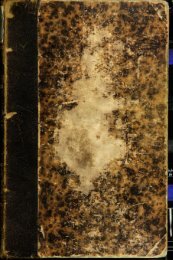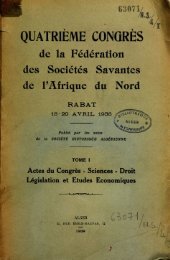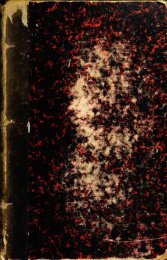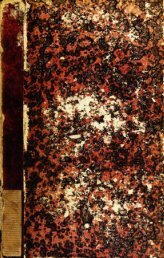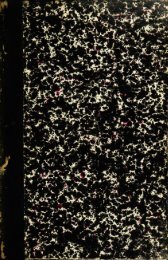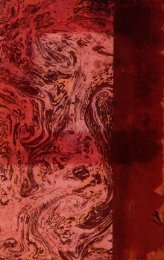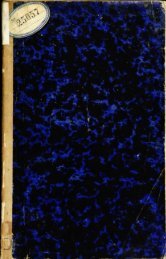1948 T.16 Bis - 2e Série.pdf
1948 T.16 Bis - 2e Série.pdf
1948 T.16 Bis - 2e Série.pdf
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
— — 106<br />
l'achour sur toutes les tribus en variant le tarif selon les régions (sui<br />
vant la valeur des terres)<br />
» (1).<br />
La base d'après laquelle étaient établis l'hokkor et l'achour était<br />
la mesure agraire appelée zouïdja ou djebda,<br />
c'est-à-dire l'étendue du<br />
terrain qu'une paire de bœufs peut labourer dans une saispn, 7 à 10<br />
hectares. Pour chaque zouïdja il fallait payer à l'Etat une mesure de<br />
blé et une mesure d'orge,<br />
payée généralement en numéraire. Pour<br />
payer le zekkat, il fallait donner un mouton sur 100, un bœuf sur 30<br />
ou une contribution, égale en numéraire (2) .<br />
Le mécanisme de perception de ces impôts était assez simple. Cha<br />
que année, au début du printemps, les chefs indigènes fournissaient<br />
des listes constatant, par tribu, l'étendue des terres cultivées et le dé<br />
nombrement des bestiaux. D'après ces listes, le bureau arabe fixait<br />
le chiffre d'impôts de chaque tribu et transmettait aux caïds ou cheikhs<br />
les ordres de perception. La contribution, une fois rentrée, le Bureau<br />
arabe l'expédiait aux fonctionnaires français des Finances. Ainsi la<br />
djemaâ n'avait aucun pouvoir en matière financière. Les impôts rele<br />
vaient du Bureau arabe,<br />
tition et leur perception.<br />
aidé par les cheikhs et caïds pour leur répar<br />
Les attributions judiciaires de la djemaâ furent profondément mo<br />
difiées. Hanoteau et Letourneux signalent : « la connaissance des cri<br />
mes et délits graves contre la chose publique et contre les particuliers<br />
lui a été retirée pour être confiée à nos tribunaux... Les affaires civiles<br />
sont restées soumises à sa juridiction, et elle peut déléguer son auto<br />
rité à des juges arbitres lorsqu'elle le trouve convenable... » (3). Il faut<br />
préciser cependant que toutes les affaires civiles n'étaient pas restées<br />
soumises à sa juridiction, mais seulement celles de peu d'importance,<br />
ne nécessitant comme moyen de répression que l'amende qui était pro<br />
noncée d'après les kanouns de la tribu (4). Ces amendes étaient versées<br />
aux fonds communaux que la djemaâ employait pour les besoins de<br />
l'administration du village et des travaux d'utilité publique, tels que<br />
l'aménagement des sources, l'entretien des fontaines et mosquées (5).<br />
Les affaires civiles dont la peine dépassait l'amende,<br />
relevaient de<br />
l'officier du Bureau arabe. « Le cadi* placé auprès du Bureau, exerçait<br />
(1) Archives du Gouvernement Général. <strong>Série</strong> 8H21 (Organisation, délimita<br />
tion, historique des tribus dans la province de Constantine). Car'on 17, dossier<br />
1, intitulé « Envoi d'un rapport sur la nouvelle organisation du Ferdjioua », 23<br />
novembre 1861.<br />
(2) Ces chiffres sont valables, dans la province de Constantine, pour l'année<br />
1849. Cf. Tableau de la Situation des Etablissements français dans l'Algérie,<br />
années 1848-1849, p. 716 à 719, article intitulé « Organisation' du gouvernement et<br />
de l'administration des tribus ».<br />
(3) Hanoteau et Letourneux : op. cit., t. II, p. 133.<br />
(4) Cf. Tableau de la situation des Etablissements français dans l'Algérie,<br />
année 1864, p. 235 et 236.<br />
(5) Cet emploi des amendes était déjà en vigueur avant la conquête.