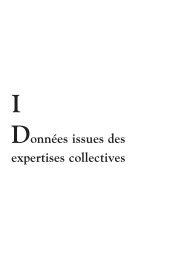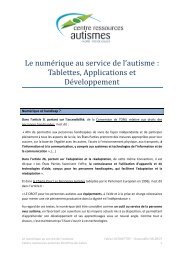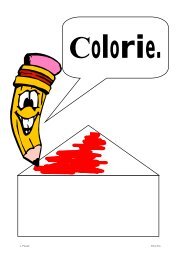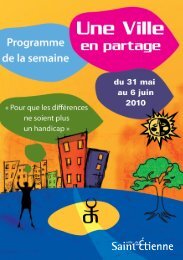Circulaire n° DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide ...
Circulaire n° DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide ...
Circulaire n° DGOS/R5/2011/311 du 1er août 2011 relative au guide ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
pathologies chroniques, associent les représentants des usagers et soient répartis <strong>au</strong> mieux sur<br />
l’ensemble <strong>du</strong> territoire.<br />
Organiser une politique d’aide <strong>au</strong>x aidants et faciliter l’accès à des structures de répit. La mise en œuvre<br />
de façon cohérente et synergique des mesures prévues dans les différents plans de santé publique, doit<br />
permettre d’impulser une véritable politique en la matière.<br />
Organiser l’utilisation des différents outils concernant les maladies chroniques et notamment les <strong>guide</strong>s<br />
sur les prises en charge en ALD (lien pour accéder à ces <strong>guide</strong>s sur le site de la HAS : http://www.hassante.fr/portail/jcms/c_5081/affections-de-longue-<strong>du</strong>ree?cid=c_5081).<br />
Suite <strong>au</strong>x succès obtenus par les cardiologues dans le traitement de la cardiopathie ischémique par<br />
angioplastie, bon nombre de patients qui survivent à un infarctus <strong>du</strong> myocarde développent ensuite une<br />
insuffisance cardiaque chronique. La prévalence de l’insuffisance cardiaque dans la population âgée ne<br />
cesse d’<strong>au</strong>gmenter et elle représente le t<strong>au</strong>x de recours à l’hôpital le plus élevé des maladies chroniques.<br />
Cette maladie chronique peut bénéficier <strong>au</strong>jourd’hui d’un nouve<strong>au</strong> mode de prise en charge comme la<br />
télésurveillance <strong>au</strong> domicile dont les premiers résultats montrent une nette ré<strong>du</strong>ction de la fréquence des<br />
poussées d’insuffisance cardiaque et par voie de conséquence des hospitalisations.<br />
Améliorer l’efficience<br />
Favoriser le maintien à domicile et développer dans ce cadre les interventions des acteurs sanitaires et<br />
soci<strong>au</strong>x concernés, par substitution d‘une partie de l’activité d’hospitalisation à temps complet en<br />
établissement de santé.<br />
Assurer une meilleure information et une meilleure coordination des acteurs par le développement dans<br />
chaque territoire de santé, des modes de coordination entre les différents acteurs sanitaires et médicosoci<strong>au</strong>x<br />
intervenant <strong>au</strong> cours de la prise en charge (rése<strong>au</strong>x, maisons de santé et centres de santé, HAD,<br />
SSIAD, associations d’usagers promoteurs de programmes d’é<strong>du</strong>cation thérapeutique, etc.)<br />
Fluidifier les filières de prise en charge sanitaires<br />
Ré<strong>du</strong>ire les hospitalisations inadéquates et le recours <strong>au</strong>x unités d’accueil des urgences<br />
Points d'articulation avec la prévention et le médico social<br />
- Les actions de prévention des con<strong>du</strong>ites à risque (nutrition, activité physique), afin de limiter les<br />
complications de la pathologie et/ou <strong>du</strong> handicap associé<br />
- Les relations entre les acteurs sanitaires et les acteurs de l’accompagnement des patients/ familles<br />
- Les programmes d'é<strong>du</strong>cation thérapeutique, dont l'impact est à la charnière entre la prévention et le<br />
soin<br />
- Dès les séjours en hospitalisation, la coordination et l’anticipation des conditions d’intervention des<br />
acteurs soci<strong>au</strong>x et médico-soci<strong>au</strong>x (SSIAD en particulier) et des acteurs sanitaires <strong>au</strong> domicile <strong>du</strong><br />
patient.<br />
Ces points d’articulation nécessitent que soit réalisé <strong>au</strong> sein des territoires de santé un recensement<br />
préalable des princip<strong>au</strong>x acteurs susceptibles de soutenir la politique de maintien à domicile.<br />
A côté de dispositifs très spécifiques, certaines maladies rares présentent des besoins similaires à ceux<br />
des maladies chroniques. C’est pourquoi les orientations définies pour les maladies chroniques doivent<br />
être appliquées <strong>au</strong>x maladies rares, en fonction des besoins région<strong>au</strong>x. C’est le cas notamment en<br />
matière :<br />
- d’organisation <strong>du</strong> recours (souvent interrégional ou national) <strong>au</strong>x avis spécialisés ;<br />
- <strong>du</strong> développement de l’é<strong>du</strong>cation thérapeutique ;<br />
- d’une réponse adaptée <strong>au</strong>x besoins de répit ;<br />
- des besoins de coordination entre les différents acteurs sanitaires et médico-soci<strong>au</strong>x ainsi qu’avec<br />
les associations représentant les usagers.<br />
Indicateurs de suivi<br />
- Nombre de programmes d’é<strong>du</strong>cation thérapeutique <strong>au</strong>torisés par l’ARS.<br />
- Part des programmes d’é<strong>du</strong>cation thérapeutique <strong>au</strong>torisé par l’ARS incluant des associations<br />
d'usagers.<br />
<strong>DGOS</strong> version 2.1 34