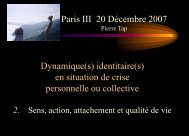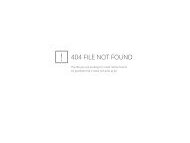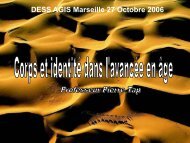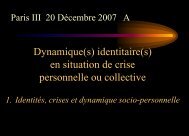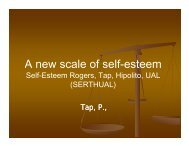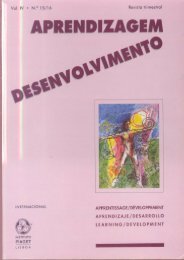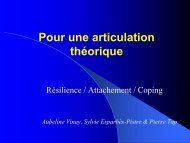Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
l’Intersubjectif à l’Intrasubjectif ? Essai de Logique Interlocutoire. L’Orientation Scolaire et Professionnelle,<br />
32, 3, 399-436.<br />
Pauline Dalmon (Université de Toulouse le Mirail- Laboratoire CERPP), Sordes-Ader Florence (Université<br />
de Toulouse le Mirail- CERPP)<br />
Les difficultés d’adaptation face à l’insuffisance rénale chronique terminale : de la suradaptation à la<br />
non observance.<br />
Contact : pdalmon@hotmail.com<br />
L’insuffisance rénale chronique terminale est une maladie chronique lourde nécessitant pour la survie du<br />
patient que ce dernier assiste à trois séances de dialyse par semaine (de 3-4 heures chacune), de suivre un<br />
régime alimentaire et hydrique ainsi que de prendre quotidiennement des médicaments et de se soumettre à<br />
des examens médicaux réguliers. Les personnes qui en sont atteints voient leur vie entièrement bouleversée<br />
et font l’expérience de la maladie au long court semée d’incertitudes (quant à l’avenir, à l’évolution de la<br />
maladie,…), d’angoisses, de deuils et de pertes (perte de certains rôle sociaux, du sentiment de toute<br />
puissance…). Dans le cas, de l’insuffisance rénale chronique, la dépendance à la machine, les différents<br />
aspects du traitement rappelle au sujet qui en est atteint, que chaque jour il recule les limites de la mort.<br />
Selon Cupa (2002), le sujet dialysé est dans une situation identique à celle d’un survivant. Cette proximité<br />
avec la mort, le deuil sans fin dans lequel est plongé le malade et les multiples contraintes et conséquences<br />
de cette affection peuvent soulever de nombreuses angoisses et difficultés. Ces dernières peuvent alors<br />
entraver l’adaptation à la maladie. Ainsi, en appuyant nos propos sur des entretiens que nous avons<br />
effectués auprès de personnes dialysés à la clinique du Pont-de-Chaume de Montauban, nous verrons<br />
quelles répercussions sociales, physiques et psychologiques entraînent cette affection et en quoi elles<br />
peuvent avoir une influence sur l’adaptation faisant que certains d’entre eux peuvent avoir des<br />
comportements de suradaptation ou à l’inverse de comportements de négligence, de non observance.<br />
Michèle Koleck (Université Bordeaux 2 Victor Segalen), Xavier Borteyrou (Université Bordeaux 2 Victor<br />
Segalen), Jean Guérin (CHU de Bordeaux), Patricia Gabinski (CHU de Bordeaux), Patrick Brochard<br />
(CHU de Bordeaux) Florence Fernet (CHU Bordeaux)<br />
Lombalgie chronique chez le personnel soignant et médico-technique : premiers résultats d’une<br />
étude longitudinale<br />
Contact : michele.koleck@u-bordeaux2.fr<br />
Par sa forte prévalence dans les pays industrialisés (35 à 50%), la lombalgie commune constitue un<br />
problème majeur de santé publique. C'est une pathologie de l'adulte en activité, ce qui entraîne un coût<br />
économique important largement imputable (70 à 80%) à la forme chronique de l'affection qui ne représente<br />
pourtant que 7 à 10% des cas. L'ensemble des études portant sur la population générale souligne de<br />
manière récurrente l'influence de facteurs psychosociaux dans le passage à la chronicisation. Les facteurs<br />
organiques qui sont à l'origine des lombalgies aiguës peuvent continuer à intervenir mais d'autres facteurs<br />
d'ordre comportemental ou émotionnel gagnent en importance au cours du temps de manière à enfermer le<br />
patient dans une situation difficilement réversible. Le personnel soignant et médico-technique est<br />
particulièrement exposé, l'incidence de la lombalgie étant aussi élevée que chez les travailleurs manuels de<br />
l'industrie. Le taux de prévalence annuelle est de 40 à 50%. I1 est de 35 à 80% au cours de leur vie et atteint<br />
81,31 pour les infirmières de soins intensifs. Dans cette étude longitudinale, les sujets sont recrutés sur leur<br />
lieu de travail par le service de médecine du travail du CHU de Bordeaux. Ils sont interrogés à quatre<br />
reprises (inclusion, 3 mois, 6 mois, 1 an). Ils font l’objet d’un bilan médical et d’un bilan psychologique<br />
permettant d’évaluer, lors de l’inclusion, le névrosisme (NEO Personality Inventory) et aux 4 temps, l’état<br />
anxio-dépressif (Hospital Anxiety-Depression), les stratégies de coping (Ways of Coping Checklist, Chronic<br />
Pain Coping Inventory) et la qualité de vie (Nottingham Health Profile) des lombalgiques. Les 40 sujets<br />
inclus à ce jour présentent des niveaux d’anxiété, de dépression, de colère, d’impulsivité, de timidité sociale<br />
et de vulnérabilité significativement supérieurs à la moyenne. La plupart rapportent une qualité de vie<br />
dégradée sur le plan fonctionnel comme sur le plan émotionnel. On note également des différences entre les<br />
patients en fonction de l’origine de la lombalgie (musculaire, facettaire, discale). Ces premiers résultats<br />
s’inscrivent dans une approche descriptive. La suite de cette étude permettra d’identifier les facteurs<br />
psychologiques, les stratégies cognitivo-comportementales et les facteurs médicaux jouant un rôle dans<br />
l’évolution de la lombalgie.<br />
23