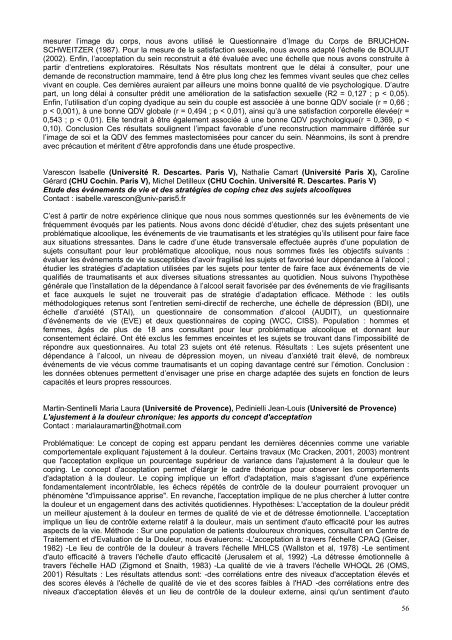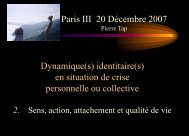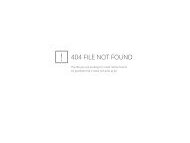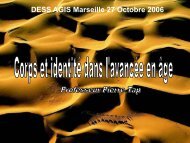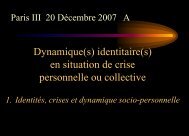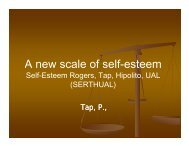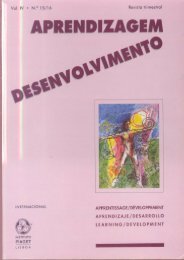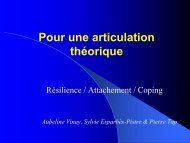Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
mesurer l’image du corps, nous avons utilisé le Questionnaire d’Image du Corps de BRUCHON-<br />
SCHWEITZER (1987). Pour la mesure de la satisfaction sexuelle, nous avons adapté l’échelle de BOUJUT<br />
(2002). Enfin, l’acceptation du sein reconstruit a été évaluée avec une échelle que nous avons construite à<br />
partir d’entretiens exploratoires. Résultats Nos résultats montrent que le délai à consulter, pour une<br />
demande de reconstruction mammaire, tend à être plus long chez les femmes vivant seules que chez celles<br />
vivant en couple. Ces dernières auraient par ailleurs une moins bonne qualité de vie psychologique. D’autre<br />
part, un long délai à consulter prédit une amélioration de la satisfaction sexuelle (R2 = 0,127 ; p < 0,05).<br />
Enfin, l’utilisation d’un coping dyadique au sein du couple est associée à une bonne QDV sociale (r = 0,66 ;<br />
p < 0,001), à une bonne QDV globale (r = 0,494 ; p < 0,01), ainsi qu’à une satisfaction corporelle élevée(r =<br />
0,543 ; p < 0,01). Elle tendrait à être également associée à une bonne QDV psychologique(r = 0,369, p <<br />
0,10). Conclusion Ces résultats soulignent l’impact favorable d’une reconstruction mammaire différée sur<br />
l’image de soi et la QDV des femmes mastectomisées pour cancer du sein. Néanmoins, ils sont à prendre<br />
avec précaution et méritent d’être approfondis dans une étude prospective.<br />
Varescon Isabelle (Université R. Descartes. Paris V), Nathalie Camart (Université Paris X), Caroline<br />
Gérard (CHU Cochin. Paris V), Michel Detilleux (CHU Cochin. Université R. Descartes. Paris V)<br />
Etude des événements de vie et des stratégies de coping chez des sujets alcooliques<br />
Contact : isabelle.varescon@univ-paris5.fr<br />
C’est à partir de notre expérience clinique que nous nous sommes questionnés sur les évènements de vie<br />
fréquemment évoqués par les patients. Nous avons donc décidé d’étudier, chez des sujets présentant une<br />
problématique alcoolique, les événements de vie traumatisants et les stratégies qu’ils utilisent pour faire face<br />
aux situations stressantes. Dans le cadre d’une étude transversale effectuée auprès d’une population de<br />
sujets consultant pour leur problématique alcoolique, nous nous sommes fixés les objectifs suivants :<br />
évaluer les événements de vie susceptibles d’avoir fragilisé les sujets et favorisé leur dépendance à l’alcool ;<br />
étudier les stratégies d’adaptation utilisées par les sujets pour tenter de faire face aux événements de vie<br />
qualifiés de traumatisants et aux diverses situations stressantes au quotidien. Nous suivons l’hypothèse<br />
générale que l’installation de la dépendance à l’alcool serait favorisée par des événements de vie fragilisants<br />
et face auxquels le sujet ne trouverait pas de stratégie d’adaptation efficace. Méthode : les outils<br />
méthodologiques retenus sont l’entretien semi-directif de recherche, une échelle de dépression (BDI), une<br />
échelle d’anxiété (STAI), un questionnaire de consommation d’alcool (AUDIT), un questionnaire<br />
d’événements de vie (EVE) et deux questionnaires de coping (WCC, CISS). Population : hommes et<br />
femmes, âgés de plus de 18 ans consultant pour leur problématique alcoolique et donnant leur<br />
consentement éclairé. Ont été exclus les femmes enceintes et les sujets se trouvant dans l’impossibilité de<br />
répondre aux questionnaires. Au total 23 sujets ont été retenus. Résultats : Les sujets présentent une<br />
dépendance à l’alcool, un niveau de dépression moyen, un niveau d’anxiété trait élevé, de nombreux<br />
événements de vie vécus comme traumatisants et un coping davantage centré sur l’émotion. Conclusion :<br />
les données obtenues permettent d’envisager une prise en charge adaptée des sujets en fonction de leurs<br />
capacités et leurs propres ressources.<br />
Martin-Sentinelli Maria Laura (Université de Provence), Pedinielli Jean-Louis (Université de Provence)<br />
L'ajustement à la douleur chronique: les apports du concept d'acceptation<br />
Contact : marialauramartin@hotmail.com<br />
Problématique: Le concept de coping est apparu pendant les dernières décennies comme une variable<br />
comportementale expliquant l'ajustement à la douleur. Certains travaux (Mc Cracken, 2001, 2003) montrent<br />
que l'acceptation explique un pourcentage supérieur de variance dans l'ajustement á la douleur que le<br />
coping. Le concept d'acceptation permet d'élargir le cadre théorique pour observer les comportements<br />
d'adaptation à la douleur. Le coping implique un effort d'adaptation, mais s'agissant d'une expérience<br />
fondamentalement incontrôlable, les échecs répétés de contrôle de la douleur pourraient provoquer un<br />
phénomène "d'impuissance apprise". En revanche, l'acceptation implique de ne plus chercher à lutter contre<br />
la douleur et un engagement dans des activités quotidiennes. Hypothèses: L'acceptation de la douleur prédit<br />
un meilleur ajustement à la douleur en termes de qualité de vie et de détresse émotionnelle. L'acceptation<br />
implique un lieu de contrôle externe relatif à la douleur, mais un sentiment d'auto efficacité pour les autres<br />
aspects de la vie. Méthode : Sur une population de patients douloureux chroniques, consultant en Centre de<br />
Traitement et d'Evaluation de la Douleur, nous évaluerons: -L'acceptation à travers l'échelle CPAQ (Geiser,<br />
1982) -Le lieu de contrôle de la douleur à travers l'échelle MHLCS (Wallston et al, 1978) -Le sentiment<br />
d'auto efficacité à travers l'échelle d'auto efficacité (Jerusalem et al, 1992) -La détresse émotionnelle à<br />
travers l'échelle HAD (Zigmond et Snaith, 1983) -La qualité de vie à travers l'échelle WHOQL 26 (OMS,<br />
2001) Résultats : Les résultats attendus sont: -des corrélations entre des niveaux d'acceptation élevés et<br />
des scores élevés à l'échelle de qualité de vie et des scores faibles à l'HAD -des corrélations entre des<br />
niveaux d'acceptation élevés et un lieu de contrôle de la douleur externe, ainsi qu'un sentiment d'auto<br />
56