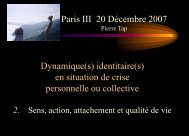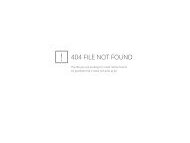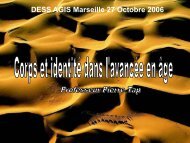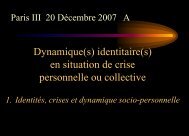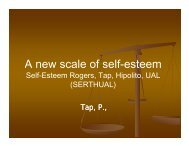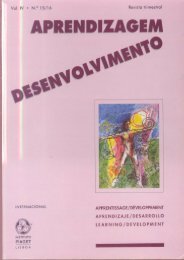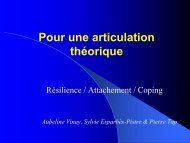Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sessions parallèles 5 : vendredi 24 juin : 14h30-16h<br />
5A : Table ronde pratiques professionnelles<br />
1. Isabelle Boulze (Université Paul Valéry, Montpellier III)<br />
Incidence du concept d'addiction sur la pratique clinique<br />
Contact : isabelle.boulze@free.fr<br />
L’intérêt pour les conduites addictives entraîne de nombreux aménagements des politiques de santé publique<br />
(Rapport Reynaud-Parquet-Lagrue), des prises en charges thérapeutiques (recommandations cliniques du<br />
mésusage, Société Française d’Alcoologie et d’Addictologie) et des modélisations théoriques (Mac Dougall,<br />
Pedinielli pour le référentiel psychanalytique, Adès et Descombey pour la psychiatrie, Ehrenberg pour la<br />
sociologie…). Nous interrogerons ces changements, leurs impacts théoriques et pratiques, à partir d’une lecture<br />
anthropologique du « malaise dans la civilisation ». En effet, le cadre thérapeutique « classique » a été remis en<br />
cause par les problématiques addictives, mais aussi par les états limites (Bergeret), la maladie psychosomatique<br />
(Marty) ou l’alexithymie (Pédinielli). L’expression symptomatique transnosographique (acte-symptôme, Mac<br />
Dougall) a « bousculé » la pratique clinique. Le discours souvent « pauvre », laissant peu de place à l’élaboration<br />
fantasmatique, demande à repenser des formes d’investissement thérapeutique. Dans l’addiction, le peu<br />
d’élaboration psychique est à mettre en parallèle avec la focalisation de la pensée sur la conduite entraînant une<br />
quasi disparition des autres centres d’intérêt. Le discours commun des patients présentant des addictions interroge<br />
les praticiens sur la disparition d’un discours singulier favorisant la mise en place d’un dispositif thérapeutique<br />
d’inspiration psychanalytique. A la problématique de l’organisation sexuelle du symptôme, se substitue un discours<br />
caractérisant l’individu par l’énumération de ses troubles du comportement, au point de réduire l’expression de sa<br />
souffrance à : « je suis alcoolique, boulimique, anorexique, toxicomane… ». Il est important d’interroger l’origine de<br />
la fonction défensive de ce discours asexué et du flot d’informations qui le composent. Ainsi, au delà des<br />
spécificités des conduites addictives, on peut se demander ce que sera le devenir de l’intervention psychologique<br />
auprès de personnes âgées, de sportifs, de salariés licenciés par leur entreprise, dans le domaine de la<br />
prévention, lors de catastrophes, d’attentat, d’accidents. Comment penser cette consommation du psychologique ?<br />
Comment se positionner face à la pluralité des demandes ? Cet intérêt et cet engouement pour le psychologique<br />
ne risque-t-il pas de devenir une conduite de réassurance morale ?<br />
2. Christine Jeoffrion (Université de Nantes)<br />
Représentation sociale de la non-observance et identité des patients et des professionnels de la santé<br />
Contact : christine.jeoffrion@univ-nantes.fr<br />
Notre étude est centrée sur les causes de la non-observance des patients afin d'y remédier. Elle s’inscrit dans la<br />
suite d’un programme de recherche que nous avons mené avec la CNAMTS (Jeoffrion, Lafon, 2004). Une enquête<br />
a été réalisée auprès de patients et de professionnels de la santé, afin de mettre à jour les représentations qu’ils<br />
ont de la maladie, du médicament, des relations médecin-patient, et de l’observance. Cette communication<br />
poursuit les premières investigations présentées lors des Entretiens de la psychologie (Jeoffrion, 2004) sur<br />
l’exploitation d’associations libres avec le logiciel «EVOC» (Vergès, 1995) et rend compte des entretiens exploités<br />
par le logiciel Alceste (Reinert, dernière actualisation). Les premiers résultats issus des questionnaires ont montré<br />
la différence fondamentale qui oppose les professionnels de la santé aux patients. Si les professionnels de la santé<br />
sont essentiellement centrés sur le traitement et sur la relation avec le patient, ce n’est pas ce qui prime chez le<br />
patient qui, lui, focalise son attention sur le bouleversement entraîné dans sa propre vie par la maladie. Traitement<br />
médicamenteux d’un côté, mode de vie de l’autre, les représentations renvoient à des univers sémantiques bien<br />
distincts. Les investigations actuelles viennent approfondir ces premiers résultats à partir d’une analyse factorielle<br />
mettant en lien les associations citées et les caractéristiques des personnes qui les ont citées, telles que l’âge, le<br />
sexe, le niveau d’études, la profession, mais aussi le type de traitement suivi par les patients, ou encore le lieu<br />
d’exercice des professionnels de la santé (libéral, hôpital public), afin de distinguer des « identités » différentes.<br />
Par ailleurs, les entretiens, au travers des trajectoires de vie des uns et des autres et de la représentation qu’ils se<br />
font d’eux-mêmes et de leur profession (on peut parler ici d’identité professionnelle, notamment en ce qui concerne<br />
les professionnels de la santé) vient enrichir la compréhension de ces analyses. Une des conclusions qui peut<br />
d’ores et déjà être proposée est que, si l’on parle de plus en plus d’éducation thérapeutique des patients, il semble<br />
tout-à-fait nécessaire de mesurer toute l’importance d’une réelle formation aux sciences humaines des<br />
professionnels de la santé, très démunis pour comprendre ces phénomènes de non-observance.<br />
47