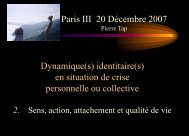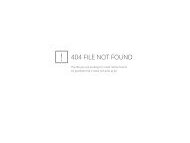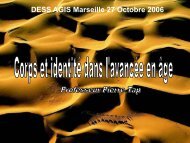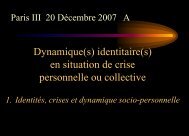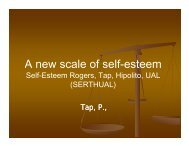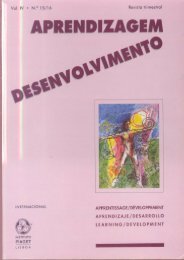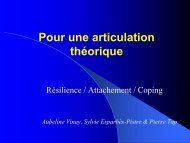Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
(Freedman et Fraser, 1966), montrent tout l’intérêt qu’il y a à passer par des actes préparatoires. Le principe<br />
du pied-dans-la porte, consiste à faire précéder la requête concernant le comportement attendu d’une<br />
requête de moindre coût (acte préparatoire,cf Joule et Beauvois, 1998 ; 2002). On sait que l’acte<br />
préparatoire doit relever de la même identification de l’action que le comportement attendu. Si le choix de<br />
l’acte préparatoire se fait, dans les recherches, de manière relativement intuitives, la théorie des<br />
représentations sociales pourrait nous aider à mieux choisir l’acte préparatoire et par de là, nous permettre<br />
de gagner en efficacité. Expérience : L’objet de cette recherche est d’optimiser la procédure de pied-dans-la<br />
porte à la lumière de la théorie des représentations sociales. On fait l’hypothèse que la réalisation d’un acte<br />
préparatoire qui aurait trait à un élément central de la représentation du don d’organes permettra<br />
d’augmenter la probabilité que les sujets signent une carte de donneur comparativement à une condition<br />
dans laquelle l’acte préparatoire aurait trait à un élément périphérique. Méthode : Dans un premier temps,<br />
nous avons étudié la représentation du don d’organes chez une population d’étudiantes, et avons dégagé 8<br />
éléments (4 centraux et 4 périphériques). Dans un second temps, les sujets étaient sollicités afin de signer<br />
une pétition sur le don d’organes (acte préparatoire). Pour la moitié des sujets, l’accroche de la pétition<br />
portait sur un élément central (par exemple : donner ses organes, c’est aider les autres), pour l’autre moitié,<br />
sur un élément périphérique (par exemple : donner ses organes, c’est sauver des vies). Puis, il leur était<br />
proposé de signer une carte de donneur (comportement attendu). Résultats : Nous avons obtenu l’effet<br />
classique de pied-dans-la porte: les sujets de la condition pied-dans-la porte (68 sujets/ 160) furent<br />
significativement plus nombreux à signer une carte de donneur que les sujets de la condition contrôle (42<br />
sujets /136), soumis uniquement à la requête finale (p < 0,05). Mais, surtout notre hypothèse principale se<br />
trouve validée : les sujets pour qui un élément central était activé (40 sujets /80) furent significativement plus<br />
nombreux à signer une carte de donneur que ceux pour qui un élément périphérique était activé (28 sujets /<br />
80) ( p < 0,10).<br />
Bagnulo Adriana (Université Toulouse II), Muñoz Sastre Maria Teresa (Université Toulouse II)<br />
Pourquoi prend-on des antibiotiques? Une étude des raisons invoquées en France<br />
Contact : adrianabagnulo@yahoo.com<br />
Les antibiotiques ont permis un grand progrès dans la lutte contre les maladies infectieuses. Néanmoins, depuis<br />
quelques années, nous sommes confrontés à un problème majeur de Santé Publique : le phénomène de la résistance<br />
bactérienne. Le mauvais usage des antibiotiques est une des causes de la résistance. L’une des stratégies consiste à<br />
réduire au minimum l’usage injustifié ou inadapté. L’objectif de cette étude était de connaître les principales raisons<br />
invoquées pour le refus et la prise des antibiotiques en France, chez le grand public. Le cadre théorique s’appuie sur la<br />
Théorie du Renversement de Michael Apter. 177 personnes ont été interrogées. L’échantillon était constitué d’adultes «<br />
tout venant ». Le matériel se composait d’un questionnaire de 60 items qui portait sur les raisons à prendre des<br />
antibiotiques, un questionnaire de 70 items qui portait sur les raisons à refuser des antibiotiques et 21 questions<br />
recueillaient les caractéristiques personnelles et les habitudes vis-à-vis des antibiotiques. Des analyses factorielles<br />
exploratoires furent réalisées pour les deux questionnaires. Dans le cas des raisons à prendre des antibiotiques, une<br />
solution à trois facteurs qui expliquait 36% de la variance fut retenue. Le premier facteur regroupait les raisons de type<br />
altruistes (pour ne pas être une charge pour les autres). Dans le deuxième facteur, les raisons données étaient plus<br />
égocentriques (pour retrouver la maîtrise de soi). Le troisième rassemblait les items où prendre des antibiotiques est un<br />
moyen d’obtenir un plaisir immédiat. Dans le cas du questionnaire qui porte sur le refus, une solution à quatre facteurs<br />
qui expliquait 45.4% de la variance fut retenue. Le premier facteur regroupait les raisons centrées sur la maîtrise de soi<br />
(on n’a pas besoin de médicaments pour guérir). Dans le deuxième facteur la personne est centrée sur elle-même mais<br />
elle chercherait à que les autres se rapprochent d’elle. Le troisième facteur regroupait les items qui portent sur les<br />
raisons économiques et finalement dans le dernier facteur nous retrouvions que les personnes refusaient de prendre des<br />
antibiotiques pour éviter que le phénomène de résistance bactérienne s’accroît.<br />
Hartmann Anne (Université de Haute-Bretagne Rennes 2)<br />
Limites des modèles consuméristes pour l’évaluation de la satisfaction des patients.<br />
Contact : hartmann.anne@wanadoo.fr<br />
En France, les établissements de santé sont tenus de procéder à l’évaluation de la satisfaction des patients.<br />
Cependant, ce concept de satisfaction est mal défini, et la plupart des études sur ce thème utilisent le<br />
modèle des attentes dans une perspective consumériste. Toutefois, les résultats constamment élevés des<br />
enquêtes de satisfaction amènent certains chercheurs à s’intéresser à la manière dont les patients évaluent<br />
leur satisfaction grâce à l’utilisation de méthodes qualitatives, ce que propose la présente recherche. Une<br />
pré-enquête (entretiens non-directifs) a été réalisée auprès de patients hospitalisés (N=20) et a permis de<br />
construire une grille de questions. Dans un second temps, des entretiens semi-directifs sont réalisés auprès<br />
d’un autre échantillon de patients (N=13). L’extrême hétérogénéité du matériel obtenu a permis de dégager<br />
deux variables pertinentes sur la manière dont les patients évaluent leur satisfaction : l’« ajustement à<br />
l’hospitalisation », et le rôle que les patients pensent pouvoir tenir dans leur relation au système de soins,<br />
conceptualisé par la notion de « sentiment d’ayant droit ». Des analyses thématiques et automatiques de<br />
contenu sont effectuées. Ces analyses permettent de mettre en évidence quatre profils différents en fonction<br />
38