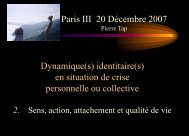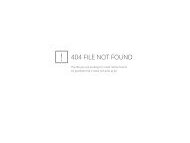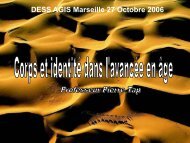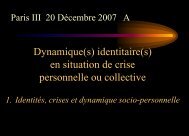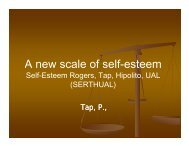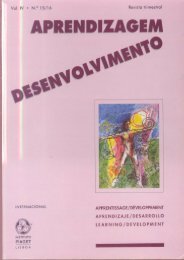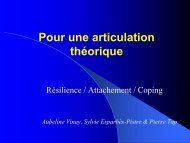Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. Gilles Amado (Groupe HEC), Dominique Lhuillier (Université de Rouen) V. Diuana (Superintendance de la<br />
santé – administration pénitentiaire de l’état de Rio –Brésil) L. Araujo (Superintendance de la santé –<br />
administration pénitentiaire de l’état de Rio –Brésil), A. Duarte (Superintendance de la santé – administration<br />
pénitentiaire de l’état de Rio –Brésil) M. Garcia (Superintendance de la santé – administration pénitentiaire de<br />
l’état de Rio –Brésil), B. Larouze (INSERM U707) L. Poubel (Superintendance de la santé – administration<br />
pénitentiaire de l’état de Rio –Brésil), D. Rolland (Université de Rouen – PRIS), E. Romano (Superintendance de<br />
la santé – administration pénitentiaire de l’état de Rio –Brésil), A. Sanchez (Superintendance de la santé –<br />
administration pénitentiaire de l’état de Rio –Brésil)<br />
La santé dans les prisons brésiliennes : développement d’une recherche – action<br />
Contact : dominique.lhuilier@univ-rouen.fr AMADO@hec.fr<br />
Santé et soins : nécessité et complexité d’une recherche action dans les prisons de l’Etat de Rio – Brésil. Cette<br />
recherche action vise à la fois la production de connaissances et de changements en termes d’amélioration d’une<br />
situation sanitaire alarmante notamment en matière de VIH et tuberculose. L’action désigne ici à la fois la mise en<br />
œuvre de dispositions techniques et organisationnelles aussi les activités propres au travail d’analyse et<br />
contribuant à une évolution des représentations, des relations, et des pratiques. La nécessité de cette orientation<br />
tient à la fois à des raisons éthiques (l’état sanitaire, la misère matérielle, la souffrance des détenus « imposent »<br />
aux chercheurs de se préoccuper de l’amélioration des conditions d’existence et d’accès aux soins), et des raisons<br />
d’efficacité (associer les chercheurs et les acteurs sujets et « objets » de la recherche dans une visée d’implication<br />
favorisant les processus de changement). « Pour comprendre une réalité, il faut tenter de la changer » (K. Lewin)<br />
et l’analyse des difficultés et obstacles rencontrés éclairent les dynamiques institutionnelles et les fonctions des<br />
systèmes de représentations. Cette recherche-action franco-brésilienne (soutenue par l’ANRS), privilégie deux<br />
axes d’investigation : - Les représentations des risques sanitaires en prison et les pratiques associées :<br />
structuration et fonctions. Les représentations des maladies contagieuses et transmissibles en prison (agression,<br />
domination, viol, stigmatisation, sanctions…) qui dépendent à la fois des connaissances objectives et des<br />
caractéristiques psycho-sociales de la situation d’incarcération. Le milieu hostile de la prison impose aux détenus<br />
une priorité donnée aux stratégies de survie immédiate et favorise une euphémisation voire un déni des<br />
symptômes de la maladie. La surpopulation carcérale, la promiscuité imposée, le manque d’hygiène et d’intimité<br />
favorisent le sentiment d’exposition à une possible contamination. En même temps que la référence aux maladies<br />
(notamment le VIH et la tuberculose) contribue à des processus de catégorisation et de discrimination sociale. Et<br />
ce, dans un contexte où les stratégies d’adaptation passent par l’appartenance à des groupes constitués et des<br />
conduites de prévention de l’exclusion. - Les empreintes du contexte et de la culture carcérale sur le rapport au<br />
corps et à la santé, sur l’usage des dispositifs sanitaires, sur les stratégies de préservation des différents acteurs.<br />
La population carcérale présente le plus souvent des tableaux cliniques lourds et a rarement eu accès aux<br />
dispositifs d’éducation sanitaire et de soins avant l’incarcération. La prison apparaît alors comme synonyme<br />
d’accès contraint aux soins en même temps que comme un contexte favorisant une dégradation de l’état de santé.<br />
L’usage des services de soins s’inscrit dans des visées stratégiques qui n’ont pas de lien direct avec la maladie<br />
mais donne accès à certains bénéfices (approvisionnement en médicaments revendus dans le marché clandestin<br />
du troc carcéral, protection contre les menaces exercées en détention, attention et écoute…). La maladie simulée<br />
peut procurer des avantages, la maladie réelle, elle, est essentiellement vulnérabilisante quand elle est révélée.<br />
Enfin, l’accès aux soins suppose de dépasser un double filtre : celui des surveillants (pouvoir de « tri’ des<br />
demandes sur des critères plus sécuritaires que sanitaires, celui de l’organisation sociale des détenus (celle des<br />
favelas reproduite intra muros : pouvoir du chef de cellule, des chefs de gangs ou de groupes religieux).<br />
4. Michèle Benhaim (Université de Provence Aix-Marseille 1)<br />
Sida, toxicomanie et société<br />
Contact : michelebenhaim@voila.fr<br />
Travaillant sur le sida depuis 1986 (divers services hospitaliers et champ associatif tel que Médecins du Monde) je<br />
peux témoigner et proposer reflexion et analyses des enjeux modernes de société mis en lumière aujourd'hui par<br />
cette pathologie médico-psycho-sociale à l'heure où des traitements se montent efficaces pourtant pour 80% des<br />
patients. A partir d'une clinique quotidienne aupès de patients conjuguant toxicomanie, sida et galère sociale,<br />
comment travailler aujourd'hui avec ce type de souffrance psychique "actuelle".<br />
48