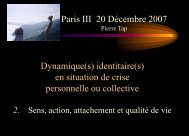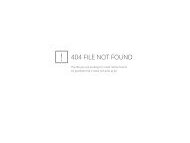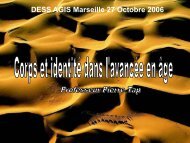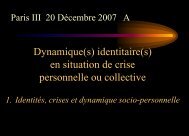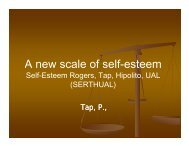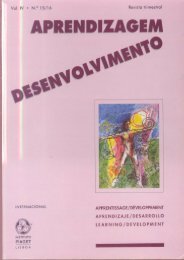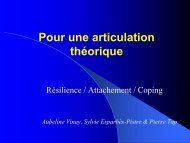Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
3. Sonia Mayordomo (Université d'éducation à distance), Silvia Ubillos (Université de Burgos)<br />
Différences de genre dans les attitudes et dans les conduites sexuelles et à risque dans la population<br />
espagnole<br />
Contact : smayordomo212@eresmas.com<br />
Le but de cette étude est de contribuer avec une vision sur les différences de genre dans les rapports sexuels.<br />
Cette recherche veut examiner les prédictions des théories qui essayent d'expliquer les différences de genre en ce<br />
qui concerne les comportements et les attitudes sexuelles. Toutes concluent que les femmes auront un nombre<br />
mineur de partenaires sexuels que les hommes et que celles-ci auront plus d'attitudes négatives vers les relations<br />
sexuelles occasionnelles. Les résultats de l'étude ont été obtenues d'une enquête sur la conduite sexuelle et à<br />
risque face le VIH appliqué dans des capitales espagnoles. L'échantillon représentatif est constitué par 1489<br />
hommes et 1446 femmes d'âges compris entre 18 et 45 ans. Les résultats confirment que les femmes ont moins<br />
partenaires, mais, de plus durée et elles sont moins d'intervalle de temps sans couple que les hommes. Les<br />
rapports sexuels des femmes sont caractérisés par une stabilité. Malgré que l'on a constaté que la différence dans<br />
l'âge de début des rapports sexuelles entre les hommes et les femmes elle est mineure, celles-ci commencent ses<br />
relations coitales plus tard. Les femmes choisissent des couples plus âgés qu'elles et elles les perçoivent comme<br />
des conjoints potentiels. Les hommes ont une attitude plus favorable vers le sexe casuel et les relations d'amour<br />
ludiques, tandis que les femmes accordent à ses relations une signification plus romantique. En ce qui concerne<br />
les conduites sexuelles de prévention, les hommes ont plus de connaissances sur la procédure d'utilisation du<br />
préservatif, ils présentent une attitude plus positive vers cette méthode et ils perçoivent que l'attitude de son couple<br />
vers le préservatif est plus favorable. Les hommes ont une majeur autoperception à risque ainsi que une majeur<br />
perception de gravité face la possibilité de transmission du VIH. En plus, ils considèrent qu'ils auront plus des<br />
possibilités d'utiliser le préservatif dans l'avenir et ils manifestent l'avoir utilisé plus dans sa vie. Nos résultats<br />
suggèrent que les programmes de prévention doivent s'orienter plus vers le sexe casuel dans le cas des hommes,<br />
tandis que les changements des croyances sur la scène amicale-romantique doivent être orientés plus vers les<br />
femmes.<br />
4. Dominique Lassarre (Laboratoire de psychologie appliquée. Université de Reims), Dominique Meiffren<br />
(CUFR Nîmes)<br />
Deux générations face aux risques sanitaires : émotions et catégorisation<br />
Contact : dominique.lassarre@univ-reims.fr<br />
Une enquête a été menée auprès de deux populations, des étudiants de 16 à 28 ans et des actifs de 40 à 52 ans<br />
dans deux viles moyennes. Elle a montré que la notion générale de risque suscitait des émotions identiques, mais<br />
que les risques évoqués spontanément n'étaient pas les mêmes. Les deux générations ne catégorisent pas les<br />
risques sanitaires de manière identiques. Leur génération, celle de leurs enfants et celles de leurs parents ne se<br />
voient pas attribués les mêmes risques sanitaires. Les réponses font apparaître des différences que l'on peut<br />
interpréter en terme de représentations des risques en fonction de l'âge mais en fonction des représentation du<br />
contexte socio-historique passé, présent et à venir.<br />
5. Arnaud Siméone (Université Lumière, Lyon 2)<br />
La perception du risque d’ébriété associé à une consommation conjointe d’alcool et de cannabis.<br />
Contact : arnaud.simeone@univ-lyon2.fr<br />
Les enquêtes les plus récentes tendent à montrer que la consommation du cannabis est en augmentation chez les<br />
adolescents et les jeunes adultes dans l’ensemble des pays occidentaux, quelle que soit sa fréquence,<br />
expérimentale ou répétée (INSERM, 2001 ; Beck & Legleye, 2004). Cette banalisation de l’usage du cannabis<br />
semble s’accompagner d’une relative baisse de la perception du danger associé à la consommation de ce produit.<br />
Paradoxalement, les travaux scientifiques soulignant les effets délétères de la consommation de cette substance<br />
n’ont jamais été aussi nombreux et tranchés. En particulier, l’implication croissante de l’ivresse cannabique dans<br />
les accidents de la circulation est un phénomène de plus en plus préoccupant (Movig et al., 2003), d'autant plus<br />
que la consommation de cannabis se fait très souvent conjointement avec celle de l’alcool, et que ces deux<br />
substances potentialisent leurs effets enivrants (Degenhardt, 2001). La recherche présentée ici propose une<br />
modélisation de la perception du risque d’ébriété associé à une consommation conjointe d’alcool et de cannabis,<br />
dans un échantillon de 80 jeunes adultes, garçons et filles, consommateurs occasionnels ou non d’alcool et / ou de<br />
cannabis. La méthode utilisée est une application de la mesure fonctionnelle, associée à la Théorie Fonctionnelle<br />
28