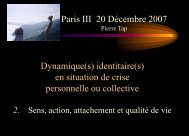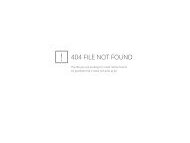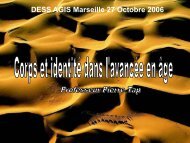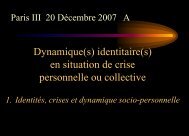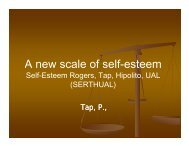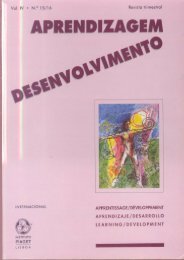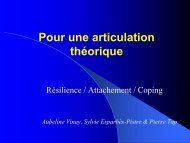Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
La recherche présentée est la première étude d’un projet qui a pour objectif d’analyser la représentation<br />
sociale de la maladie mentale parmi les opérateurs psychiatriques et les sujets naïfs, en se concentrant sur<br />
la relation avec les pratiques des sujets et les contextes culturels spécifiques (italiens et français). Il se<br />
compose de deux études : 1. Etude exploratoire pour analyser le contenu de la représentation sociale parmi<br />
100 sujets experts des " Départements de la Santé Mentale " de Genova (Gênes) et de Mondovì-Ceva<br />
(Italie) et 100 sujets naïfs des mêmes villes. 2. Etude ciblée à l’analyse de la structure de la représentation<br />
sociale et à la validation de l’hypothèse que son noyau central soit organisé autour des dimensions de la<br />
subjectivité et de l’altérité. Les sujets étudiés sont 200, subdivisés entre sujets naïfs et experts et entre<br />
contexte italien et français. Les hypothèses qui guident ce travail partent des recherches de Jodelet (1985,<br />
1986,1989), De Rosa (1990), et des recherches internationales (France, Espagne, Italie) sur la<br />
représentation sociale de la maladie mentale (Bellelli, 1994) Toutes ces recherches voient cette<br />
représentation se structurer autour de la dichotomie normalité/pathologie liée à l’opposition soi--mêmenormal/autre-divers.<br />
Tels résultats peuvent conduire à l’hypothèse que le noyau central puisse s'organiser<br />
selon les dimensions de la subjectivité et de l’altérité, ainsi que culturellement exprimées, dans l’hypothèse<br />
que la maladie mentale puisse être vue comme radicalement autre de soi-même, altérité en opposition à un<br />
modèle de subjectivité culturellement centrée sur l’autodétermination, la conscience et la rationalité. Les<br />
données de la première étude ont été recueillies par un questionnaire qui comprenait des évocations libres,<br />
des questions ouvertes et des questions à choix multiples. Ces données ont été analysées par différentes<br />
méthodes : 1) pour les évocations, analyse de la fréquence et du rang avec Evoc 2003 et classification<br />
descendante hiérarchique avec Alceste, 2) pour les questions ouvertes, analyse traditionnelle de contenu et<br />
analyse avec Alceste, 3) pour les questions à choix multiples, analyses descriptives et des relations<br />
significatives. Cette première étude veut voir quels univers de significations sont représentés, quelles<br />
variables sont liées aux classes, si les sujets experts utilisent des mondes lexicaux différents par rapport aux<br />
sujets naïfs et enfin rechercher s’il y a des éléments dans les contenus des représentations qui peuvent être<br />
reliés aux thèmes de la subjectivité et de l’altérité, des éléments avec les quels on pourrait partir pour la<br />
seconde étude plus spécifique sur la structure du noyau central.<br />
Duchène Christelle (INPES), Barthélémy Lucette (Comité régional d'éducation pour la santé de<br />
Lorraine), Housseau Bruno (INPES), Vincent Isabelle (INPES)<br />
Comportement alimentaire et précarité : réactualisation du Classeur alimentation atout prix<br />
Contact : christelle.duchene@inpes.sante.fr<br />
Introduction Depuis plusieurs années l’INPES et ses partenaires travaillent sur les possibilités d’agir en<br />
éducation pour la santé sur l’alimentation des personnes en situation de précarité socio-économique.<br />
Prévenir les déficiences nutritionnelles de ces populations fait partie des objectifs de santé publique du<br />
<strong>Programme</strong> national nutrition santé. Mais travailler sur l’alimentation avec ces personnes ne peut se réduire<br />
à la seule considération de la qualité nutritionnelle de leurs apports alimentaires. Les difficultés au quotidien<br />
et les différentes dimensions de l’acte alimentaire, psychoaffective, relationnelle et culturelle notamment,<br />
sont autant d’éléments à prendre en compte. Objectifs Contribuer à faire de l’alimentation, la préparation et<br />
la prise des repas, un moyen de promotion de la santé pour les personnes en situation de précarité socioéconomique.<br />
L’objectif n’est pas seulement de leur apprendre à adapter leurs apports alimentaires mais<br />
aussi de les aider à conserver ou retrouver le plaisir de manger, de recréer du lien social autour des repas et<br />
d’améliorer leur estime de soi. Méthode Cet outil propose des activités à mener collectivement qui reposent<br />
sur les principes suivants : - une approche positive des recommandations nutritionnelles et de l’alimentation<br />
en général - une démarche participative visant à donner envie aux personnes de s’interroger sur leurs<br />
pratiques alimentaires et à les rendre actives. - un travail à partir des expériences, habitudes, croyances et<br />
valeurs propres à chacun en matière d’alimentation - la possibilité pour chacun de s’exprimer à ce sujet, de<br />
partager ses difficultés mais aussi ses astuces et idées. Résultats L’outil est composé de trois parties «<br />
acheter, préparer, manger » construites selon la même progression : - faire émerger les représentations,<br />
attitudes, croyances et lister les facteurs favorisant ou limitant pour chacun avec des transparents d’appel<br />
comme « envie / pas envie de cuisiner » ou « pourquoi je mange ? ». - construire, choisir et comparer des<br />
données pour développer les connaissances et savoir faire - proposer des mises en situation reprenant les<br />
éléments précédents. Conclusion L’alimentation permet la mise en valeur de nombreuses compétences.<br />
C’est une porte d’entrée positive et concrète pour promouvoir la santé et l’insertion sociale des personnes.<br />
Negura Lilian (Université Laval), Maranda Marie-France (Université Laval)<br />
Intégration sociale comme modèle d’intervention. Comment les cadres d’entreprises peuvent aider<br />
les toxicomanes ?<br />
Contact : Lilian.Negura@fse.ulaval.ca<br />
41