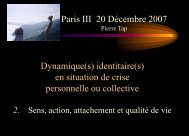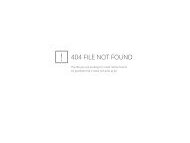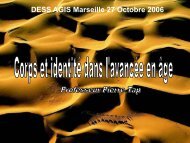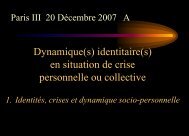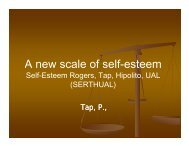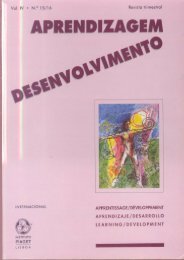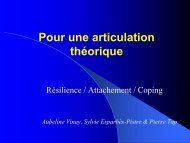Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
souffrance. Ces notions permettent à la fois d’expliquer les éléments qui animent le mouvement sportif et ceux<br />
susceptibles de l’entraver.<br />
3. Julie Collange (Université Paris 5 - Laboratoire de Psychologie Sociale), Sophie Berjot (Laboratoire de<br />
Psychologie Appliquée Université de Reims - Champagne Ardennes)<br />
Image du corps et santé : Influence de la modifiabilité et de l’évaluation cognitive (trait) des stresseurs<br />
Contact : julie_collange@yahoo.fr<br />
L’idéal de minceur renvoyé par les médias représente une source de stress pour les femmes et par conséquent,<br />
diminue la satisfaction du corps (Stice & Shaw, 1994). De plus, certains facteurs de personnalité influencent la<br />
perception du corps et les comportements alimentaires. Dans ce cadre, nous nous intéressons à l’influence de<br />
deux facteurs sur le bien-être et la pratique des régimes. Le premier est la croyance dans la modifiabilité du corps.<br />
Ce concept réfère à la croyance que peuvent avoir les individus de la plus ou moins grande malléabilité du soi et<br />
de ses composantes (Dweck, 1995). De nombreuses études ont montré que la modifiabilité influence la façon dont<br />
on perçoit son environnement, mais surtout la façon dont on y répond, notamment lors d’événements<br />
potentiellement stressants (Dweck, 2000). Le deuxième facteur est l’évaluation cognitive des évènements en terme<br />
de menace ou de défi, influençant le choix des stratégies de faire-face. Notre hypothèse est que la perception du<br />
corps (en terme de positivité et de modifiabilité) ainsi que l’évaluation cognitive influencent le bien-être et la<br />
pratique des régimes. 100 participantes ont répondues à un questionnaire, comprenant une échelle de modifiabilité<br />
(Dweck, 2000), adaptée au corps ; une échelle d’évaluation cognitive « trait » (Brewer & Skinner, 2000), adaptée<br />
au corps ; une mesure de bien-être (Bradley, 1994) ; les sous-échelles « estime de soi corps » et « estime de soi<br />
apparence physique » de l’échelle de « sentiments d’inadéquation » (Fleming & Courtney, 1984) et une série de<br />
questions sur les comportements de régime alimentaire. Dans un premier temps, nous avons procédé à une série<br />
d’analyses de régression afin répliquer les résultats obtenus précédemment et mettant en évidence 1) le rôle de la<br />
modifiabilité comme médiateur de la relation entre estime de soi et évaluation cognitive, et 2) celui de l’évaluation<br />
cognitive comme médiateur entre modifiabilité et bien-être (Berjot & Sedikides, Lausanne, 2004). Dans une<br />
seconde temps, à l’aide d’analyses en équation structurales (EQS), nous avons testé l’adéquation de notre modèle<br />
aux modèles actuels du stress.<br />
4. Patrice Cannone (Service oncologie médicale CHU Timone), David Marie (Université de Provence) Eric<br />
Dudoit (Service oncologie médicale CHU Timone)<br />
Cancer et Genre - Partie II : Approche singulière.<br />
Contact : patrice.cannone@mail.ap-hm.fr<br />
En oncologie médicale, il n'existe pas de thérapeutique spécifique selon le "sexe", si ce n'est en réaction à l'atteinte<br />
cancéreuse qui remet sur le devant de la scène la différence des sexes. Les traitements du cancer du sein ou de<br />
l'utérus concernent les femmes, alors que la prostate se retrouve chez les hommes. Tous, ont à supporter les<br />
thérapeutiques et leurs effets (alopécie, mastectomie…) qui font effraction dans ce qui constitue "l'identité" du sujet<br />
par son appartenance sociale et sa construction singulière. Cela peut sembler surprenant de penser que le sexe<br />
pourrait déterminer un rapport particulier au cancer. Mais au delà du soma, de la détermination du sexe pour un<br />
individu, il existe une sexualité qui se détermine dans un ailleurs du corps. C'est là précisément, la difficulté de la<br />
théorie Freudienne de la sexualité dans le développement de la vie psychique de l'être humain, dans la mesure où<br />
elle n'est pas un dispositif tout monté, mais s'établit au cours d'une histoire individuelle en changeant d'appareils et<br />
de buts. Elle ne saurait se comprendre sur le seul plan d'une genèse biologique mais, inversement, les faits<br />
établissent que la sexualité infantile n'est pas une illusion rétroactive. Pourtant "ce non parler qu'est le corps dans<br />
la parole" demande, désire, interpelle le thérapeute autour de constructions imaginaires, de fantasmes, interpellant<br />
l'autre clinicien, s’il veut bien l'entendre, dans le jeu des investissements... Si Comme le dit Calaferte "Au<br />
commencement était le sexe", alors ne nous méprenons plus sur la distinction nécessaire et importante du sexe et<br />
du genre. Ainsi, s'inscrit l'identité au travers des avatars d'une histoire toujours singulière, identité qui bousculée<br />
par la maladie cancéreuse, revient évidemment sur ce qui a fait évènement dans sa construction et qui peut être<br />
accueillie et travaillée au travers d'une rencontre avec un psychothérapeutes. Comme en témoigne l'histoire de<br />
Maud, rejouant "le cercle brisé de l'amour", tant avec ses proches que les médecins, voilant et dévoilant son<br />
identité dans une "quête de sens " sexualisée, pour elle, de sa maladie.<br />
46