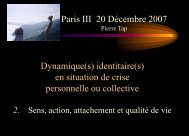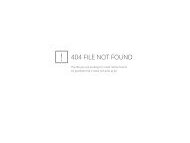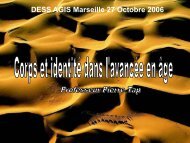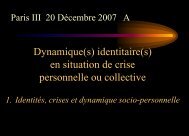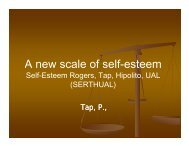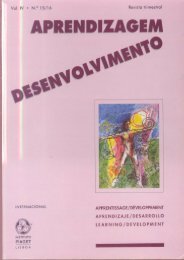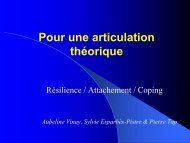Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
sentiments d’incapacité, de culpabilité, de rejet et de repli sur soi. L’obésité est un handicap social qui<br />
entraîne discrimination et exclusion dans toutes les activités de la vie quotidienne. Comme l’ont démontré de<br />
nombreux travaux, il existe une stigmatisation « objective » de l’obésité. Nous nous sommes intéressés,<br />
dans le cadre de notre recherche, à la stigmatisation « perçue » c’est-à-dire avec quelle intensité est<br />
réellement perçue la stigmatisation chez les personnes obèses. Ensuite, nous avons souhaité nous<br />
intéresser à la manière dont les personnes obèses font face, en terme de coping, à ces différentes situations<br />
de stigmatisation. Les stratégies de coping utilisées face à la stigmatisation nous paraissent importantes<br />
dans la mesure où certaines d’entre elles peuvent très certainement augmenter ou atténuer la détresse<br />
psychologique et ainsi affecter l’adaptation et le fonctionnement psychologique global des personnes<br />
obèses. Au regard des résultats de notre recherche, la prise en considération du phénomène de<br />
stigmatisation et des répercussions nous parait indispensable dans la prise en charge « globale » de<br />
l’obésité. Il serait bien utopiste de vouloir changer, dans nos sociétés, le stigmate que représente la<br />
grosseur, par contre la manière dont est perçue la stigmatisation et la manière d’y faire face peuvent sans<br />
doute faire l’objet d’un changement par une prise en charge psychologique adéquate.<br />
Robert Geoffrey (Université Toulouse 2 le Mirail), Munoz Sastre Maria Térésa (Université Toulouse 2 le<br />
Mirail), Mullet Etienne (Ecole Pratique des Hautes Etudes)<br />
Pardon de soi, Estime de soi, Bien-Etre Subjectif<br />
Contact : geoffreyrobert@wanadoo.fr<br />
La présente étude avait pour objectif d’établir la structure factorielle du pardon de soi, puis de la comparer à<br />
celle du pardon à autrui, et enfin de tester les corrélations entre pardon de soi, estime de soi et bien-être<br />
subjectif principalement. Les 167 participant-e-s ont eu à remplir un questionnaire à échelles de réponses.<br />
Les résultats furent qu’une structure à trois facteurs a pu être établie, et que ces trois facteurs recoupent<br />
précisément trois facteurs du pardon à autrui : il s’agit des facteurs Obstacle, Circonstances Facilitantes, et<br />
Blocage. La présente étude représente une avancée dans la mesure où elle met en lumière deux facteurs<br />
nouveau concernant le pardon de soi : en effet, le questionnaire de pardon de soi de MAUGER, l’unique<br />
auteur ayant exploré le pardon de soi d’un point de vue empirique, ne corrèle qu’avec un des facteurs de la<br />
présente étude, le facteur Blocage. Ce dernier facteur révèle une impossibilité à se pardonner à soi-même –<br />
et ce en dépit de circonstances apparemment favorables, comme d’avoir pu réparer l’erreur commise par<br />
exemple, ou encore d’être encouragé à se pardonner par des proches. Il corrèle avec l’estime de soi à<br />
hauteur de -.54, ce qui est largement significatif. Cela signifie qu’une personne ayant un blocage au niveau<br />
de la capacité à se pardonner à elle-même est une personne qui dispose d’une mauvaise estime d’ellemême<br />
; et qu’une personne jouissant d’une bonne estime d’elle-même est une personne capable de se<br />
pardonner à elle-même. La présente étude ne permet pas de préciser le sens du rapport causal en jeu. Par<br />
contre aucune corrélation d’importance majeure n’a été mise en lumière concernant la satisfaction de vie :<br />
elle corrèle à -.26 avec le facteur Blocage, et à .24 avec le facteur Obstacle. Cependant bien que peu<br />
importants, ces résultas confirment que le fait d’être bloqué quant au pardon de soi est corrélé à des<br />
variables indiquant un mal-être psychique : estime de soi basse, niveau de bien-être subjectif peu important.<br />
Nous pouvons ainsi constater la place significative que tient le pardon de soi vis-à-vis de la santé<br />
psychologique. MULLET, E., HOUDBINE, A., LAUMONIER, S., & GIRARD, M. (1998). “Forgivingness” :<br />
Factor structure in a sample of young, middle-aged, and elderly adults. European Psychologist, 3 : 289-297.<br />
MAUGER, P.A., FREEMAN, T., MCBRIDE, A.G., ESCANO PERRY, J., GROVE, D.C., & MCKINNEY, K.E.<br />
(1992). The Measurement of forgiveness : preliminary research. Journal of Psychology and Christianity, 11 :<br />
170-180.<br />
Recchia Sophie (Université de Metz Paul Verlaine), Lemétayer Fabienne (Université de Metz Paul<br />
Verlaine)<br />
Stratégies de coping maternelles et paternelles face à une naissance prématurée<br />
Contact : recchia.sophie@wanadoo.fr<br />
Dans une perspective de compréhension du vécu parental lors d’une naissance prématurée, cette étude<br />
vise un double objectif : 1/ rendre compte des différences entre le coping de la mère et du père au moment<br />
de la naissance de leur enfant ancien prématuré ; 2/ étudier l’effet des traits de personnalité sur le coping<br />
parental. L’échantillon de notre recherche est constitué de 20 parents d’enfants anciens prématurés, où la<br />
mère et le père ont conjointement répondu au Brief-COPE et au NEO-PI-R. Les résultats mettent en<br />
évidence qu’il existe des différences de coping en fonction du sexe des parents. En effet, les mères utilisent<br />
significativement plus le coping de l’expression des sentiments et du blâme que les pères. Elles expriment<br />
davantage soit leurs difficultés, soit leur sentiment de culpabilité liés à cette naissance prématurée, alors que<br />
les pères semblent éprouver plus de difficulté à parler de leur vécu. D’autre part, l’étude montre que les traits<br />
de personnalité influencent les stratégies d’ajustement des parents face à la prématurité. Cette étude montre<br />
la nécessité de proposer un accompagnement, et ceci autant pour la mère que pour le père.<br />
54