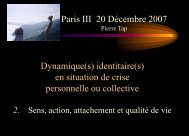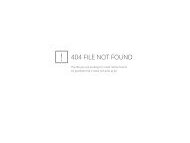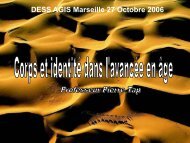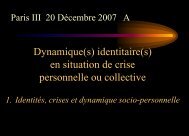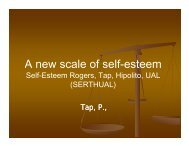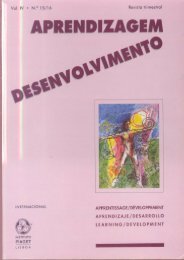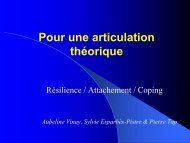Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
qu’un entretien semi-directif. Après analyse de l’entretien et des protocoles des épreuves projectives, le découpage<br />
psychopathologique se dessine ainsi. Plus de deux tiers des patients présentent une organisation névrotique<br />
entrant dans le cadre des variations de la normale, ou une organisation névrotique fragilisée. Les autres patients<br />
présentent des modes de fonctionnement psychique de type limite ou narcissique, plus ou moins fragilisés. Il n’y a<br />
aucun patient présentant une organisation psychotique. Des vignettes cliniques illustreront la présentation de cette<br />
diversité psychopathologique.<br />
4. Sabine Gaichies (Université Bordeaux 2), André Charles (Université Bordeaux2), Jean François<br />
Dartigues (INSERM U 593), Colette Fabrigoule (INSERM U593)<br />
Évolution de la santé subjective et de la perception des capacités cognitives chez des sujets déments :<br />
résultats de la cohorte PAQUID<br />
Contact : sabine.gaichies@voila.fr<br />
PAQUID est une enquête épidémiologique dans laquelle environ 4 000 personnes sont suivies à domicile depuis<br />
15 ans, tous les 2 ans en moyenne. Une détection active des cas de démences incidentes est effectuée à chaque<br />
suivi. Notre objectif était d’apprécier, chez 52 sujets déments, les profils d’évolution de la santé subjective et de la<br />
perception de ses propres capacités cognitives. Pour cela, nous avons étudié l’évolution de ces deux variables à<br />
trois périodes : au suivi précédent l’incidence de la démence de deux ou trois ans (T-1), à l’incidence (T0) et au<br />
suivi deux ou trois ans après (T1). La majorité des sujets (69,2 %) évaluent leur santé comme bonne au cours des<br />
trois suivis, et seulement 11,5 % considèrent que leur santé se dégrade au cours du temps. Pourtant, les résultats<br />
aux tests neuropsychologiques montrent qu’il existe au moins un déficit cognitif chez 88,5 % des sujets à I-1, et<br />
chez 100 % des sujets à I0 et I+1. Est-ce que ces sujets ne perçoivent pas - ou dénient - leurs déficits cognitifs, ou<br />
bien considèrent-ils la sphère cognitive comme indépendante du domaine de la santé ? En ce qui concerne la<br />
perception des capacités cognitives, 61,5 % des sujets se plaingnet à juste titre au cours des 3 suivis, et seulement<br />
3,8 % ne se plaignent jamais de leurs capacités cognitives, en présence de déficits. Enfin, 15,4 % des sujets n’ont<br />
aucune plainte à I-1, puis en ont au moins une à I0 et/ou à I+1 et 19,3 % des sujets n'ont pas de plainte cognitive à<br />
I0 et/ou à I+1. Ainsi, il semblerait que la perception du déficit cognitif ne soit pas vécue majoritairement comme<br />
synonyme de mauvaise santé, puisque bonne santé subjective et connaissance de déficits cognitifs représentent<br />
respectivement 3/4 et 3/5 des sujets. De plus, si la méconnaissance des troubles n’existe pas chez la majorité des<br />
sujets, un pourcentage non négligeable d'entre eux (23,1 %) ne reconnaît ni la présence des déficits cognitifs, ni<br />
l’évolution péjorative de ses capacités cognitives au cours du temps. Afin de mieux comprendre ces distorsions,<br />
nous étudierons les profils individuels d'évolution des sujets en fonction des relations entre santé subjective, plainte<br />
cognitive et déficits cognitifs.<br />
5. Geneviève Coudin (Université Paris 5)<br />
La réticence des aidants familiaux à recourir aux services de gérontologie : une approche psychosociale<br />
Contact : genevievecoudin@free.fr<br />
La mission des services d’aide professionnelle aux aidants de malades Alzheimer consiste à mettre en place des<br />
dispositifs destinés à répondre au mieux à leurs besoins. Problème reconnu comme critique par les acteurs du<br />
champ sanitaire et social, la réticence des aidants à utiliser les services représente un paradoxe sur lequel il y a<br />
lieu de s’interroger. Dans ce domaine de la recherche-action, la littérature sur l’aide informelle permet de repérer<br />
les impasses ayant mené à penser les offres de services. Le paradigme du stress coping dominant, s’avère<br />
réducteur. Des voies d’ouverture décrivent les deux aspects, instrumental et socio-affectif inhérents au rôle<br />
d’aidant et la gratification attachée à ce rôle. La réticence se situerait à l’interface de deux logiques d’aide<br />
divergentes. Car, si les services répondent aux besoins d’aide tangible, ils ne tiennent pas compte du travail de<br />
soutien à l’image de soi de l’aidé accompli par l’aidant. Cet aspect intangible de l’aide jugé essentiel par les<br />
aidants, fait qu’ils sont confrontés à un conflit douloureux entre besoins contradictoires de fonctionnalité et de<br />
maintien identitaire du proche. Une enquête qualitative sur la réticence à l’égard des services a été menée auprès<br />
de 27 aidants principaux. Les caractéristiques socioculturelles ont été contrôlées ainsi que le stade de la maladie.<br />
L’analyse montre que la réticence dépend d’abord des services, qu’elle peut être massive pour certains et sélective<br />
pour d’autres. C’est un phénomène complexe qui doit être contextualisé.<br />
50