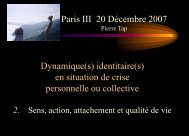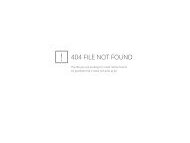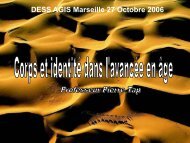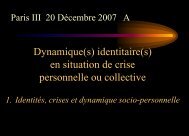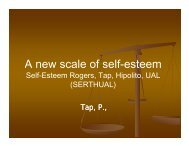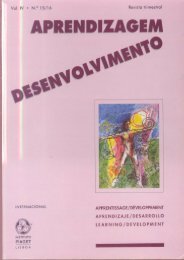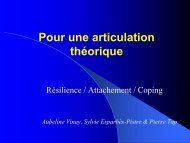Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. Laurent Guillet (Université de Bretagne Sud), Danièle Hermand (Université de Lille 3)<br />
Revue critique de la mesure du stress<br />
Contact : laurent.guillet@univ-ubs.fr<br />
L'objectif de cette revue de littérature est de fournir des informations à propos des instruments disponibles pour<br />
faciliter les procédures d'investigation sur l'évaluation du stress. Au travers de l'évolution du concept de stress, il<br />
s'agit de déterminer comment les apports de la recherche et des modélisations du stress ont permis de passer<br />
d'une mesure indirecte à une mesure directe du stress perçu. Il s'agit d'examiner les différentes méthodes<br />
d'évaluation du stress et de considérer les problèmes sous-jacents aux différentes techniques. Une analyse<br />
critique des questionnaires de stress des événements de vie majeurs, puis des questionnaires des événements de<br />
vie mineurs et celle des questionnaires de stress perçu permet de comprendre le passage d'une évaluation basée<br />
sur les événements à celle basée sur les composantes psychologiques au regard des événements, puis à celle<br />
portant sur la compréhension des processus cognitifs lors d'une évaluation de l'intensité de stress perçu. Le stress<br />
a d'abord été considéré comme un stimulus qui entraîne une manifestation due au stress. Notamment, Cannon<br />
(1932) et Meyer (1930) considèrent que les événements stressants entraînent des réactions physiologiques de<br />
protection pouvant provoquer des désordres psychologiques. Cette conception évolue avec les travaux de Lazarus<br />
(1980). Le stress n'est plus considéré comme un stimulus mais comme le résultat de l'action lié à la survenue du<br />
stimulus en tenant compte des composantes individuelles, situationnelles et sociales. Le développement d'un<br />
modèle transactionnel (Lazarus et Folkman, 1984) place le stress au sein d'une transaction particulière entre<br />
l'individu et son environnement. Cette approche implique des évaluations successives qui prennent en<br />
considération la vulnérabilité, les ressources individuelles et sociales pour déterminer les capacités de faire face à<br />
la situation aversive. Le recours à la théorie fonctionnelle de la cognition (Anderson, 1981, 1982, 1991, 2001)<br />
permet de comprendre les processus cognitifs en jeu lors de l'évaluation primaire et secondaire dans une situation<br />
de stress mettant en correspondance des facteurs personnels, sociaux et environnementaux. Compte tenu de ces<br />
évolutions conceptuelles, l'évaluation du stress s'inscrit d'abord dans une perspective physiologique au travers de<br />
la relation événement / maladies (Selye, 1956). Il s'agit alors d'une méthode de mesure indirect du stress (Holmes<br />
et Rahe, 1967). C'est par l'étude des événements majeurs que la mesure du stress est déterminée. Par opposition<br />
à la mesure du stress des événements de vie majeurs, les travaux de Lazarus orientent la mesure du stress<br />
comme résultante de variables perceptuelles, cognitives et personnelles (Dérogatis, 1980 ; Lazarus et al, 1981).<br />
Ceci permet de passer d’une évaluation de l’événement à des techniques de mesure des dimensions subjectives<br />
de l’événement perçu comme stressant (Cohen, Karmarck et Mermestein, 1983). Le paradigme de la mesure<br />
fonctionnelle a été utilisé comme cadre de référence pour modéliser le fonctionnement cognitif face à des<br />
contraintes environnementales et sociales (Guillet, Hermand, Mullet, 2002 ; Fouquereau, Fernandez, Mullet et<br />
Sorum, 2001). Cette méthode permet de déterminer les processus modérateurs en jeux lors de l'évaluation du<br />
stress perçu.<br />
4. Aure Veyssière (Université Paris 8 - Saint - Denis)<br />
Après la déportation : coping et réinsertion d’anciens résistants français<br />
Contact : olietaur@club-internet.fr<br />
La déportation marque une rupture nette dans la vie de l’individu ; elle menace non seulement son intégrité<br />
physique mais également son intégrité psychique et son appartenance sociale. La déportation scelle ainsi la<br />
dislocation de l’état de santé du concentrationnaire. Ses défenses précédentes deviennent alors inopérantes, voire<br />
néfastes et doit se mettre en place un nouveau répertoire de ressources assurant la survie (Bettelheim,<br />
1943/1979). Après des mois ou des années de détention, la destruction du système concentrationnaire libère les<br />
prisonniers. Les déportés, une fois de retour en France, sont-ils parvenus à se restaurer tant physiquement que<br />
psychiquement et socialement et, si oui, comment ? Nulle recherche ne s’est jusqu’à présent penchée sur les<br />
stratégies de coping mises en place par les déportés français à leur retour et pendant leur réinsertion. Cette<br />
communication présentera les résultats d’une recherche clinique que nous avons menée grâce à des entretiens<br />
semi-directifs auprès de 28 anciens déportés français, 14 femmes et 14 hommes, pour fait de Résistance. Une<br />
analyse de contenu, basée sur les stratégies de coping dégagées par Suedfeld, Krell, Wiebe & Steel (1997), révèle<br />
que nos participants mentionnent, pour cette période, près de trois fois plus de recours aux stratégies de coping<br />
centrées sur le problème que de recours aux stratégies de coping centrées sur l’émotion. La stratégie qui prévaut<br />
est la recherche du soutien social, qu’elle soit centrée sur le problème ou sur l’émotion. Leur répertoire de<br />
stratégies de coping centrées sur le problème se révèle aussi vaste que celui de stratégies centrées sur l’émotion.<br />
Après avoir développé ces principaux résultats, nous proposerons également une investigation de l’effet de la<br />
variable « Sexe ». L’expérience des survivants s'avère riche d’enseignements transposables à d’autres populations<br />
écartées d’une vie ordinaire par un événement potentiellement traumatique, comme une maladie à risque létal ou<br />
37