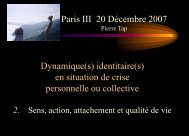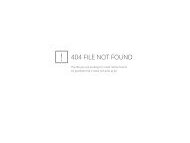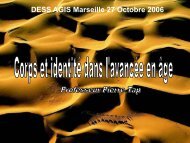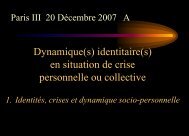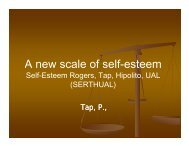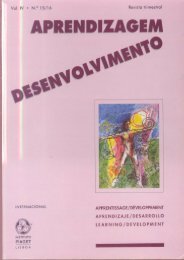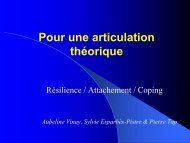Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
4B : Symposium Actualité des recherches qualitatives en psychologie de la santé :<br />
Travaux empiriques organisé par Marie Santiago Delefosse<br />
1. Marie Santiago Delefosse, (Université de Lausanne, Centre de Recherche en Psychologie de la Santé<br />
(CerPsa), Équipe de recherche « Psychologie Qualitative de la santé et de l'activité », UNIL, Lausanne, Suisse)<br />
État des travaux anglo-saxons, De la psychologie qualitative de la santé à la psychologie critique de la<br />
santé<br />
Contact : marie.santiago@unil.ch<br />
Le modèle classique et dominant en psychologie de la santé, bio-psycho-social, affirme s’intéresser aux<br />
articulations et/ou transactions entre ces trois niveaux, tout en proposant des travaux de recherche et/ou<br />
empiriques qui maintiennent ces trois niveaux dissociés (ou, au mieux, en proposant des reconstructions après<br />
coup des variables qui ont été dissociées). Depuis maintenant plus de vingt ans de nombreuses critiques ont fait<br />
l’objet de publications, estimant que, malgré l’intérêt de ce modèle classique, il se fonde sur un paradigme qui :<br />
- ignore la place de l’histoire tant dans l’organisation des institutions que dans la vie des sujets et, de ce fait,<br />
accorde une place tout à fait annexe au sens vécu et unique de chaque sujet<br />
- considère le « social » comme une simple variable que l’on peut ajouter ou retrancher selon les besoins de<br />
l’étude<br />
- néglige la place du corps et de l’activité comme celle de leurs fonctions autres que physiologiques (ou au<br />
mieux, cognitives)<br />
- considère les émotions comme des mécanismes d’ajustement de moindre valeur que les raisonnements<br />
logiques, et comme si leur fonction communicative, contextuelle et fonctionnelle n’avait aucune importance<br />
dans l’unité corporo-socio-psychologique des sujets<br />
- ne porte aucune attention à la place des chercheurs et à leurs présupposés sociaux, politiques et genrés dans<br />
leurs interventions de recherche<br />
- méconnaît la forte contextualité (historique, sociale, de classe, de genre) dans la constitution des institutions et<br />
les rapports de pouvoirs qui y sont inhérents.<br />
Nous présenterons ici une synthèse de ces travaux anglo-saxons qui ont débuté par une critique méthodologique<br />
se démarquant du « tout » quantitatif et de ses impasses, pour arriver à un exposé des travaux plus récents du<br />
courant de psychologie de la santé dit « critical » qui propose une réflexion théorique, sociale et politique<br />
dépassant le seul débat méthodologique.<br />
Ces travaux, loin d’être unitaires, indiquent une richesse de la réflexion en cours, mais ils présentent également un<br />
certain nombre de limites que l’exposé n’ignorera pas. Nous conclurons sur la nécessité de modèles réellement<br />
intégratifs, s’ancrant dans une épistémologie forte, situés dans des courants théoriques psychologiques clairement<br />
définis, et opérationnalisés par une méthodologie en accord avec leur objet de recherche. Seule cette triple<br />
exigence est à même de nous sortir des débats de confrontations stériles entre méthodes.<br />
Les exposés de travaux empiriques qui suivront cette présentation viendront argumenter de manière concrète le<br />
propos, chacun avec leur singularité et leur propre sensibilité théorico-méthodologique. Ils illustrent le<br />
développement croissant d’une Psychologie qualitative de la santé de langue française.<br />
2. Chantal Piot-Ziegler, N. Ruffiner-Boner, F. Fasseur, E. Castelao, M. Demierre, M-L. Sassi, J-D. Aubert , M.<br />
Pascual (Équipe IRIS, Santé et Société, Psychologie de la santé, et Équipe de recherche « Psychologie Qualitative<br />
de la santé et de l'activité », UNIL, Lausanne, Suisse,; Centre de Transplantation d’Organes, CHUV, Lausanne,<br />
Suisse)<br />
Étude qualitative des aspects psychologiques chez des patients en attentes de greffe (coeur, foie, poumon,<br />
rein)<br />
Contact : Chantal.Piot-Ziegler@unil.ch<br />
Peu d’études qualitatives longitudinales se sont penchées sur la période précédant la transplantation (Tx). Ces<br />
résultats rendent compte du vécu de 55 patients en attente de greffe d’organe (rein, n = 28 ; foie, n = 9 ; cœur, n =<br />
10 ; poumon, n = 8 ; age, m = 52,σ = 8.9) après leur mise en liste d’attente.<br />
Des entretiens semi-structurés ont été réalisés au domicile des patients ou dans un lieu de leur choix. Les<br />
entretiens ont été enregistrés, puis intégralement retranscrits. Une analyse qualitative thématique centrée sur leurs<br />
préoccupations existentielles a été réalisée.<br />
La Tx est décrite comme une possible renaissance et une accession à une meilleure qualité de vie. Dès<br />
l’évaluation pré-greffe, les patients endossent le rôle de bon patient et se décrivent comme ayant des<br />
prédispositions mentales positives, gérant les pensées négatives et ayant la volonté de se maintenir en bonne<br />
forme physique.<br />
39