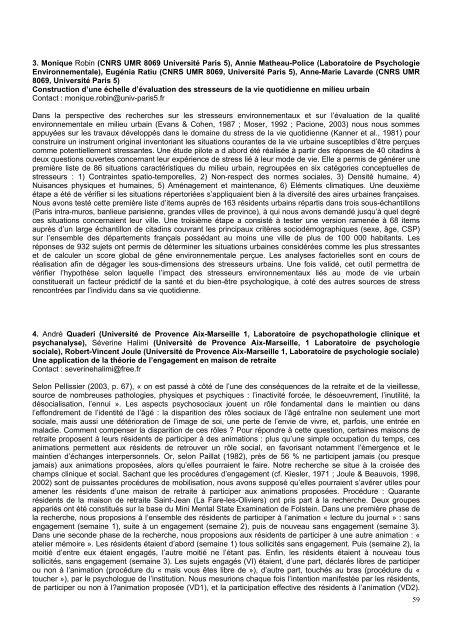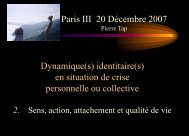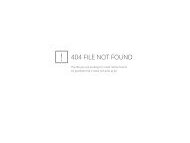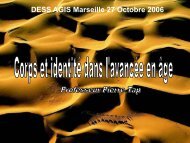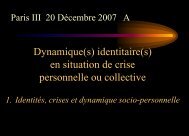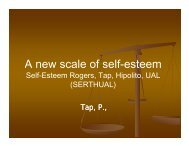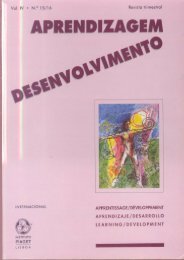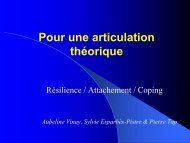Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
3. Monique Robin (CNRS UMR 8069 Université Paris 5), Annie Matheau-Police (Laboratoire de Psychologie<br />
Environnementale), Eugénia Ratiu (CNRS UMR 8069, Université Paris 5), Anne-Marie Lavarde (CNRS UMR<br />
8069, Université Paris 5)<br />
Construction d’une échelle d’évaluation des stresseurs de la vie quotidienne en milieu urbain<br />
Contact : monique.robin@univ-paris5.fr<br />
Dans la perspective des recherches sur les stresseurs environnementaux et sur l’évaluation de la qualité<br />
environnementale en milieu urbain (Evans & Cohen, 1987 ; Moser, 1992 ; Pacione, 2003) nous nous sommes<br />
appuyées sur les travaux développés dans le domaine du stress de la vie quotidienne (Kanner et al., 1981) pour<br />
construire un instrument original inventoriant les situations courantes de la vie urbaine susceptibles d’être perçues<br />
comme potentiellement stressantes. Une étude pilote a d abord été réalisée à partir des réponses de 40 citadins à<br />
deux questions ouvertes concernant leur expérience de stress lié à leur mode de vie. Elle a permis de générer une<br />
première liste de 86 situations caractéristiques du milieu urbain, regroupées en six catégories conceptuelles de<br />
stresseurs : 1) Contraintes spatio-temporelles, 2) Non-respect des normes sociales, 3) Densité humaine, 4)<br />
Nuisances physiques et humaines, 5) Aménagement et maintenance, 6) Eléments climatiques. Une deuxième<br />
étape a été de vérifier si les situations répertoriées s’appliquaient bien à la diversité des aires urbaines françaises.<br />
Nous avons testé cette première liste d’items auprès de 163 résidents urbains répartis dans trois sous-échantillons<br />
(Paris intra-muros, banlieue parisienne, grandes villes de province), à qui nous avons demandé jusqu’à quel degré<br />
ces situations concernaient leur ville. Une troisième étape a consisté à tester une version ramenée à 68 items<br />
auprès d’un large échantillon de citadins couvrant les principaux critères sociodémographiques (sexe, âge, CSP)<br />
sur l’ensemble des départements français possédant au moins une ville de plus de 100 000 habitants. Les<br />
réponses de 932 sujets ont permis de déterminer les situations urbaines considérées comme les plus stressantes<br />
et de calculer un score global de gêne environnementale perçue. Les analyses factorielles sont en cours de<br />
réalisation afin de dégager les sous-dimensions des stresseurs urbains. Une fois validé, cet outil permettra de<br />
vérifier l’hypothèse selon laquelle l’impact des stresseurs environnementaux liés au mode de vie urbain<br />
constituerait un facteur prédictif de la santé et du bien-être psychologique, à coté des autres sources de stress<br />
rencontrées par l’individu dans sa vie quotidienne.<br />
4. André Quaderi (Université de Provence Aix-Marseille 1, Laboratoire de psychopathologie clinique et<br />
psychanalyse), Séverine Halimi (Université de Provence Aix-Marseille, 1 Laboratoire de psychologie<br />
sociale), Robert-Vincent Joule (Université de Provence Aix-Marseille 1, Laboratoire de psychologie sociale)<br />
Une application de la théorie de l’engagement en maison de retraite<br />
Contact : severinehalimi@free.fr<br />
Selon Pellissier (2003, p. 67), « on est passé à côté de l’une des conséquences de la retraite et de la vieillesse,<br />
source de nombreuses pathologies, physiques et psychiques : l’inactivité forcée, le désoeuvrement, l’inutilité, la<br />
désocialisation, l’ennui ». Les aspects psychosociaux jouent un rôle fondamental dans le maintien ou dans<br />
l’effondrement de l’identité de l’âgé : la disparition des rôles sociaux de l’âgé entraîne non seulement une mort<br />
sociale, mais aussi une détérioration de l’image de soi, une perte de l’envie de vivre, et, parfois, une entrée en<br />
maladie. Comment compenser la disparition de ces rôles ? Pour répondre à cette question, certaines maisons de<br />
retraite proposent à leurs résidents de participer à des animations : plus qu’une simple occupation du temps, ces<br />
animations permettent aux résidents de retrouver un rôle social, en favorisant notamment l’émergence et le<br />
maintien d’échanges interpersonnels. Or, selon Paillat (1982), près de 56 % ne participent jamais (ou presque<br />
jamais) aux animations proposées, alors qu’elles pourraient le faire. Notre recherche se situe à la croisée des<br />
champs clinique et social. Sachant que les procédures d’engagement (cf. Kiesler, 1971 ; Joule & Beauvois, 1998,<br />
2002) sont de puissantes procédures de mobilisation, nous avons supposé qu’elles pourraient s’avérer utiles pour<br />
amener les résidents d’une maison de retraite à participer aux animations proposées. Procédure : Quarante<br />
résidents de la maison de retraite Saint-Jean (La Fare-les-Oliviers) ont pris part à la recherche. Deux groupes<br />
appariés ont été constitués sur la base du Mini Mental State Examination de Folstein. Dans une première phase de<br />
la recherche, nous proposions à l’ensemble des résidents de participer à l’animation « lecture du journal » : sans<br />
engagement (semaine 1), suite à un engagement (semaine 2), puis de nouveau sans engagement (semaine 3).<br />
Dans une seconde phase de la recherche, nous proposions aux résidents de participer à une autre animation : «<br />
atelier mémoire ». Les résidents étaient d’abord (semaine 1) tous sollicités sans engagement. Puis (semaine 2), la<br />
moitié d’entre eux étaient engagés, l’autre moitié ne l’étant pas. Enfin, les résidents étaient à nouveau tous<br />
sollicités, sans engagement (semaine 3). Les sujets engagés (VI) étaient, d’une part, déclarés libres de participer<br />
ou non à l’animation (procédure du « mais vous êtes libre de »), d’autre part, touchés au bras (procédure du «<br />
toucher »), par le psychologue de l’institution. Nous mesurions chaque fois l’intention manifestée par les résidents,<br />
de participer ou non à l?animation proposée (VD1), et la participation effective des résidents à l’animation (VD2).<br />
59