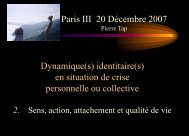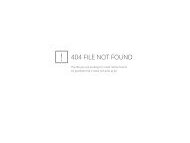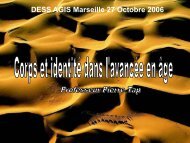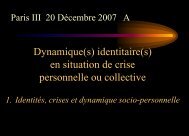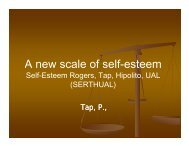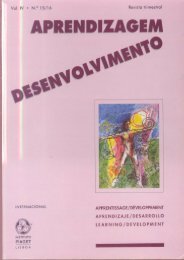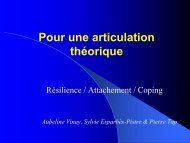Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
notions de charité et de don, reflet de l’évolution des pratiques et des cadres de pensée des champs médical<br />
et social.<br />
Lo Monaco Grégory (Université de Provence)<br />
Représentations sociales de l'alcool<br />
Contact : gregorylomonaco@hotmail.com<br />
C’est dans le cadre des représentations sociales (Moscovici, 1961) que nous avons étudié l’objet social «<br />
alcool » auprès d’une population de soixante étudiants de l’Université de Provence dont la moyenne d’âge<br />
était de 21 ans. Nous avons procédé par associations verbales et avons soumis les données à un traitement<br />
par analyse factorielle des correspondances (AFC) (Cibois, 1983 ; Doise, Clémence, Lorenzi-Cioldi, 1992,<br />
Deschamps, 2003). Par ailleurs, nous demandions également aux participants d’évaluer sur des échelles de<br />
type Lickert dans quelle mesure l’alcool pouvait être associé avec des émotions comme la joie, la tristesse,<br />
la peur, la honte, la colère, la surprise ou encore le dégoût. Nous pensions que les pratiques de<br />
consommation avaient un rôle dans la façon dont les participants se représentaient l’alcool. Or, du traitement<br />
par AFC il ressort que les trois premiers expliquent à eux seuls 77% de l’inertie totale et ces trois premiers<br />
facteurs sont la profession des parents (élevée vs faible), le sexe, le milieu d’habitation (urbain vs rural).<br />
Nous constatons que les espaces représentationnels mis en évidence par l’analyse sont différents selon les<br />
ancrages sociaux. En effet, et pour exemples, les étudiants dont les parents ont des professions d’un niveau<br />
bas associent plus l’alcool à l’alcoolisme et à la drogue alors que ceux dont les parents ont des professions<br />
d’un niveau élevé l’associent plus aux amis et au vin. Nous voyons donc deux univers bien différents. En<br />
effet, l’alcool semble bénéficier d’une connotation beaucoup plus positive dans un cas que dans l’autre.<br />
Notre hypothèse concernant le poids des pratiques est infirmée puisque ce facteur explique seulement<br />
0.25% de l’inertie totale. Concernant les associations avec les émotions, la variable « consommation »<br />
semble être décisive. En effet, en effectuant des traitements ANOVA, nous avons constaté que le rapport<br />
affectif à l’alcool était différent selon que les participants en consomment ou pas. Pour exemple, les<br />
consommateurs associent moins l’alcool à la peur que les non consommateurs (F=5.997 ; p