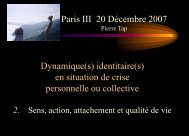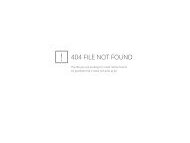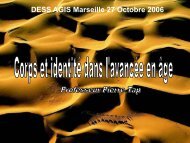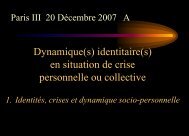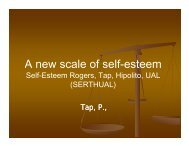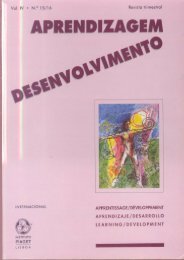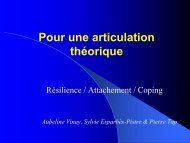Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Programme congres - Pierre TAP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Inégalités de santé et facteurs comportementaux dans une population de 553 635 personnes en<br />
situation de précarité<br />
Contact : jean-jacques.moulin@cetaf.cnamts.fr<br />
Objectif. Comparer des indicateurs d’état de santé et de comportements parmi les personnes en situation de<br />
précarité et les personnes non précaires examinées dans les Centres d'examens de santé de la CNAMTS<br />
de 1995 à 2002. Méthodes. Les populations précaires (553 635 personnes : chômeurs, bénéficiaires du<br />
revenu minimum d’insertion (RMI), personnes sous contrats emplois-solidarité (CES) personnes sans<br />
domiciles fixe (SDF)) sont comparées à une population de référence (516 607 personnes échantillonnées<br />
aléatoirement parmi les autres consultants des Centres d'examens de santé, et stratifiées sur le sexe,<br />
l’année d’examen et la région d’habitation). Les données ont été recueillies selon les procédures<br />
standardisées d’examen des Centres d'examens de santé : questionnaire sur les comportements et l’accès<br />
aux soins, examen médical et dentaire. L’analyse statistique repose sur le modèle logistique multivarié (odds<br />
ratios (OR) et intervalles de confiance à 95% (IC 95%)). Résultats. Tous les indicateurs sont<br />
significativement altérés dans toutes les catégories de précaires. Les OR les plus élevés sont observés<br />
parmi les SDF pour le non suivi médical ou dentaire (femmes : OR 11,65 IC 95% [9,85-13,8]) et la présence<br />
de caries dentaires non traitées (femmes : 2,41 [2,19-2,65]), parmi les CES pour la maigreur (hommes : 2,25<br />
[2,07-2,45]), dans le groupe RMI pour le tabagisme (hommes : 2,67 [2,63-2,72]), parmi les chômeurs pour le<br />
mauvais état de santé perçue (hommes : 1,62 [1,60-1,64]) et l’obésité (femmes : 1,56 [1,53-1,59]). Les OR<br />
de l’hypertension artérielle sont significativement inférieurs à l’unité parmi les SDF (hommes : 0,74 [0,66-<br />
0,83], femmes : 0,87 [0,66 1,14]). Ces prévalences ont tendance à diminuer entre 1995 et 2002 dans les<br />
deux populations, à l’exception de l’obésité, de la maigreur et du non suivi gynécologique qui augmentent<br />
significativement. Conclusion. La politique de la CNAMTS priorisant l’examen de santé vis-à-vis des<br />
personnes en situation de précarité a permis de voir des personnes ayant un état de santé significativement<br />
plus altéré dans de nombreux domaines. L’évaluation de ces politiques visant à corriger les altérations de<br />
santé et à favoriser la réinsertion sociale des publics en difficulté reste à faire.<br />
Durozard, Carole (Université Blaise Pascal), Izaute, Marie (Université Blaise Pascal, LAPSCO), Chiotti,<br />
Blandine (Université Blaise Pascal)<br />
La réinsertion sociale des traumatisés crâniens : perception du soutien social et du locus de<br />
contrôle.<br />
Contact : carole.durozard@laposte.net<br />
Cette étude a un double objectif : étudier la réinsertion sociale de cette population trois à cinq années post-accident et<br />
déterminer dans quelle mesure des variables telles que le locus de contrôle ou le soutien social perçu peuvent influer la<br />
réussite de ce retour à la vie sociale. Quarante-six personnes admises dans les services de neuro réanimation du CHU<br />
de Clermont-Ferrand suite à un traumatisme crânien ont été interrogées. Le degré de réinsertion des participants a été<br />
estimé à l'aide du critère de reprise professionnelle. Ainsi, deux groupes peuvent être constitués : le groupe des patients<br />
"faiblement réinsérés" et le groupe des patients "fortement réinsérés". Les résultats montrent que trois à cinq années<br />
post-traumatisme crânien, seul un traumatisé crânien sur deux a réussi sa réinsertion socio professionnelle. Cette<br />
réussite est associée à la perception d'un soutien social et à un locus de contrôle peu externe. En effet, si dans les deux<br />
groupes, le nombre de personnes disponibles pour fournir une aide est plus faible que dans la population tout venant, les<br />
participants "fortement réinsérés" ont rapporté une plus grande satisfaction par rapport au soutien social que les<br />
participants "faiblement réinsérés". Concernant le locus de contrôle, nous avons montré que les personnes victimes d'un<br />
traumatisé crânien sont globalement moins internes que la population générale. Par contre, ceux qui ont réussi leur<br />
réinsertion obtiennent un score inférieur à celui des participants "faiblement réinsérés" sur les dimensions "chance" et<br />
"pouvoir d'autrui". Ces derniers expliquent plus ce qu'il leur arrive par des facteurs extérieurs relativement incontrôlables<br />
et tendent à ne pas établir de lien entre leurs compétences ou leurs comportements et les renforcements qu'ils reçoivent.<br />
Les résultats de cette étude ont des implications importantes dans les stratégies de réadaptation et les modalités de<br />
suivi des personnes victimes d'un traumatisme crânien.<br />
Eyssartier, Chloé (Université d'Aix-Marseille 1), Guimelli, Christian (Université d'Aix-Marseille1), Joule,<br />
Robert-Vincent (Université d'Aix-Marseille1)<br />
Représentation sociale et engagement : une application au don d’organes<br />
Contact : chloe.eyssartier@wanadoo.fr<br />
Les campagnes de sensibilisation sur le don d’organes sont basées sur l’idée selon laquelle une attitude<br />
favorable au don d’organes débouche sur le comportement attendu : signer une carte de donneur. Or<br />
Baluch, Randhawa, Holmes et Duffy (2001) ont montré qu’il n’y a pas de corrélation entre l’attitude que l’on<br />
peut avoir envers le don d’organe et la décision de signer ou de ne pas signer une carte de donneur. Si<br />
l’information et la persuasion sont nécessaires, elles ne sont pas suffisantes. Les travaux réalisés dans le<br />
cadre de la théorie de l’engagement, et notamment dans le cadre du paradigme du pied-dans-la porte<br />
37