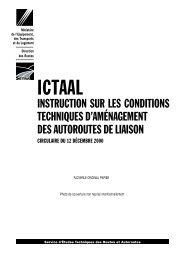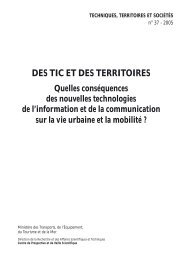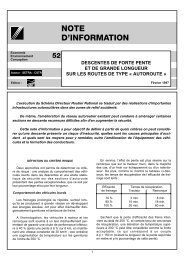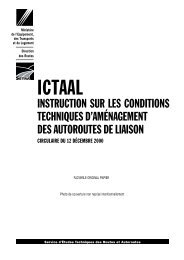Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
étudiée. Le concept <strong>de</strong> communauté conditionne<br />
bien souvent les étu<strong>de</strong>s sur les phénomènes <strong>de</strong><br />
sociabilité en ligne. Employé à tort et à raison, il reste<br />
un concept flou. Aussi ne pouvons-nous faire<br />
l’économie d’une analyse exploratoire <strong>de</strong> ce concept<br />
afin <strong>de</strong> déterminer sa validité opératoire dans le cadre<br />
<strong>de</strong> notre propre étu<strong>de</strong>. Nous verrons que le concept<br />
<strong>de</strong> « public » permet <strong>de</strong> renouveler avantageusement<br />
l’approche sur les espaces <strong>de</strong> sociabilité virtuels.<br />
Les usagers <strong>de</strong>s jeux vidéo en ligne<br />
forment-ils une « communauté » ?<br />
On ne peut envisager <strong>de</strong> parler <strong>de</strong> « communauté<br />
» sans revenir plus précisément sur les<br />
écrits <strong>de</strong> Ferdinand Tönnies, dont les travaux sont<br />
souvent évoqués, mais rarement étudiés.<br />
Ce théoricien allemand, qui a développé sa<br />
pensée dans le contexte <strong>de</strong> la République <strong>de</strong> Weimar,<br />
est à l’origine <strong>du</strong> couple d’opposition « communauté<br />
» versus « société ». Cette dichotomie renvoie à<br />
la thèse <strong>de</strong> Tönnies selon laquelle on passerait<br />
progressivement, dans le développement <strong>de</strong>s civilisations,<br />
<strong>de</strong> la communauté à la société. Ce mouvement<br />
suivrait le progrès <strong>du</strong> rationalisme et <strong>de</strong> l’Aufklärung.<br />
Tönnies voit dans la « société » le règne <strong>du</strong> principe<br />
d’organisation, alors que la « communauté » est<br />
davantage placée sous le signe <strong>de</strong> la conscience d’un<br />
« être ensemble ».<br />
La vision linéaire <strong>du</strong> passage <strong>de</strong> la communauté à<br />
la société, telle que Tönnies la présente, ne résiste<br />
cependant pas à l’examen <strong>de</strong>s pratiques politiques.<br />
L’Europe <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième moitié <strong>du</strong> XX e siècle en est ici<br />
une illustration remarquable : rappelons en effet que<br />
les rédacteurs <strong>du</strong> Traité <strong>de</strong> Paris (1951) ainsi que <strong>de</strong><br />
celui <strong>de</strong> Rome (1957) utilisent délibérément le vocable<br />
« communauté » pour désigner l’organisation alors en<br />
train d’être créée. L’emploi <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong><br />
communauté peut ici être appréhendé comme une<br />
volonté <strong>de</strong> dépasser le concept d’État-Nation<br />
fortement corrompu par la Secon<strong>de</strong> Guerre mondiale.<br />
Était ainsi soulignée l’unité organisationnelle <strong>de</strong><br />
peuples dont on entendait qu’ils ne <strong>de</strong>vaient plus se<br />
penser dans le seul cadre national. On peut y voir un<br />
changement <strong>de</strong> paradigme dans la façon <strong>de</strong> penser les<br />
organisations étatiques et l’unité d’une nation, qui, en<br />
se référant à Tönnies, renverrait pourtant au principe<br />
d’organisation, c’est-à-dire, à une organisation <strong>de</strong>vant<br />
succé<strong>de</strong>r à celle <strong>de</strong> la « communauté ». Autrement dit,<br />
le mon<strong>de</strong> politique a retenu la distinction <strong>de</strong> Tönnies<br />
entre « communauté » et « société » mais a inversé<br />
librement l’ordre diachronique et hiérarchique <strong>de</strong>s<br />
<strong>de</strong>ux modèles.<br />
Les jeux vidéo en ligne<br />
Aussi, est-il nécessaire, <strong>de</strong> considérer<br />
« communauté » et « société » davantage comme<br />
<strong>de</strong>ux idéals-types, comme le fera ensuite Max Weber<br />
dans son étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> ce qu’il appelle la « communalisation<br />
» 4 . Autrement dit, il faut envisager<br />
« communauté » et « société » comme les <strong>de</strong>ux faces<br />
<strong>de</strong> Janus, <strong>de</strong>s types « purs » ne pouvant être<br />
retrouvés dans la réalité sociologique. Max Weber se<br />
gar<strong>de</strong>ra ainsi <strong>de</strong> séparer strictement société et<br />
communauté, dont il ne donnera d’ailleurs pas <strong>de</strong><br />
définitions précises. Il écrit ainsi :<br />
« [Les communautés] sont <strong>de</strong>s structures extrêmement<br />
diverses – plus ou moins amorphes et sociétisées, plus<br />
ou moins continues ou discontinues, plus ou moins<br />
ouvertes ou fermées » 5 .<br />
On retiendra <strong>de</strong>s <strong>de</strong>scriptions <strong>de</strong>s différents<br />
types <strong>de</strong> communautés selon Max Weber, que dans la<br />
communauté existe un sentiment <strong>de</strong> l’être ensemble,<br />
ou <strong>du</strong> moins une « tendance » <strong>de</strong> cet être ensemble,<br />
voire plus simplement le sentiment d’avoir « quelque<br />
chose en commun ». De même, selon Weber, une<br />
communauté peut se former selon différentes<br />
logiques et critères : par exemple, pour reprendre les<br />
catégories weberiennes, la nécessité d’élever ses<br />
enfants, dans la communauté mère-enfant, un<br />
sentiment émotionnel dans les communautés<br />
religieuses, l’idée d’un <strong>de</strong>stin commun dans les<br />
communautés politiques, une couleur <strong>de</strong> peau ou<br />
une langue dans le cas <strong>de</strong>s communautés ethniques,<br />
chaque motif ne créant pas <strong>de</strong> fait la communauté,<br />
mais étant davantage susceptible <strong>de</strong> la créer ou <strong>de</strong> la<br />
renforcer. De même certains motifs peuvent s’additionner<br />
et ainsi superposer plusieurs communautés.<br />
Ce qui ressort <strong>de</strong> l’analyse <strong>de</strong> Max Weber, c’est que la<br />
communauté peut tenir, tant <strong>de</strong> l’unité autour d’un<br />
élément concret (par exemple la couleur <strong>de</strong> peau)<br />
que plus vaguement d’un système <strong>de</strong> valeurs<br />
partagées ou <strong>de</strong> relations plus ou moins imposées.<br />
Max Weber met en valeur <strong>de</strong> plus l’étroite<br />
proximité entre plusieurs définitions d’une même<br />
structure. L’auteur montre dans sa <strong>de</strong>scription <strong>de</strong>s<br />
« communautés domestiques » que celles-ci pouvaient<br />
prendre la forme d’une entreprise ayant pour<br />
but le profit. On est ainsi face à un corps social qui<br />
pro<strong>du</strong>it <strong>de</strong>s biens (« communauté <strong>de</strong> biens ») ou qui<br />
gère <strong>de</strong>s rentes (« communauté <strong>de</strong> gestion »), lequel<br />
peut être analysé selon les critères <strong>de</strong> la science<br />
économique, et qui en même temps ne s’oppose pas<br />
pour autant à sa qualité <strong>de</strong> « famille » (plus ou moins<br />
éten<strong>du</strong>e). Autrement dit, la communauté <strong>de</strong> sang<br />
peut être en quelque sorte « doublée » par une autre<br />
dimension <strong>de</strong> cette communauté, où prime<br />
l’entretien <strong>de</strong> la structure en question.<br />
4 C’est en tant qu’idéal-type que Max Weber utilisera le concept <strong>de</strong> « communauté » dans son ouvrage Économie et Société. Il revient longuement sur<br />
les différents types <strong>de</strong> communauté : <strong>de</strong> la communauté <strong>de</strong> base qu’est la relation entre l’enfant et la mère, à la « communauté <strong>de</strong> marché », cette<br />
forme <strong>de</strong> communauté étant fortement rationalisée, avec, pour point central <strong>de</strong> la « communalisation », l’argent. Max Weber écrit ainsi : « L’action<br />
<strong>de</strong> l’argent est communalisante <strong>du</strong> fait <strong>de</strong>s rapports d’intérêts réels entre les gens intéressés, actuellement ou potentiellement, au marché ou au paiement.<br />
[…] La communauté <strong>de</strong> marché en tant que telle est le plus impersonnel <strong>de</strong>s rapports <strong>de</strong> la vie pratique dans lesquels les hommes peuvent se trouver. »<br />
(Économie et Société. – Tome II. – Paris, Plon/Pocket, 1995 (tra<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> : Wirtschaft und Gesellschaft. – Tübingen : Mohr, 1956), p. 411).<br />
5 Max Weber – Économie et Société. – Tome II. – Paris, Plon/Pocket, 1995 (tra<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> Wirtschaft und Gesellschaft. – Tübingen : Mohr, 1956), p. 410.<br />
257