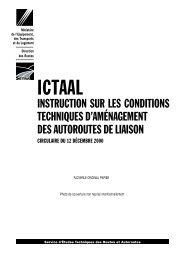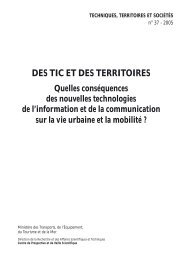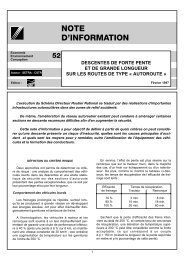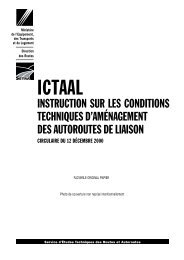Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Intro<strong>du</strong>ction<br />
En 1995, la DRAST a pris la décision – à l’initiative <strong>de</strong> Clau<strong>de</strong> Lamure1 et <strong>du</strong> Centre <strong>de</strong><br />
Prospective et <strong>de</strong> Veille Scientifique – <strong>de</strong> lancer une réflexion sur l’évolution <strong>de</strong>s technologies<br />
<strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong> la communication, et sur leurs conséquences – en termes <strong>de</strong><br />
priorités <strong>de</strong> recherche – sur le ministère <strong>de</strong> l’Équipement, <strong>de</strong>s Transports et <strong>du</strong> Logement.<br />
Cette réflexion a pris la forme <strong>de</strong> <strong>de</strong>ux « Ateliers <strong>de</strong> prospective technologique » successifs,<br />
portant d’abord sur les conséquences <strong>de</strong>s TIC pour les métiers <strong>de</strong> l’Équipement, puis sur les<br />
impacts territoriaux ou sociétaux <strong>de</strong> ces nouvelles technologies.<br />
Le premier atelier, présidé par René Mayer, ancien Directeur général <strong>de</strong> l’Institut<br />
Géographique National, a commencé ses travaux fin 1995, pour les achever par un colloque<br />
rassemblant une centaine d’acteurs publics et privés en novembre 1996.<br />
Le second, démarré fin 1997 et organisé autour d’une douzaine <strong>de</strong> séances, a remis ses premières<br />
conclusions en octobre 1999, propositions qui ont ensuite été reprises et réactualisées au<br />
cours <strong>de</strong> l’année 2003. Il était animé et présidé par André-Yves Portnoff, Directeur <strong>de</strong><br />
l’Observatoire <strong>de</strong> la « révolution <strong>de</strong> l’intelligence » au sein <strong>du</strong> groupe Futuribles, par ailleurs<br />
ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>du</strong> Club Crin-prospective.<br />
Dans les <strong>de</strong>ux cas, les métho<strong>de</strong>s <strong>de</strong> travail ont été très différentes : réflexion collective en petit<br />
groupe autour d’une grille <strong>de</strong> hiérarchisation pour le premier ; audition d’experts, débats, puis<br />
élaboration <strong>de</strong> scénarios et d’enjeux prioritaires pour le second. Les <strong>de</strong>ux approches ont néanmoins<br />
comme caractéristique commune <strong>de</strong> déboucher sur <strong>de</strong>s préconisations relativement claires<br />
qui, semble-t-il, n’ont pas per<strong>du</strong> toute leur pertinence – malgré la rapidité <strong>de</strong>s changements techniques<br />
qui se sont pro<strong>du</strong>its dans la <strong>de</strong>rnière décennie.<br />
Centré sur la mo<strong>de</strong>rnisation <strong>de</strong>s métiers et <strong>de</strong>s outils <strong>de</strong> conception, le rapport <strong>de</strong> René<br />
Mayer met en avant trois gran<strong>de</strong>s priorités : les bases <strong>de</strong> données et systèmes d’information géographiques,<br />
les modèles <strong>de</strong> représentation ou outils <strong>de</strong> réalité virtuelle, et enfin les techniques<br />
<strong>de</strong> groupware et d’ingénierie concourante. Faites, il faut le rappeler, en 1996, ces recommandations<br />
restent sans aucun doute d’actualité pour tout le réseau <strong>de</strong> recherche et d’expertise <strong>du</strong><br />
ministère <strong>de</strong> l’Équipement. On remarque également le plaidoyer très fort qui y est fait – c’était<br />
il y a dix ans – pour « l’intelligence économique » et pour une implication plus volontariste <strong>de</strong><br />
la France dans la normalisation européenne.<br />
Plus ambitieux dans ses objectifs – puisqu’il s’agit d’analyser toutes les implications <strong>de</strong>s<br />
NTIC en termes <strong>de</strong> mo<strong>de</strong> <strong>de</strong> vie et d’aménagement <strong>du</strong> territoire – le rapport d’André-Yves<br />
Portnoff débouche naturellement sur <strong>de</strong>s messages plus difficiles à synthétiser. Parmi la centaine<br />
d’applications considérées par le document, un accent particulier est mis sur les outils <strong>de</strong> traçabilité<br />
et <strong>de</strong> localisation, l’interopérabilité <strong>de</strong>s réseaux, l’utilisation <strong>de</strong>s « moteurs intelligents <strong>de</strong><br />
recherche », les connexions haut débit ou les systèmes pour <strong>du</strong> « sur-mesure <strong>de</strong> masse ». Comme<br />
dans le document précé<strong>de</strong>nt, une attention spécifique est portée au croisement entre outils techniques<br />
et domaines <strong>de</strong> politiques publiques. Écrite <strong>de</strong>ux ans après l’achèvement <strong>de</strong> l’atelier, cette<br />
synthèse a l’avantage <strong>de</strong> prendre en compte les évolutions techniques les plus récentes.<br />
On mesure à travers les travaux <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux ateliers à quel point les technologies <strong>de</strong> l’information<br />
et <strong>de</strong> la communication auront été une révolution pour les champs d’intervention<br />
<strong>du</strong> ministère <strong>de</strong> l’Équipement – la mobilité, les transports, l’habitat, la vie urbaine… - une<br />
révolution qui n’est pourtant encore que dans sa première étape. Face à un ensemble <strong>de</strong> transformations<br />
aussi difficiles et globales, la difficulté pour la recherche – et pour la prospective –<br />
était <strong>de</strong> trouver quelques points d’appui concrets : c’est le mérite <strong>de</strong> ces <strong>de</strong>ux rapports <strong>de</strong> proposer<br />
finalement <strong>de</strong>s pistes d’application en nombre suffisamment restreint pour permettre <strong>de</strong><br />
s’orienter raisonnablement dans l’action.<br />
1 À cette époque, chargé <strong>de</strong> mission auprès <strong>du</strong> Directeur <strong>de</strong> la DRAST, après avoir été Directeur général adjoint et<br />
Directeur scientifique <strong>de</strong> l’INRETS.<br />
311