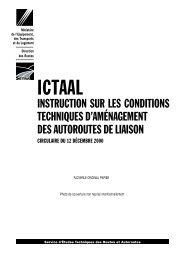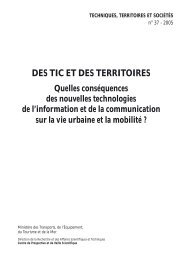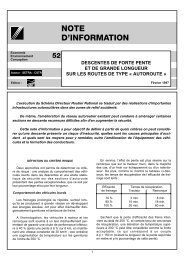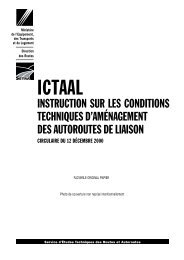Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
210<br />
Mais avant d’analyser ces outils, examinons les<br />
différents <strong>de</strong>grés <strong>de</strong> concertation.<br />
1. Échelle d’Arnstein<br />
Il y a déjà plusieurs années (1969), Arnstein a<br />
fourni une échelle sur l’implication <strong>de</strong>s citoyens<br />
dans les prises <strong>de</strong> décisions concernant l’aménagement.<br />
Cette échelle (figure n° 1), reprise par<br />
Kingston (1998) et par d’autres (Laurini 2001, Craig<br />
et al. 2002, Prosperi 2004, Hansen 2004, etc.), donne<br />
un certain nombre <strong>de</strong> niveaux correspondant à<br />
différentes philosophies <strong>de</strong> participation, <strong>de</strong>puis<br />
l’absence <strong>de</strong> participation jusqu’à la co-décision. En<br />
fait, le premier niveau correspond à la possibilité<br />
d’objecter ou <strong>de</strong> prononcer un désaccord sans que<br />
les déci<strong>de</strong>urs en tiennent compte. Ensuite, on trouve<br />
différents <strong>de</strong>grés d’information et d’organisation <strong>de</strong><br />
la participation, puis finalement la possibilité <strong>de</strong>s<br />
citoyens d’être co-déci<strong>de</strong>urs <strong>de</strong> leur sort. En d’autres<br />
termes, il s’agit <strong>du</strong> niveau le plus élevé <strong>de</strong><br />
démocratie participative. Dans cette échelle d’implication,<br />
la situation française tendrait plutôt vers les<br />
<strong>de</strong>grés les plus bas.<br />
• Le public a le droit <strong>de</strong> savoir ; en d’autres termes,<br />
il existe <strong>de</strong>s procé<strong>du</strong>res officielles d’annonce au<br />
public, sans plus. C’est le niveau le plus bas et<br />
aucun dossier détaillé n’est porté à la connaissance<br />
<strong>du</strong> public.<br />
• Le public a le droit d’être informé ; c’est le niveau<br />
suivant dans lequel <strong>de</strong>s dossiers plus précis et<br />
détaillés peuvent être consultés.<br />
• Le public a le droit <strong>de</strong> s’opposer ; dans les textes<br />
officiels, il est autorisé que <strong>de</strong>s particuliers ou <strong>de</strong>s<br />
associations puissent faire connaître leur<br />
opposition au projet ; les déci<strong>de</strong>urs peuvent<br />
ensuite bien évi<strong>de</strong>mment outrepasser ces<br />
opinions. En d’autres termes, cela peut apparaître<br />
parfois comme une « concertation alibi ».<br />
• La participation <strong>du</strong> public dans les définitions<br />
<strong>de</strong>s intérêts <strong>de</strong>s acteurs et <strong>du</strong> choix <strong>du</strong><br />
calendrier ; c’est un niveau un peu plus élevé dans<br />
la concertation avec les usagers.<br />
• La participation <strong>du</strong> public dans l’analyse <strong>de</strong>s<br />
conséquences et <strong>de</strong>s décisions recommandées.<br />
C’est le niveau suivant <strong>de</strong> la concertation et<br />
l’amorce d’un véritable dialogue entre les<br />
déci<strong>de</strong>urs et les usagers ; ici d’ailleurs, les usagers<br />
commencent à <strong>de</strong>venir <strong>de</strong>s citoyens <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième<br />
catégorie, c’est-à-dire qu’ils ont voix au chapitre<br />
sans aucun pouvoir <strong>de</strong> peser sur les décisions.<br />
• La participation <strong>du</strong> public dans la décision finale ;<br />
la décision finale n’est pas prise uniquement par les<br />
élus, mais aussi par les citoyens, suite par exemple à<br />
un vote <strong>de</strong> type référen<strong>du</strong>m local.<br />
Robert Laurini<br />
2. Catégorisations<br />
<strong>de</strong>s systèmes informatiques<br />
Dans les processus participatifs, les nouvelles<br />
technologies <strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong> la communication<br />
peuvent ou pourraient être utilisées à<br />
plusieurs niveaux notamment lors <strong>de</strong>s enquêtes<br />
publiques (Laurini 2001 et 2002).<br />
• Classiquement <strong>de</strong>s cartes sont affichées contre <strong>de</strong>s<br />
murs, comme dans une sorte d’exposition avec<br />
également <strong>de</strong>s commentaires ou <strong>de</strong>s argumentaires<br />
sur les options, <strong>de</strong>s aspects historiques et<br />
prospectifs. Dans cet esprit, ces cartes pourraient<br />
être organisées en hypercartes dans un site web.<br />
• Au lieu <strong>de</strong> se limiter à <strong>de</strong>s plans à <strong>de</strong>ux dimensions,<br />
la troisième dimension pourrait être utilisée. En<br />
effet, beaucoup <strong>de</strong> personnes ont <strong>de</strong>s difficultés à<br />
se situer et à comprendre les cartes et les plans.<br />
Dans cette optique, <strong>de</strong>s images <strong>de</strong> synthèse, <strong>de</strong>s<br />
images <strong>de</strong> réalité augmentée ou <strong>de</strong>s hologrammes<br />
favoriseraient une meilleure compréhension <strong>de</strong>s<br />
décisions futures.<br />
•Un forum <strong>de</strong> discussion (chat forum) pourrait<br />
être mis en place. Les citoyens seraient à même <strong>de</strong><br />
dialoguer entre eux et avec <strong>de</strong>s élus. Ce type <strong>de</strong><br />
dialogue pourrait rapprocher les citoyens, leur<br />
faire mieux sentir les problématiques et forcer les<br />
élus à étayer leurs choix et leurs argumentations.<br />
•Un système <strong>de</strong> simulation pourrait être mis en<br />
place grâce à un système d’information géographique<br />
avec <strong>de</strong>s outils d’analyse spatiale. Certes, il<br />
ne s’agit pas <strong>de</strong> proposer la panoplie totale <strong>de</strong>s outils<br />
d’analyse spatiale que l’on trouve classiquement<br />
dans les systèmes d’information géographiques,<br />
mais d’offrir un sous-système permettant aux<br />
citoyens <strong>de</strong> visualiser les conséquences <strong>de</strong> questions<br />
simples <strong>du</strong> style « quelles seraient les conséquences<br />
si la ville où j’habite augmentait sa population <strong>de</strong><br />
50 % ? », ou même les conséquences au cas où l’on<br />
ne ferait rien à horizon <strong>de</strong> dix ans.<br />
•Un système d’argumaps, c’est-à-dire d’annotations<br />
positionnées dans la carte, pourrait<br />
avantageusement rénover l’obsolète cahier <strong>du</strong><br />
commissaire-enquêteur ; dans un tel système, les<br />
citoyens donnent leurs avis (pour ou contre) avec<br />
éventuellement <strong>de</strong>s commentaires et les localisent<br />
dans la carte. Ainsi, on dispose d’une spatialisation<br />
<strong>de</strong>s opinions et leur synthèse en est doublement<br />
facilitée. On peut remarquer que <strong>du</strong> point <strong>de</strong> vue<br />
technique, ces avis peuvent aisément être<br />
multimédias, <strong>du</strong> style commentaires vocaux par<br />
exemple.<br />
a) Organisation <strong>de</strong>s informations en hypercartes<br />
Les hypercartes (Laurini 2001) sont aux cartes ce<br />
que les hyperdocuments sont aux documents. Il s’agit