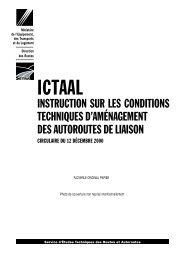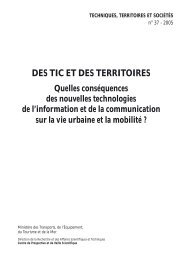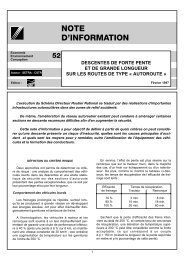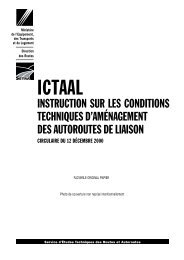Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Figures socio-spatiales <strong>de</strong> l’appropriation d’Internet<br />
les plus éloignées, entre celles qui célèbrent les<br />
bienfaits <strong>de</strong> la technique, <strong>de</strong> l’innovation et <strong>du</strong><br />
progrès technologique en général et celles qui<br />
entrevoient et dénoncent, parfois avec lyrisme et<br />
virulence, l’aveuglement contemporain face à une<br />
prochaine et inéluctable catastrophe.<br />
Il est assez courant, lorsque l’on entreprend <strong>de</strong><br />
travailler sur la question <strong>de</strong>s TIC, <strong>de</strong> renvoyer ces<br />
<strong>de</strong>ux positions dos à dos, en les excluant <strong>du</strong> champ <strong>de</strong><br />
la recherche sérieuse le cas échéant, mais en s’épargnant<br />
assez souvent le soin <strong>de</strong> démontrer en quoi ces<br />
travaux sont utiles, idéologiques, intéressants et peu<br />
convaincants.<br />
Nous avons choisi ici <strong>de</strong> ne pas nous épargner ce<br />
soin. Il ne s’agit pas pour autant <strong>de</strong> revisiter toute<br />
cette littérature, pas davantage <strong>de</strong> prendre argument<br />
<strong>de</strong> telle ou telle proposition ou formulation fragile<br />
(dans le genre <strong>de</strong> ce qui a été au cœur <strong>de</strong> la controverse<br />
Sokal, Bricmont), mais <strong>de</strong> montrer ce en quoi<br />
la déficience <strong>de</strong> prise en compte <strong>de</strong>s réalités géographiques<br />
(dans lesquelles nous inclurons <strong>de</strong> façon<br />
provisoirement impérialiste les réalités sociales)<br />
obère gravement les conclusions auxquelles ils<br />
parviennent. Nous nous sommes ici volontairement<br />
limités à un corpus ré<strong>du</strong>it, ne serait-ce que parce que<br />
cette littérature est abondante et fortement<br />
médiatisée. Dans la mesure où cette analyse critique<br />
n’est pas le fon<strong>de</strong>ment <strong>de</strong> notre démarche mais un<br />
exercice <strong>de</strong> type heuristique, il n’était pas question <strong>de</strong><br />
faire ici tentative d’exhaustivité.<br />
2. Les dynamiques sociales<br />
et la question <strong>de</strong>s usagers<br />
La figure <strong>de</strong> l’usager <strong>de</strong>s TIC comme acteur <strong>de</strong><br />
l’innovation commence à s’imposer dans les travaux<br />
<strong>de</strong> recherche en France autour <strong>de</strong>s années 1980. Cette<br />
évolution était toutefois engagée <strong>de</strong>puis plus<br />
longtemps dans d’autres pays tels que l’Allemagne où<br />
se faisait jour « <strong>de</strong>puis le milieu <strong>de</strong>s années 70, une<br />
conception <strong>de</strong> la technique comme construction<br />
sociale. Des formulations telles que « technogenèse »,<br />
« systèmes sociotechniques » (Ropohl, 1979),<br />
« détermination <strong>de</strong> la technique par le contrat social »<br />
(Fleischmann/Esse, 1989), et même « la technique<br />
comme processus social » (Weingart, 1989) suggèrent<br />
déjà un renversement <strong>de</strong> perspective. Il ne s’agit plus<br />
<strong>de</strong> l’imprégnation et <strong>de</strong> l’infléchissement <strong>de</strong> l’action<br />
humaine par la technique et sa rationalité propre,<br />
mais <strong>du</strong> développement et <strong>de</strong> l’utilisation <strong>de</strong> la<br />
technique par les hommes, en fonction <strong>de</strong> leurs<br />
capacités et <strong>de</strong> leurs intérêts » 6 .<br />
Le rôle <strong>de</strong>s « usagers » ou <strong>de</strong>s « usages » dans le<br />
succès <strong>de</strong>s innovations techniques dans le champ <strong>de</strong>s<br />
TIC, a été notamment éclairé par l’analyse <strong>de</strong>s<br />
« échecs technologiques », tels que le projet<br />
« Aramis » étudié par Bruno Latour ; un certain<br />
nombre d’expérimentations en matière <strong>de</strong> télégestion<br />
<strong>de</strong> l’énergie dans le cadre <strong>du</strong> programme « Pour<br />
habiter interactif » ou dans l’histoire <strong>du</strong> « Plan<br />
câble » … Dans ces trois cas, l’échec s’est révélé plus<br />
d’ordre « social » que « technique ». Dans ces trois<br />
cas, la rationalité technique se trouvait confrontée à la<br />
fois à la résistance <strong>du</strong> marché et à celle <strong>de</strong>s utilisateurs.<br />
Elle était contrariée par <strong>de</strong>s questions <strong>de</strong> coûts, <strong>de</strong><br />
rythmes <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong>s paliers d’innovations,<br />
susceptibles <strong>de</strong> débloquer <strong>de</strong>s situations (le Plan<br />
Câble a notamment été lancé alors que la technique<br />
<strong>de</strong> la fibre optique n’avait pas atteint sa pleine<br />
maturité et posé d’innombrables problèmes qui ont<br />
occasionné autant <strong>de</strong> retards), <strong>de</strong>s difficultés d’appropriation<br />
ou d’usages sociaux mais aussi par<br />
l’éclatement <strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> sociale.<br />
Ces échecs pouvaient certes s’expliquer par le<br />
fait qu’ils étaient aussi <strong>de</strong>s paris technologiques.<br />
Après coup, il était facile <strong>de</strong> stigmatiser l’ambition<br />
démesurée <strong>de</strong>s programmes, leur inadéquation à <strong>de</strong>s<br />
éléments <strong>du</strong> contexte international, l’impréparation<br />
<strong>de</strong>s programmes, les conflits internes à l’organisation<br />
(comme l’ont montré notamment les travaux<br />
d’Edith Brénac pour ce qui concerne le Plan Câble),<br />
les évaluations imparfaites <strong>de</strong>s besoins ou <strong>de</strong>s<br />
« attentes » <strong>de</strong>s usagers/consommateurs…<br />
Le fait que l’usager ten<strong>de</strong> à <strong>de</strong>venir un acteur<br />
important correspond aussi à la diversification en<br />
cours <strong>de</strong> l’offre sur ces objets techniques.<br />
L’intro<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> paramètre « usages » est ainsi liée à<br />
une extension <strong>de</strong> la capacité <strong>de</strong> choix <strong>de</strong>s<br />
usagers/consommateurs, à une possibilité nouvelle<br />
qui se révèle importante, celle <strong>de</strong> sanctionner l’utilité<br />
<strong>de</strong> telle ou telle offre technologique. Or, cette<br />
tendance s’explique autant par l’évolution <strong>du</strong> mon<strong>de</strong><br />
social, <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>s <strong>de</strong> vie et <strong>de</strong> consommation que par<br />
les évolutions qui commencent à traverser les secteurs<br />
pro<strong>du</strong>ctifs et <strong>de</strong> services dans l’ensemble <strong>de</strong> ces<br />
champs.<br />
Conjointement à l’affirmation <strong>du</strong> paramètre<br />
« Usagers », il faut donc considérer les évolutions qui<br />
ont traversé le champ <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> biens et <strong>de</strong><br />
services, qui, à partir <strong>de</strong>s années 1980, est peu à peu<br />
saisi par ce que l’on a appelé tour à tour la « déréglementation<br />
», la « dérégulation », la « libéralisation »<br />
… et qui se concrétise par la remise en cause gra<strong>du</strong>elle<br />
<strong>de</strong>s monopoles publics, l’intro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> la concurrence<br />
dans un environnement <strong>de</strong> plus en plus<br />
internationalisé.<br />
Pour ce qui concerne spécifiquement le champ<br />
<strong>de</strong>s TIC, ce type d’évolution a été particulièrement<br />
bien mis en lumière par l’ouvrage collectif L’ordre<br />
communicationnel, dirigé par François Du Castel,<br />
Pierre Chambat et Pierre Musso 7 .<br />
6 Heidrun Mollenkopf ; « Choix techniques et types <strong>de</strong> familles » ; Chapitre 13, in A. Gras, B. Joerges et V. Scardigli (dir.), Sociologie <strong>de</strong>s<br />
techniques <strong>de</strong> la vie quotidienne, coll. Logiques sociales, Éd. L’Harmattan, 1992, p. 153.<br />
7 F. Du Castel, P. Chambat, P. Musso, L’ordre communicationnel. Les nouvelles technologies <strong>de</strong> la communication : enjeux et stratégies, Cnet/Enst,<br />
La Documentation française, 1989.<br />
157