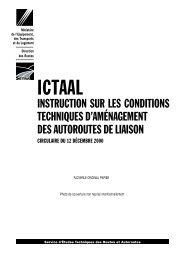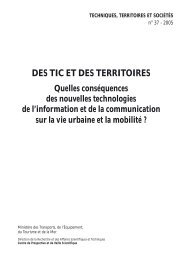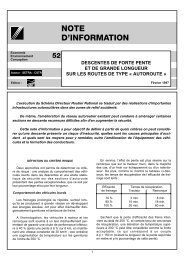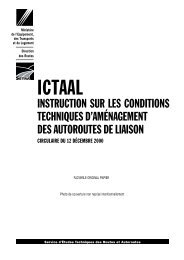Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
Daniel Kaplan - Portail documentaire du Ministère de l'Ecologie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
258<br />
Face au caractère incertain <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong><br />
communauté, nous lui préférons le terme <strong>de</strong><br />
« collectif » ou encore celui <strong>de</strong> « collectivité », moins<br />
connoté. Mais là encore, nous ne pouvons passer<br />
outre l’idée qu’un collectif ou une collectivité peut<br />
rester relativement « secrète » voire pratiquement<br />
invisible. Or les jeux vidéo en ligne ont pour<br />
particularité <strong>de</strong> soumettre à leur utilisateur un<br />
mon<strong>de</strong> fictif où les autres participants ne peuvent<br />
être ignorés, puisqu’ils font partie intégrante <strong>du</strong><br />
mon<strong>de</strong> proposé à l’usager. De même l’inci<strong>de</strong>nce<br />
sociale <strong>de</strong> ces pratiques rend ces mon<strong>de</strong>s <strong>de</strong> moins<br />
en moins « invisibles » aux yeux <strong>de</strong> la société<br />
globale. Devant la multiplication <strong>de</strong> ces univers<br />
virtuels, souvent fort violents, la presse s’émeut, les<br />
associations familiales dénoncent, et le consommateur<br />
en re<strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Il y a ici bien une dimension<br />
« publique » <strong>de</strong> notre objet <strong>de</strong> recherche, qui nous<br />
oblige à revenir sur le concept <strong>de</strong> « public ».<br />
Le public et la figure emblématique <strong>du</strong> joueur<br />
Commençons par un rapi<strong>de</strong> retour sur la<br />
notion <strong>de</strong> « public » telle que la développent les<br />
professionnels <strong>de</strong> la télévision. La télévision offre<br />
<strong>de</strong>s raccourcis rhétoriques particulièrement<br />
frappants pour désigner les publics que les<br />
différentes émissions visent et tentent donc <strong>de</strong><br />
sé<strong>du</strong>ire. Comme le montre Jacqueline Beaulieu dans<br />
La Télévision <strong>de</strong>s réalisateurs6 , ces <strong>de</strong>rniers se sont<br />
attachés à construire <strong>de</strong>s figures symboliques <strong>de</strong>s<br />
consommateurs <strong>de</strong>s émissions qu’ils réalisaient. La<br />
formule « la ménagère <strong>de</strong> moins <strong>de</strong> cinquante ans »,<br />
public visé en particulier par les fabricants <strong>de</strong><br />
lessives, s’est <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s décennies, imposée comme<br />
une quasi-caricature <strong>de</strong> la politique <strong>de</strong>s chaînes<br />
télévisuelles privées. Depuis les débuts <strong>de</strong> la<br />
télévision, mais cela vaut aussi pour d’autres médias<br />
plus anciens comme les journaux ou les romans dits<br />
« populaires », le « public » <strong>de</strong>vient une réalité<br />
imaginée, dont il s’agit <strong>de</strong> son<strong>de</strong>r la réalité effective.<br />
La télévision inventera les mesures d’audience, mais<br />
le jeu vidéo en ligne mène la logique à son terme : le<br />
joueur <strong>de</strong> jeu vidéo en ligne, non seulement est<br />
parfaitement « visible », mais il se met en scène luimême,<br />
c’est-à-dire se rend public aux yeux <strong>du</strong><br />
« public ». Autrement dit, dans le cas <strong>de</strong>s jeux vidéo<br />
en ligne, il n’y a pas <strong>de</strong> « public » incertain et<br />
invisible, au sens général <strong>du</strong> terme (auquel cas le<br />
« public » serait davantage une « audience » c’est-àdire<br />
un « client »). Les collectifs observés dans les<br />
jeux en ligne7 participent donc à rendre apparent ce<br />
qui pourrait sembler constituer a priori comme une<br />
simple construction conceptuelle8 : un public.<br />
Il est en effet rare <strong>de</strong> pouvoir observer dans les<br />
faits un regroupement d’indivi<strong>du</strong>s ayant pour point<br />
commun la réception d’un même média, et plus<br />
Laurent Vonach<br />
particulièrement d’un pro<strong>du</strong>it médiatique spécifique.<br />
Ces cristallisations plus ou moins éphémères d’une<br />
réalité que la théorie a cernée, mais qui échappe<br />
souvent à <strong>de</strong>s vérifications empiriques « sur le vif »,<br />
peuvent ici être décrites avec précision. Le terme<br />
« public » est étroitement associé à celui d’« espace<br />
public », auquel cas il véhicule l’idée d’un collectif<br />
humain visible, dont les membres sont conscients<br />
d’être visibles. Cette visibilité est elle-même constitutive<br />
d’un être ensemble manifesté dans le lieu<br />
même <strong>de</strong> pro<strong>du</strong>ction <strong>de</strong> sa visibilité. Le public est ici<br />
tangible, concret.<br />
Soulignons d’emblée que dans le cas <strong>de</strong>s<br />
publics par média interposé, une même personne<br />
peut appartenir à la fois à l’espace public et rester<br />
dans l’espace domestique, ce qui rend son statut<br />
incertain. À quel point l’i<strong>de</strong>ntité physique garantit le<br />
statut <strong>de</strong> « public » reste une question centrale dans<br />
le cas <strong>de</strong>s mon<strong>de</strong>s virtuels. En effet, une personne<br />
peut appartenir anonymement à un public sur un<br />
jeu vidéo en ligne, et ne pas déclarer dans l’espace<br />
relationnel non virtuel, sa présence en ces lieux<br />
virtuels. Il apparaît en effet plus que probable que<br />
nombre d’utilisateurs <strong>de</strong> jeux vidéo en ligne<br />
refusent <strong>de</strong> reconnaître « en public » leur goût pour<br />
ce genre <strong>de</strong> pratiques.<br />
On ne peut donc passer outre le sens commun<br />
<strong>du</strong> terme « public » qui suggère que quelque chose<br />
doit, dans les faits, être révélé aux autres. Une<br />
tautologie voudrait que ce qui est « public » est dans<br />
les faits manifesté dans « l’espace public ». Autrement<br />
dit, un public ne mérite cette définition que s’il fait<br />
montre d’une volonté <strong>de</strong> reconnaître <strong>de</strong> façon<br />
ouverte, son goût ou <strong>du</strong> moins sa consommation<br />
d’un pro<strong>du</strong>it ou service. Ce qui est en jeu ici, c’est le<br />
passage d’un acte <strong>de</strong> consommation au statut <strong>de</strong><br />
signe dans l’espace social.<br />
Cet acte <strong>de</strong> consommation peut être privé,<br />
auquel cas c’est le discours ou <strong>de</strong>s regroupements qui<br />
vont manifester le public (par exemple les « GT »,<br />
pour « Get Together », c’est-à-dire <strong>de</strong>s rencontres<br />
« dans la vie réelle » d’usagers <strong>de</strong> jeux vidéo en ligne).<br />
Cet acte <strong>de</strong> consommation peut aussi être<br />
directement public, pour les observateurs connectés à<br />
<strong>de</strong>s jeux en ligne. En ce sens, la consommation fait<br />
signe en soi, alors que dans le premier cas, celui d’une<br />
consommation dans un cadre privé, l’acte <strong>de</strong><br />
consommation pour acquérir une visibilité sociale,<br />
doit être « représenté » publiquement par un signe<br />
qui le désigne sans ambiguïté.<br />
Le concept <strong>de</strong> « public » présente donc <strong>de</strong>s<br />
approches intéressantes pour tenter <strong>de</strong> cerner la<br />
réalité <strong>de</strong>s « foules » (étant donné que cette « foule »<br />
peut prendre la forme <strong>de</strong> groupes structurés et<br />
6 Jacqueline Beaulieu – La Télévision <strong>de</strong>s réalisateurs – Paris, INA – La Documentation française, 1984.<br />
7 Cela vaut aussi pour d’autres pratiques sur réseaux, tels les « tchats » en temps réel, dont l’IRC, Internet Relay Chat.<br />
8 Voir à ce propos les développements sur les publics <strong>de</strong>s émissions télévisuelles <strong>de</strong> Sonia Livingstone et Peter Lundt, 1992, « Un public actif, un<br />
spectateur participant », in Hermès 11-12. Voir aussi Dayan <strong>Daniel</strong>, 1998, « Le double corps <strong>du</strong> spectateur », in S. Proulx (dir.), Accusé <strong>de</strong> réception,<br />
Paris/Laval, L’Harmattan & Presses <strong>de</strong> l’Université <strong>de</strong> Laval.