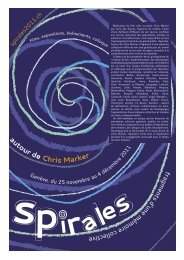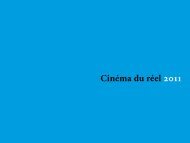Cinéma du réel 2011
Cinéma du réel 2011
Cinéma du réel 2011
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
156157souvenant de son cadet à l’entraînement et au combat en une série deflashbacks — suggèrent un possible rapprochement avec The Life andDeath of Colonel Blimp (1943).De même, il semblerait qu’il y ait quelque chose <strong>du</strong> Voyeur dans ladouble tentative <strong>du</strong> protagoniste d’imiter et de s’opposer à son père —excessivement traditionnel et curieusement interprété par le proprepère de Massey.On ne manquera pas de noter que ce fut aussi la dernière des troistentatives de Powell de travailler en format panoramique, ses autreslongs métrages en panoramique, Oh… Rosalinda ! (1955) et Lune deMiel (Honeymoon) (1959) étant eux-mêmes réputés invisibles (je n’aipu voir que le second diffusé dans le format télévisé 4/3).The Queen’s Guards n’a pas été diffusé à la télévision britannique depuis1974, ni – pour autant que je me souvienne – projeté en salle depuissa programmation dans le cadre de la rétrospective Michael Powell aufestival de San Sebastian en 2002. Le film est peut-être aussi mauvaisque l’affirment ceux qui l’ont vu, mais les photos disponibles laissentpenser que Powell était en tout cas sensible au potentiel émotionnel<strong>du</strong> cinéma en couleur. Comme œuvre tardive <strong>du</strong> plus grand cinéastebritannique (exception faite d’Hitchcock qui réalisa ses films majeursen Amérique), ce serait lui faire affront que de le laisser croupir dansl’ombre.Tra<strong>du</strong>it de l’anglais par Muriel CarpentierNatacha Thiéry Maître de conférences enEsthétique <strong>du</strong> cinémaMise à sacIl arrive que l’existence de certains films paraisse si improbable qu’elleen devient douteuse, non seulement pour les cinéphiles mais aussi pourceux qui les ont réalisés. Mise à sac fut longtemps de ceux-là. Dans lesannées 2000, Alain Cavalier ignorait s’il en restait ne serait-ce qu’unecopie. Il ne l’avait jamais revu. Cela m’avait frappée : je trouvais aberrantqu’un film soit per<strong>du</strong> dans la nature, et peut-être détruit, pour celui quil’avait porté, y avait consacré toute son énergie, avait réuni une équipeautour de lui. Les aléas des droits (les Artistes Associés, notamment),la négligence et l’oubli conjugués l’avaient effectivement ren<strong>du</strong> littéralementinaccessible. C’est grâce à Pierre Lhomme, son chef opérateur, àqui la Cinémathèque avait proposé de choisir un film pour l’hommagequi lui était ren<strong>du</strong> en octobre 2008, qu’une copie (Kodak) put êtrereconstituée à partir d’un internégatif : il en supervisa le réétalonnagepar les laboratoires Éclair. Mise à sac put donc être fugacement (re)découvert après une éclipse de plusieurs décennies, donnant au publicle sentiment de toucher enfin à un chaînon manquant. Ce film avaitl’air de représenter un tournant dans le parcours de ce cinéaste dont lesdeux premiers films (Le Combat dans l’île, L’Insoumis) avaient été malmenés,censurés. Ici, Cavalier adaptait un roman noir américain sansprétention et semblait se distancier des questions politiques. En réalité,il suivait toujours le penchant pour la transgression qui traverse toute safilmographie. Dans une lettre à Lhomme, il évoquait d’ailleurs dans unsourire son « attirance suspecte pour les voleurs ». Plus, l’audace <strong>du</strong> film,conçu en 1967, éclatait sur l’écran : un groupe d’une douzaine d’hommes<strong>du</strong> peuple, aspirant à une autre vie, se livrait, de nuit, au pillage systématiquede la bien nommée bourgade de Servage. Le geste ne manquait pasde panache, et la notion de propriété était balayée. Retenir des otagesn’empêchait pas de les appeler familièrement par leur prénom. Ou deles charmer. Avoir soudain de l’argent, cela pouvait servir à le détournerenfin de son usage. Dans un instant de vacance, l’un des hommesallumait sa cigarette avec le billet qu’il venait d’embraser au chalumeau.Florence Tissot Chargée de mission auxenrichissements à la Cinémathèque françaiseUne page folleHiroko Govaers s’est éteinte le 13 mai 2008, après avoir pendant plus de30 ans intro<strong>du</strong>it, programmé, tra<strong>du</strong>it, sous-titré et présenté le cinémajaponais en Europe dans les festivals, archives et autres salles. Je l’avaisrencontrée quelque temps plus tôt pour éditer Une page folle (KuruttaIppeiji) de Tenosuke Kinugasa, un projet qui, par manque de temps, n’apas vu le jour.Une page folle est un film d’avant-garde japonais sur la folie, qui ressembleà un ovni et qui, pour des questions de matériel et de droits, aune drôle d’histoire. Réalisé en 1927, per<strong>du</strong> alors que le cinéma sonores’impose, puis oublié jusqu’à ce que le réalisateur retrouve une copiequarante ans plus tard, il est projeté à nouveau en Europe après sa rééditionen 1972, et n’existe aujourd’hui en France que sur quelques copies16mm trop fatiguées pour circuler. Je vois ce film pour la première foisà Londres en 2003 et suis alors fascinée par les images et l’accompagnementmusical <strong>du</strong> Jazz band de Tim Brown, musicien et programmateur