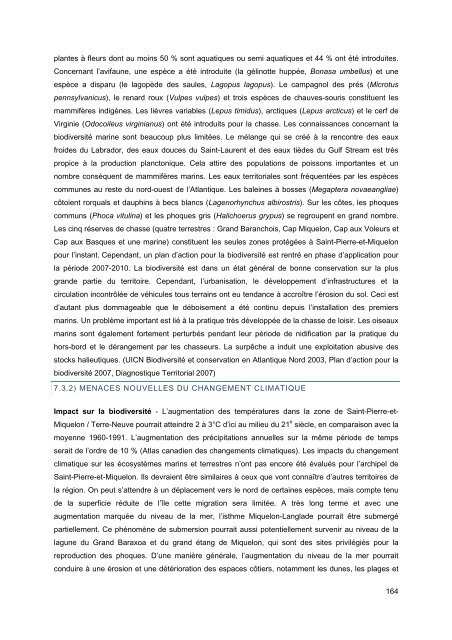document de travail - Université de la Nouvelle-Calédonie
document de travail - Université de la Nouvelle-Calédonie
document de travail - Université de la Nouvelle-Calédonie
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
p<strong>la</strong>ntes à fleurs dont au moins 50 % sont aquatiques ou semi aquatiques et 44 % ont été introduites.<br />
Concernant l’avifaune, une espèce a été introduite (<strong>la</strong> gélinotte huppée, Bonasa umbellus) et une<br />
espèce a disparu (le <strong>la</strong>gopè<strong>de</strong> <strong>de</strong>s saules, Lagopus <strong>la</strong>gopus). Le campagnol <strong>de</strong>s prés (Microtus<br />
pennsylvanicus), le renard roux (Vulpes vulpes) et trois espèces <strong>de</strong> chauves-souris constituent les<br />
mammifères indigènes. Les lièvres variables (Lepus timidus), arctiques (Lepus arcticus) et le cerf <strong>de</strong><br />
Virginie (Odocoileus virginianus) ont été introduits pour <strong>la</strong> chasse. Les connaissances concernant <strong>la</strong><br />
biodiversité marine sont beaucoup plus limitées. Le mé<strong>la</strong>nge qui se créé à <strong>la</strong> rencontre <strong>de</strong>s eaux<br />
froi<strong>de</strong>s du Labrador, <strong>de</strong>s eaux douces du Saint-Laurent et <strong>de</strong>s eaux tiè<strong>de</strong>s du Gulf Stream est très<br />
propice à <strong>la</strong> production p<strong>la</strong>nctonique. Ce<strong>la</strong> attire <strong>de</strong>s popu<strong>la</strong>tions <strong>de</strong> poissons importantes et un<br />
nombre conséquent <strong>de</strong> mammifères marins. Les eaux territoriales sont fréquentées par les espèces<br />
communes au reste du nord-ouest <strong>de</strong> l’At<strong>la</strong>ntique. Les baleines à bosses (Megaptera novaeangliae)<br />
côtoient rorquals et dauphins à becs b<strong>la</strong>ncs (Lagenorhynchus albirostris). Sur les côtes, les phoques<br />
communs (Phoca vitulina) et les phoques gris (Halichoerus grypus) se regroupent en grand nombre.<br />
Les cinq réserves <strong>de</strong> chasse (quatre terrestres : Grand Baranchois, Cap Miquelon, Cap aux Voleurs et<br />
Cap aux Basques et une marine) constituent les seules zones protégées à Saint-Pierre-et-Miquelon<br />
pour l’instant. Cependant, un p<strong>la</strong>n d’action pour <strong>la</strong> biodiversité est rentré en phase d’application pour<br />
<strong>la</strong> pério<strong>de</strong> 2007-2010. La biodiversité est dans un état général <strong>de</strong> bonne conservation sur <strong>la</strong> plus<br />
gran<strong>de</strong> partie du territoire. Cependant, l’urbanisation, le développement d’infrastructures et <strong>la</strong><br />
circu<strong>la</strong>tion incontrôlée <strong>de</strong> véhicules tous terrains ont eu tendance à accroître l’érosion du sol. Ceci est<br />
d’autant plus dommageable que le déboisement a été continu <strong>de</strong>puis l’instal<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s premiers<br />
marins. Un problème important est lié à <strong>la</strong> pratique très développée <strong>de</strong> <strong>la</strong> chasse <strong>de</strong> loisir. Les oiseaux<br />
marins sont également fortement perturbés pendant leur pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> nidification par <strong>la</strong> pratique du<br />
hors-bord et le dérangement par les chasseurs. La surpêche a induit une exploitation abusive <strong>de</strong>s<br />
stocks halieutiques. (UICN Biodiversité et conservation en At<strong>la</strong>ntique Nord 2003, P<strong>la</strong>n d’action pour <strong>la</strong><br />
biodiversité 2007, Diagnostique Territorial 2007)<br />
7.3.2) MENACES NOUVELLES DU CHANGEMENT CLIMATIQUE<br />
Impact sur <strong>la</strong> biodiversité - L’augmentation <strong>de</strong>s températures dans <strong>la</strong> zone <strong>de</strong> Saint-Pierre-et-<br />
Miquelon / Terre-Neuve pourrait atteindre 2 à 3°C d’ici au milieu du 21 e siècle, en comparaison avec <strong>la</strong><br />
moyenne 1960-1991. L’augmentation <strong>de</strong>s précipitations annuelles sur <strong>la</strong> même pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> temps<br />
serait <strong>de</strong> l’ordre <strong>de</strong> 10 % (At<strong>la</strong>s canadien <strong>de</strong>s changements climatiques). Les impacts du changement<br />
climatique sur les écosystèmes marins et terrestres n’ont pas encore été évalués pour l’archipel <strong>de</strong><br />
Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils <strong>de</strong>vraient être simi<strong>la</strong>ires à ceux que vont connaître d’autres territoires <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> région. On peut s’attendre à un dép<strong>la</strong>cement vers le nord <strong>de</strong> certaines espèces, mais compte tenu<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> superficie réduite <strong>de</strong> l’île cette migration sera limitée. A très long terme et avec une<br />
augmentation marquée du niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer, l’isthme Miquelon-Lang<strong>la</strong><strong>de</strong> pourrait être submergé<br />
partiellement. Ce phénomène <strong>de</strong> submersion pourrait aussi potentiellement survenir au niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
<strong>la</strong>gune du Grand Baraxoa et du grand étang <strong>de</strong> Miquelon, qui sont <strong>de</strong>s sites privilégiés pour <strong>la</strong><br />
reproduction <strong>de</strong>s phoques. D’une manière générale, l’augmentation du niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer pourrait<br />
conduire à une érosion et une détérioration <strong>de</strong>s espaces côtiers, notamment les dunes, les p<strong>la</strong>ges et<br />
164