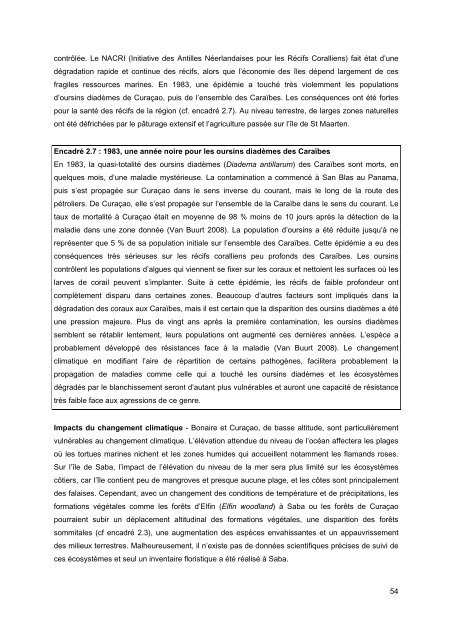document de travail - Université de la Nouvelle-Calédonie
document de travail - Université de la Nouvelle-Calédonie
document de travail - Université de la Nouvelle-Calédonie
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
contrôlée. Le NACRI (Initiative <strong>de</strong>s Antilles Néer<strong>la</strong>ndaises pour les Récifs Coralliens) fait état d’une<br />
dégradation rapi<strong>de</strong> et continue <strong>de</strong>s récifs, alors que l’économie <strong>de</strong>s îles dépend <strong>la</strong>rgement <strong>de</strong> ces<br />
fragiles ressources marines. En 1983, une épidémie a touché très violemment les popu<strong>la</strong>tions<br />
d’oursins diadèmes <strong>de</strong> Curaçao, puis <strong>de</strong> l’ensemble <strong>de</strong>s Caraïbes. Les conséquences ont été fortes<br />
pour <strong>la</strong> santé <strong>de</strong>s récifs <strong>de</strong> <strong>la</strong> région (cf. encadré 2.7). Au niveau terrestre, <strong>de</strong> <strong>la</strong>rges zones naturelles<br />
ont été défrichées par le pâturage extensif et l’agriculture passée sur l’île <strong>de</strong> St Maarten.<br />
Encadré 2.7 : 1983, une année noire pour les oursins diadèmes <strong>de</strong>s Caraïbes<br />
En 1983, <strong>la</strong> quasi-totalité <strong>de</strong>s oursins diadèmes (Dia<strong>de</strong>ma antil<strong>la</strong>rum) <strong>de</strong>s Caraïbes sont morts, en<br />
quelques mois, d’une ma<strong>la</strong>die mystérieuse. La contamination a commencé à San B<strong>la</strong>s au Panama,<br />
puis s’est propagée sur Curaçao dans le sens inverse du courant, mais le long <strong>de</strong> <strong>la</strong> route <strong>de</strong>s<br />
pétroliers. De Curaçao, elle s’est propagée sur l’ensemble <strong>de</strong> <strong>la</strong> Caraïbe dans le sens du courant. Le<br />
taux <strong>de</strong> mortalité à Curaçao était en moyenne <strong>de</strong> 98 % moins <strong>de</strong> 10 jours après <strong>la</strong> détection <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
ma<strong>la</strong>die dans une zone donnée (Van Buurt 2008). La popu<strong>la</strong>tion d’oursins a été réduite jusqu’à ne<br />
représenter que 5 % <strong>de</strong> sa popu<strong>la</strong>tion initiale sur l’ensemble <strong>de</strong>s Caraïbes. Cette épidémie a eu <strong>de</strong>s<br />
conséquences très sérieuses sur les récifs coralliens peu profonds <strong>de</strong>s Caraïbes. Les oursins<br />
contrôlent les popu<strong>la</strong>tions d’algues qui viennent se fixer sur les coraux et nettoient les surfaces où les<br />
<strong>la</strong>rves <strong>de</strong> corail peuvent s’imp<strong>la</strong>nter. Suite à cette épidémie, les récifs <strong>de</strong> faible profon<strong>de</strong>ur ont<br />
complètement disparu dans certaines zones. Beaucoup d’autres facteurs sont impliqués dans <strong>la</strong><br />
dégradation <strong>de</strong>s coraux aux Caraïbes, mais il est certain que <strong>la</strong> disparition <strong>de</strong>s oursins diadèmes a été<br />
une pression majeure. Plus <strong>de</strong> vingt ans après <strong>la</strong> première contamination, les oursins diadèmes<br />
semblent se rétablir lentement, leurs popu<strong>la</strong>tions ont augmenté ces <strong>de</strong>rnières années. L’espèce a<br />
probablement développé <strong>de</strong>s résistances face à <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die (Van Buurt 2008). Le changement<br />
climatique en modifiant l’aire <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong> certains pathogènes, facilitera probablement <strong>la</strong><br />
propagation <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies comme celle qui a touché les oursins diadèmes et les écosystèmes<br />
dégradés par le b<strong>la</strong>nchissement seront d’autant plus vulnérables et auront une capacité <strong>de</strong> résistance<br />
très faible face aux agressions <strong>de</strong> ce genre.<br />
Impacts du changement climatique - Bonaire et Curaçao, <strong>de</strong> basse altitu<strong>de</strong>, sont particulièrement<br />
vulnérables au changement climatique. L’élévation attendue du niveau <strong>de</strong> l’océan affectera les p<strong>la</strong>ges<br />
où les tortues marines nichent et les zones humi<strong>de</strong>s qui accueillent notamment les f<strong>la</strong>mands roses.<br />
Sur l’île <strong>de</strong> Saba, l’impact <strong>de</strong> l’élévation du niveau <strong>de</strong> <strong>la</strong> mer sera plus limité sur les écosystèmes<br />
côtiers, car l’île contient peu <strong>de</strong> mangroves et presque aucune p<strong>la</strong>ge, et les côtes sont principalement<br />
<strong>de</strong>s fa<strong>la</strong>ises. Cependant, avec un changement <strong>de</strong>s conditions <strong>de</strong> température et <strong>de</strong> précipitations, les<br />
formations végétales comme les forêts d’Elfin (Elfin wood<strong>la</strong>nd) à Saba ou les forêts <strong>de</strong> Curaçao<br />
pourraient subir un dép<strong>la</strong>cement altitudinal <strong>de</strong>s formations végétales, une disparition <strong>de</strong>s forêts<br />
sommitales (cf encadré 2.3), une augmentation <strong>de</strong>s espèces envahissantes et un appauvrissement<br />
<strong>de</strong>s milieux terrestres. Malheureusement, il n’existe pas <strong>de</strong> données scientifiques précises <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong><br />
ces écosystèmes et seul un inventaire floristique a été réalisé à Saba.<br />
54