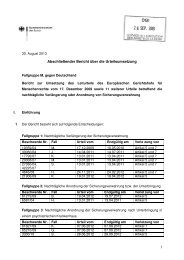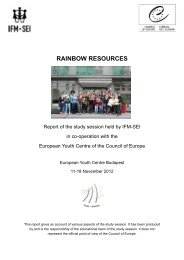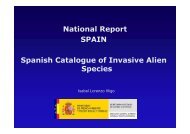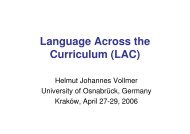Profil de la politique linguistique éducative Vallée d'Aoste Rapport ...
Profil de la politique linguistique éducative Vallée d'Aoste Rapport ...
Profil de la politique linguistique éducative Vallée d'Aoste Rapport ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Haute et Basse <strong>Vallée</strong>, sur <strong>la</strong> base d’une frontière est-ouest très approximative et effrangée, à p<strong>la</strong>cer<br />
dans <strong>la</strong> zone médiane comprise entre Quart et Châtillon) est en effet remarquable et n’a jamais connu<br />
<strong>de</strong> nivellement en direction d’un dialecte commun en fonction <strong>de</strong> “<strong>la</strong>ngue-toit”.<br />
Les raisons <strong>de</strong> cette caractérisation <strong>linguistique</strong> se relient aux dynamiques historiques (cf.<br />
1.2.) qui ont marqué <strong>la</strong> région valdôtaine.<br />
Le caractère néo-<strong>la</strong>tin <strong>de</strong>s patois valdôtains, qui ressentent uniquement au niveau du substrat<br />
<strong>de</strong> l’influence <strong>de</strong>s parlers celte-ligures <strong>de</strong>s préexistants Sa<strong>la</strong>sses, remonte <strong>de</strong> toute évi<strong>de</strong>nce à <strong>la</strong><br />
profon<strong>de</strong> romanisation qui a eu lieu suite à <strong>la</strong> fondation d’Aoste (l’an 25 avant notre ère).<br />
L’orientation gallo-romane, qui différencie les types <strong>linguistique</strong>s présents en <strong>Vallée</strong> d’Aoste<br />
(et dans <strong>la</strong> partie <strong>de</strong>s autres vallées alpines italiennes occi<strong>de</strong>ntales) <strong>de</strong> ceux piémontais <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ine<br />
du Pô appartenant au groupe gallo-italique, découle plutôt, à l’origine, <strong>de</strong> <strong>la</strong> stratégie adoptée par les<br />
Francs pour tenir les Lombards en respect après <strong>la</strong> paix (575 après J.-C.) signée à <strong>la</strong> suite du premier<br />
conflit entre les <strong>de</strong>ux peuples germaniques. Cet accord réservait aux premiers <strong>la</strong> possession <strong>de</strong>s cols<br />
et le territoire nécessaire à leur mise en sécurité, coïncidant avec le débouché <strong>de</strong>s vallées <strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ine<br />
du Pô (pour <strong>la</strong> vallée <strong>de</strong> <strong>la</strong> Doire Baltée, <strong>la</strong> limite fut p<strong>la</strong>cée à Pont-Saint-Martin; cf. Schüle 1990, pp.<br />
6-7). Après cette situation aurorale, l'attraction vers l’outre-monts d’une gran<strong>de</strong> partie <strong>de</strong> cette zone a<br />
été renforcée par l’inclusion du diocèse d’Aoste dans l’archidiocèse <strong>de</strong> Tarentaise, gravitant autour <strong>de</strong><br />
Lyon, et par une longue pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> rapports géo<strong>politique</strong>s et culturels avec <strong>la</strong> France, représentés par<br />
l’appartenance <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone septentrionale (<strong>Vallée</strong> d’Aoste, basse vallée <strong>de</strong> Suse et les vallées du<br />
Piémont au nord <strong>de</strong> celle-ci) au domaine « alpin » <strong>de</strong> <strong>la</strong> maison <strong>de</strong> Savoie et <strong>de</strong> <strong>la</strong> partie méridionale,<br />
au contraire, aux possessions dauphinoises et ensuite françaises jusqu’au traité <strong>de</strong> Utrecht (1713).<br />
En ce qui concerne <strong>la</strong> spécificité du francoprovençal par rapport aux <strong>de</strong>ux autres sousgroupes<br />
<strong>linguistique</strong>s du domaine gallo-roman (le français et les parlers occitans), il existe différentes<br />
hypothèses qui ont tenté d’en fournir un tableau étiologique. 7 Parmi ces <strong>de</strong>rnières, celle qui est encore<br />
maintenant <strong>la</strong> plus créditée est celle (énoncée par Hasselrot en 1938 et reprise et consolidée par<br />
Tuaillon en 1972) qui définit le francoprovençal comme un « Gallo-roman septentrional refusant <strong>de</strong>s<br />
innovations » provenant du français (Tuaillon 1994, pp. 38-40 et 63-64). Dans cette perspective, les<br />
caractères diversifiant le francoprovençal par rapport à <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue d’oïl (que Tuaillon résume dans <strong>la</strong><br />
conservation <strong>de</strong> A tonique <strong>la</strong>tine en syl<strong>la</strong>be ouverte, dans le refus <strong>de</strong> l’oxytonie généralisée et dans <strong>la</strong><br />
centralisation manquante <strong>de</strong> u du U long <strong>la</strong>tin) proviendraient <strong>de</strong> <strong>la</strong> condition géographique<br />
périphérique, pendant l’époque mérovingienne et carolingienne, <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone autour <strong>de</strong> l’archidiocèse<br />
<strong>de</strong> Lyon par rapport au centre innovateur <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> France (l’Île <strong>de</strong> France), qui aurait déterminé<br />
dans les parlers francoprovençaux l’absence <strong>de</strong>s traits évolutifs plus récents du français. Dans <strong>la</strong> zone<br />
valdôtaine, une confirmation <strong>de</strong> cette situation géo<strong>linguistique</strong> est fournie par l’opposition entre les<br />
traits généralement plus archaïques (d’un point <strong>de</strong> vue gallo-roman) <strong>de</strong>s patois <strong>de</strong> <strong>la</strong> Basse <strong>Vallée</strong> et<br />
ceux plus innovateurs (et coïnci<strong>de</strong>nts avec le français) <strong>de</strong> <strong>la</strong> Haute <strong>Vallée</strong>. 8<br />
Nous avons parlé précé<strong>de</strong>mment <strong>de</strong> l’absence, dans <strong>la</strong> zone francoprovençale, <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
constitution en époque historique d’une tradition <strong>de</strong> koinè ayant <strong>de</strong>s finalités communicatives supra-<br />
7 Voici le résumé <strong>de</strong>s principales hypothèses. C’est à W. von Wartburg (voir von Wartburg 1980 [1950], pp. 119-143)<br />
que l’on peut ramener l’hypothèse voyant dans le substrat burgon<strong>de</strong> (différent <strong>de</strong> celui franc dans le reste du septentrion<br />
français et <strong>de</strong> celui wisigoth dans le sud) <strong>la</strong> cause <strong>de</strong>s caractéristiques particulières <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone francoprovençale. Pour d’autres<br />
(parmi lesquels Pierre Gar<strong>de</strong>tte ; voir Tuaillon 1994, 56-57), au contraire, cette <strong>de</strong>rnière <strong>de</strong>vrait être recherchée dans <strong>la</strong> fonction<br />
<strong>de</strong> centre <strong>de</strong> gravitation exercée par Lyon à l’époque mérovingienne et carolingienne, surtout en ce qui concerne sa fonction <strong>de</strong><br />
centre épiscopal et <strong>de</strong> carrefour <strong>de</strong>s routes qui reliaient les <strong>de</strong>ux versants <strong>de</strong>s Alpes. Finalement, il ne faut pas négliger <strong>la</strong> thèse<br />
<strong>la</strong> plus récente et suggestive proposée par Mario Alinei (voir Alinei 2000) qui, dans le cadre d’une thèse plus générale basée<br />
sur <strong>la</strong> “théorie <strong>de</strong> <strong>la</strong> Continuité” (qui renverse les théories glottologiques traditionnelles, fondées sur <strong>la</strong> supposée “invasion<br />
indoeuropéenne” du troisième millénaire av. J.-C.), propose une genèse pré<strong>la</strong>tine <strong>de</strong>s caractères <strong>linguistique</strong>s du<br />
francoprovençal attribués à une première colonisation “itali<strong>de</strong>” <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone, provenant du sud à travers le cours du Rhône<br />
(culture Chassey, selon <strong>la</strong> dénomination <strong>de</strong>s archéologues), à <strong>la</strong>quelle se serait superposée une <strong>de</strong>uxième colonisation celtique<br />
(culture <strong>de</strong> Cortaillod, du Mégalithisme et Campaniforme) qui expliquerait <strong>la</strong> coexistence <strong>de</strong>s caractères “méridionaux”<br />
(notamment “provençaux”) et “septentrionaux” (c'est-à-dire “français”) dans le “<strong>la</strong>tin du haut-Rhône” dont serait dérivé en<br />
continuité le “néo<strong>la</strong>tin francoprovençal”.<br />
8 Prenons à titre d’exemple <strong>la</strong> dénomination pour le ‘renard’, qui est rèinar dans <strong>la</strong> Haute et Moyenne <strong>Vallée</strong> (en<br />
conformité avec l’innovation lexicale du français, motivée dès l’XI e siècle par l’adoption du nom propre <strong>de</strong> l’animal protagoniste<br />
du Roman <strong>de</strong> Renart), gourpoei par contre (conformément à l’ancien français goupil < <strong>la</strong>t. VULPICULU) dans <strong>la</strong> Basse <strong>Vallée</strong> (voir<br />
Favre 2002).<br />
20