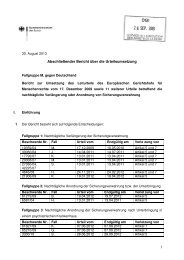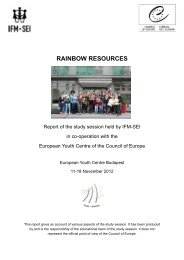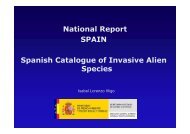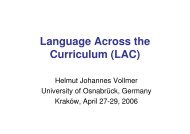Profil de la politique linguistique éducative Vallée d'Aoste Rapport ...
Profil de la politique linguistique éducative Vallée d'Aoste Rapport ...
Profil de la politique linguistique éducative Vallée d'Aoste Rapport ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
les habitants du Haut Val<strong>la</strong>is (les Walliser, c'est-à-dire les habitants <strong>de</strong> l’Ober-Wallis) à vivre sur les<br />
territoires du ressort <strong>de</strong> l’évêque situés au sud du massif du Mont-Rose, <strong>de</strong>venus praticables grâce<br />
aux conditions climatiques favorables <strong>de</strong> cette pério<strong>de</strong>. 13<br />
Les contacts commerciaux et culturels que les colonies valdôtaines continuèrent à entretenir<br />
avec le mon<strong>de</strong> germanophone (Suisse alleman<strong>de</strong> et Allemagne du sud) pendant les siècles suivants<br />
permirent <strong>de</strong> renforcer leur i<strong>de</strong>ntité <strong>linguistique</strong> et les poussèrent à adopter aussi <strong>la</strong> <strong>la</strong>ngue alleman<strong>de</strong><br />
comme <strong>la</strong>ngue écrite <strong>de</strong> culture <strong>de</strong>puis le XVI e siècle. Au fur et à mesure, l’isolement progressif du<br />
continuum <strong>linguistique</strong> allemand et <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> contact avec le mon<strong>de</strong> roman a favorisé toutefois<br />
d’importants changements <strong>linguistique</strong>s qui ont été <strong>la</strong>rgement étudiés en littérature. 14<br />
Cette situation porta aussi à une réduction progressive <strong>de</strong> <strong>la</strong> présence du Titsch et du<br />
Töitschu dans le répertoire communautaire. À travers les enquêtes socio<strong>linguistique</strong>s effectuées en<br />
1977 à Gressoney par Giacalone Ramat, <strong>la</strong> comparaison entre les données <strong>de</strong>s recensements <strong>de</strong><br />
1901 et <strong>de</strong> 1921 avec celles provenant <strong>de</strong> l’enquête effectuée dans les écoles élémentaires et les<br />
écoles moyennes, permet <strong>de</strong> remarquer que le pourcentage <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion déc<strong>la</strong>rant possé<strong>de</strong>r le<br />
dialecte germanique comme <strong>la</strong>ngue maternelle au début du siècle était compris entre 87% et 100%,<br />
tandis qu’il passe à 34% en 1977. 15<br />
La production littéraire dialectale dans <strong>la</strong> culture walser est, comme pour le francoprovençal,<br />
plutôt récente et implique une opération <strong>de</strong> récupération i<strong>de</strong>ntitaire consciente. Parmi les auteurs,<br />
nous pouvons citer l’écrivain du XIX e siècle Luis Zumstein qui écrivit en dialecte walser, en allemand<br />
et (sous le pseudonyme <strong>de</strong> De<strong>la</strong>pierre) en français, ainsi que <strong>la</strong> poétesse Margherita Scaler, tous les<br />
<strong>de</strong>ux <strong>de</strong> Gressoney. 16<br />
Il est par contre plus difficile (en l’absence d’étu<strong>de</strong>s spécifiques) d’analyser les étapes<br />
historiques qui expliquent <strong>la</strong> présence, dans le répertoire <strong>linguistique</strong> valdôtain, <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>de</strong>uxième (par<br />
sa diffusion) variété dialectale, à savoir le piémontais.<br />
À l’origine <strong>de</strong> ce phénomène, il est possible <strong>de</strong> retrouver, sans aucun doute, les motivations<br />
ayant trait à <strong>la</strong> situation <strong>de</strong> continuum dialectal (et géographique) qui lie <strong>la</strong> <strong>Vallée</strong> d’Aoste au Piémont<br />
septentrional, où les parlers haut-canavais constituent un pont naturel entre les dialectes galloitaliques<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ine et ceux déjà gallo-romans <strong>de</strong> <strong>la</strong> Basse <strong>Vallée</strong>. Cette proximité <strong>linguistique</strong> doit<br />
avoir constamment permis, du moins à courte distance, une influence réciproque entre les parlers et a<br />
certainement déterminé <strong>de</strong>s phénomènes <strong>de</strong> contact <strong>linguistique</strong> qui se sont renforcés lorsque (à<br />
partir <strong>de</strong> <strong>la</strong> fin du XIV e siècle) les territoires piémontais et valdôtains se sont retrouvés intégrés aux<br />
domaines cisalpins <strong>de</strong> <strong>la</strong> maison <strong>de</strong> Savoie. La capacité <strong>de</strong> pénétration du piémontais dans les<br />
usages <strong>linguistique</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone valdôtaine <strong>la</strong> plus proche géographiquement a dû recevoir aussi <strong>de</strong><br />
nouvelles impulsions successives par le dép<strong>la</strong>cement progressif en direction « italienne » du<br />
barycentre <strong>politique</strong> et économique <strong>de</strong> l’état <strong>de</strong> Savoie. Par conséquent, c’est déjà à partir <strong>de</strong>s XVI e et<br />
XVII e siècles, suite au transfert <strong>de</strong> <strong>la</strong> capital <strong>de</strong> Chambéry à Turin, que le piémontais (considéré<br />
comme dialecte <strong>de</strong> koinè qui s’est irradié <strong>de</strong> <strong>la</strong> cour <strong>de</strong> Turin) doit avoir commencé à trouver son<br />
propre espace dans <strong>la</strong> vallée en tant que <strong>la</strong>ngue véhicu<strong>la</strong>ire pour les rapports <strong>de</strong> commerce et<br />
d’échange, les variables pour <strong>la</strong> définition <strong>de</strong> cet espace étant le rapprochement géographique et <strong>la</strong><br />
présence <strong>de</strong> structures commerciales (les foires et les marchés <strong>de</strong>s centres principaux du fond <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
vallée). Cette datation « haute » expliquerait ainsi <strong>la</strong> substitution pratiquement intégrale du<br />
francoprovençal en tant que variété dialectale par le piémontais dans les centres <strong>de</strong> <strong>la</strong> Basse <strong>Vallée</strong><br />
(comme Pont-Saint-Martin et Verrès). Pour cette zone, <strong>la</strong> consolidation pendant les siècles suivants<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> variété dialectale d’importation est indirectement confirmée par les notations enregistrées à partir<br />
13 b<br />
Cf. Favre 2002, pp. 146-147, Giacalone Ramat 1979, pp.421-423 et Telmon 1992 , pp. 87-88. Les parlers walser<br />
sont présents aussi dans les vallées piémontaises adossées au Mont Rose, en particulier dans les communes <strong>de</strong> A<strong>la</strong>gna<br />
Valsesia, Macugnaga, Formazza, Rima et Rimel<strong>la</strong>.<br />
14 b<br />
Pour les caractéristiques <strong>linguistique</strong>s <strong>de</strong>s dialectes alémaniques valdôtains voir Telmon 1992 , pp. 92-96 et les<br />
renvois présents.<br />
15<br />
Cf. Giacalone Ramat 1979, les tableaux à p. 424 et 441. Les données PASVA 2001 pour Gressoney sont<br />
malheureusement peu utilisables pour comparer <strong>la</strong> situation d’aujourd’hui avec celle <strong>de</strong> 1977, vu le nombre important <strong>de</strong><br />
réponses qui ne peuvent pas être interprétées (réponse “Autre”, 22%) à <strong>la</strong> question 401 re<strong>la</strong>tive aux <strong>la</strong>ngues connues. Ce<strong>la</strong> dit,<br />
l’analyse <strong>de</strong>s données semblerait quand même indiquer <strong>la</strong> tenue du parler local, connu par 51,38% <strong>de</strong> l’échantillon. Voici les<br />
données re<strong>la</strong>tives aux autres variétés principales du répertoire: italien, 77,89%; français 59,55%; piémontais 57,04% (ce haut<br />
pourcentage est conforme à l’aspect <strong>linguistique</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> Basse <strong>Vallée</strong>); allemand 24,5%; francoprovençal 15,8%.<br />
16 b<br />
Cf. Telmon 1992 , p. 97.<br />
22