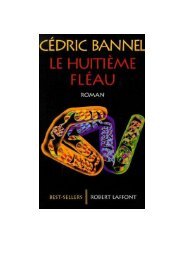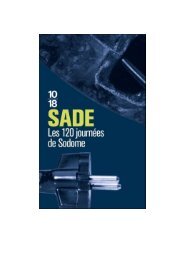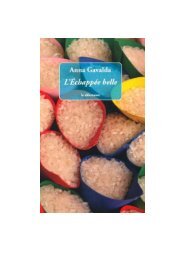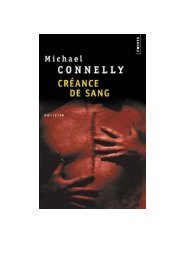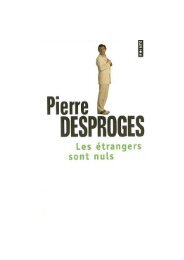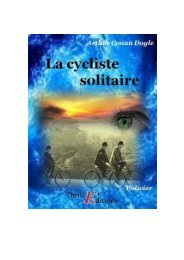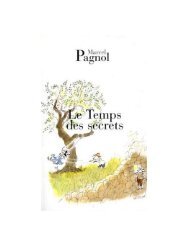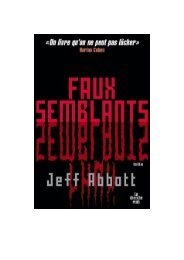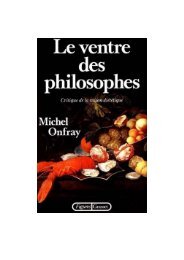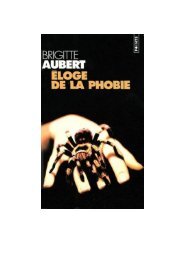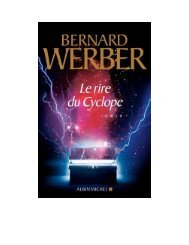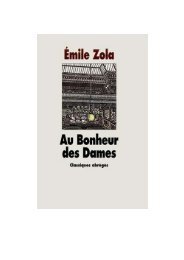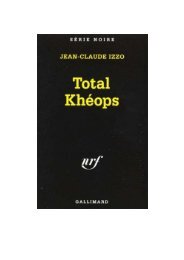aussi indispensab<strong>le</strong> que la police de Dzerjinski. Lyrisme, lyrisation, discours lyrique,enthousiasme lyrique font partie intégrante de ce qu’on appel<strong>le</strong> <strong>le</strong> monde totalitaire; cemonde, ce n’est pas <strong>le</strong> goulag, c’est <strong>le</strong> goulag dont <strong>le</strong>s murs extérieurs sont tapissés devers et devant <strong>le</strong>squels on danse.Plus que la Terreur, la lyrisation de la Terreur fut pour moi un traumatisme. Àjamais, j’ai été vacciné contre toutes <strong>le</strong>s tentations lyriques. La seu<strong>le</strong> chose que jedésirais alors profondément, avidement, c’était un regard lucide et désabusé. Je l’aitrouvé enfin dans l’art du roman. C’est pourquoi être romancier fut pour moi plus quepratiquer un « genre littéraire » parmi d’autres; ce fut une attitude, une sagesse, uneposition; une position excluant toute identification à une politique, à une religion, à uneidéologie, à une mora<strong>le</strong>, à une col<strong>le</strong>ctivité; une non-identification consciente, opiniâtre,enragée, conçue non pas comme évasion ou passivité, mais comme résistance, défi,révolte. J’ai fini par avoir ces dialogues étranges : « Vous êtes communiste, monsieurKundera ? - Non, je suis romancier. » « Vous êtes dissident ? - Non, je suisromancier. » « Vous êtes de gauche ou de droite ? - Ni l’un ni l’autre. Je suisromancier. »Dès ma première jeunesse, j’ai été amoureux de l’art moderne, de sa peinture,de sa musique, de sa poésie. Mais l’art moderne était marqué par son « esprit lyrique »,par ses illusions de progrès, par son idéologie de la doub<strong>le</strong> révolution, esthétique etpolitique, et tout cela, peu à peu, je <strong>le</strong> pris en grippe. Mon scepticisme à l’égard del’esprit d’avant-garde ne pouvait pourtant rien changer à mon amour pour <strong>le</strong>s œuvresd’art moderne. Je <strong>le</strong>s aimais et je <strong>le</strong>s aimais d’autant plus qu’el<strong>le</strong>s étaient <strong>le</strong>s premièresvictimes de la persécution stalinienne; Cenek, de La Plaisanterie, fut envoyé dans unrégiment disciplinaire parce qu’il aimait la peinture cubiste; c’était ainsi, alors : laRévolution avait décidé que l’art moderne était son ennemi idéologique numéro unmême si <strong>le</strong>s pauvres modernistes ne désiraient que la chanter et la célébrer; jen’oublierai jamais Konstantin Biebl : un poète exquis (ah, combien j’ai connu de sesvers par cœur !) qui, communiste enthousiaste, s’est mis, après 1948, à écrire de lapoésie de propagande d’une médiocrité aussi consternante que déchirante; un peu plustard, il se jeta d’une fenêtre sur <strong>le</strong> pavé de Prague et se tua; dans sa personne subti<strong>le</strong>,j’ai vu l’art moderne trompé, cocufié, martyrisé, assassiné, suicidé.Ma fidélité à l’art moderne était donc aussi passionnel<strong>le</strong> que mon attachement àl’antilyrisme du roman. Les va<strong>le</strong>urs poétiques chères à Breton, chères à tout l’artmoderne (intensité, densité, imagination délivrée, mépris pour « <strong>le</strong>s moments nuls de lavie »), je <strong>le</strong>s ai cherchées exclusivement sur <strong>le</strong> territoire romanesque désenchanté.Mais el<strong>le</strong>s m’importaient d’autant plus. Ce qui explique, peut-être, pourquoi j’ai étéparticulièrement al<strong>le</strong>rgique à cette sorte d’ennui qui irritait Debussy lorsqu’il écoutait dessymphonies de Brahms ou de Tchaïkovski; al<strong>le</strong>rgique au bruissement des laborieusesaraignées. Ce qui explique, peut-être, pourquoi je suis resté longtemps sourd à l’art deBalzac et pourquoi <strong>le</strong> romancier que j’ai particulièrement adoré fut Rabelais.Pour Rabelais, la dichotomie des thèmes et des ponts, du premier et de l’arrièreplanest chose inconnue. Lestement, il passe d’un sujet grave à l’énumération desméthodes que <strong>le</strong> petit Gargantua inventa pour se torcher <strong>le</strong> cul, et pourtant,esthétiquement, tous ces passages, futi<strong>le</strong>s ou graves, ont chez lui la même importance,me procurent <strong>le</strong> même plaisir. C’est ce qui m’enchantait chez lui et chez d’autres
omanciers anciens : ils par<strong>le</strong>nt de ce qu’ils trouvent fascinant et ils s’arrêtent quand lafascination s’arrête. Leur liberté de composition m’a fait rêver : écrire sans fabriquer unsuspense, sans construire une histoire et simu<strong>le</strong>r sa vraisemblance, écrire sans décrireune époque, un milieu, une vil<strong>le</strong>; abandonner tout cela et n’être au contact que del’essentiel; ce qui veut dire : créer une composition où des ponts et des remplissagesn’auraient aucune raison d’être et où <strong>le</strong> romancier ne serait pas obligé, pour satisfaire laforme et ses diktats, de s’éloigner, même d’une seu<strong>le</strong> ligne, de ce qui lui tient à cœur,de ce qui <strong>le</strong> fascine.L’art moderne : une révolte contre l’imitation de la réalité au nom des loisautonomes de l’art. L’une des premières exigences pratiques de cette autonomie : quetous <strong>le</strong>s moments, toutes <strong>le</strong>s parcel<strong>le</strong>s d’une œuvre aient une éga<strong>le</strong> importanceesthétique.L’impressionnisme : <strong>le</strong> paysage conçu comme simp<strong>le</strong> phénomène optique, desorte que l’homme qui s’y trouve n’a pas plus de va<strong>le</strong>ur qu’un buisson. Les peintrescubistes et abstraits sont allés encore plus loin en supprimant la troisième dimensionqui, inévitab<strong>le</strong>ment, scindait <strong>le</strong> tab<strong>le</strong>au en des plans d’importance différente.En musique, même tendance vers l’égalité esthétique de tous <strong>le</strong>s moments d’unecomposition : Satie, dont la simplicité n’est qu’un refus provocateur de la rhétoriquemusica<strong>le</strong> héritée. Debussy, l’enchanteur, <strong>le</strong> persécuteur des araignées savantes.Janacek supprimant toute note qui n’est pas indispensab<strong>le</strong>. Stravinski qui se détournede l’héritage du romantisme et du classicisme et cherche ses précurseurs parmi <strong>le</strong>smaîtres du premier temps de l’histoire de la musique. Webern qui revient à unmonothématisme sui generis (c’est-à-dire dodécaphonique) et atteint un dépouil<strong>le</strong>mentqu’avant lui personne ne pouvait imaginer.Et <strong>le</strong> roman : la mise en doute de la fameuse devise de Balzac « <strong>le</strong> roman doitconcurrencer l’état civil »; cette mise en doute n’a rien d’une bravade d’avant-gardistesse plaisant à exhiber <strong>le</strong>ur modernité pour qu’el<strong>le</strong> soit perceptib<strong>le</strong> aux sots; el<strong>le</strong> ne faitque rendre (discrètement) inuti<strong>le</strong> (ou quasi inuti<strong>le</strong>, facultatif, non-important) l’appareil àfabriquer l’illusion du réel. À ce propos cette petite observation :Si un personnage doit concurrencer l’état civil, il faut qu’il ait d’abord un vrai nom.De Balzac à Proust, un personnage sans nom est impensab<strong>le</strong>. Mais <strong>le</strong> Jacques deDiderot n’a aucun patronyme et son maître n’a ni nom ni prénom. Panurge, est-ce unnom ou un prénom ? Les prénoms sans patronymes, <strong>le</strong>s patronymes sans prénoms nesont plus des noms mais des signes. Le protagoniste du Procès n’est pas un JosephKaufmann ou Krammer ou Kohi, mais Joseph K. Celui du Château perdra jusqu’à sonprénom pour se contenter d’une seu<strong>le</strong> <strong>le</strong>ttre. Les Schuldlosen de Broch : un desprotagonistes est désigné par la <strong>le</strong>ttre A. Dans Les Somnambu<strong>le</strong>s, Esch et Huguenaun’ont pas de prénoms. Le protagoniste de L’Homme sans qualités, Ulrich, n’a pas depatronyme. Dès mes premières nouvel<strong>le</strong>s, instinctivement, j’ai évité de donner desnoms aux personnages. Dans La vie est ail<strong>le</strong>urs, <strong>le</strong> héros n’a qu’un prénom, sa mèren’est désignée que par <strong>le</strong> mot « maman », sa petite amie comme « la rousse » etl’amant de cel<strong>le</strong>-ci comme « <strong>le</strong> quadragénaire ». Était-ce du maniérisme ? J’agissaisalors dans une tota<strong>le</strong> spontanéité dont plus tard seu<strong>le</strong>ment j’ai compris <strong>le</strong> sens :j’obéissais à l’esthétique du troisième temps : je ne voulais pas faire croire que mespersonnages sont réels et possèdent un <strong>livre</strong>t de famil<strong>le</strong>.
- Page 9:
faire avec la raison extrahumaine d
- Page 13 and 14:
d’une œuvre pour l’inscrire ai
- Page 15 and 16:
Je ne vois aucun cardinal du Bellay
- Page 17 and 18:
pour sa naïveté et son hyperboliq
- Page 19 and 20:
avait réussi c’eût été pour t
- Page 21 and 22: attentif à la Révolution de 1917
- Page 23 and 24: décrire le comique de cette triste
- Page 25 and 26: l’aubergiste qui arrive tandis qu
- Page 27 and 28: Les deux mi-tempsL’histoire de la
- Page 29 and 30: frivolité ou l’indigence.La situ
- Page 31 and 32: même, ce n’est pas par libre cho
- Page 33 and 34: mais non existants m’ont parlé d
- Page 35 and 36: siècle; le sens de cette réhabili
- Page 37 and 38: de ne pas parler de ses souffrances
- Page 39 and 40: loin de là… »Un autre exemple :
- Page 41 and 42: Bonheur et extaseJe me demande si A
- Page 43 and 44: arbarie; sa « musique ne s’ident
- Page 45 and 46: lessantes pour les autres. Il y a d
- Page 47 and 48: Quatrième partieUne phraseDans «
- Page 49 and 50: français me paraît donc compréhe
- Page 51 and 52: Céline. Mais il y a des auteurs do
- Page 53 and 54: « sans s’interrompre, sans barre
- Page 55 and 56: s’arrêter à n’importe quel mo
- Page 57 and 58: 2.Ce qui est curieux dans cette nou
- Page 59 and 60: en aide à notre mémoire et de rec
- Page 61 and 62: mauvais vers). Si le roman est un a
- Page 63 and 64: frappante, si envoûtante); l’int
- Page 65 and 66: compassion. Harpe et cordes, la dou
- Page 67 and 68: eprésente le mal et l’instinctif
- Page 69 and 70: d’être fascinant, il ne nous fai
- Page 71: exceptions confirment la règle : s
- Page 75 and 76: peine nommée, l’auteur ne daigna
- Page 77 and 78: Comment sont-elles reliées, ces se
- Page 79 and 80: finit bien. C’est ce qu’on peut
- Page 81 and 82: Le roman pensé de Musil accomplit
- Page 83 and 84: l’absence totale de ce qui est si
- Page 85 and 86: Les pianistes dont j’ai pu me pro
- Page 87 and 88: historique s’est estompé; elle s
- Page 89 and 90: compatriotes refusent à Joyce son
- Page 91 and 92: L’ironie veut dire : aucune des a
- Page 93 and 94: loi à laquelle, selon Kafka, toute
- Page 95 and 96: ne peut plus secret, clandestin, di
- Page 97 and 98: Conspiration de détailsLes métamo
- Page 99 and 100: Changement d'opinion en tant qu'aju
- Page 101 and 102: avant, était éclipsé par les sou
- Page 103 and 104: événements les plus infimes » de
- Page 105 and 106: m’accompagne partout où je vais
- Page 107 and 108: La morale de l’extase est contrai
- Page 109 and 110: qui est dans le brouillard : il voi
- Page 111 and 112: Stravinski réagit le 19 octobre :
- Page 113 and 114: N’est-ce pas, dit Vogel, que le c
- Page 115 and 116: plus la force nécessaire pour séd
- Page 117 and 118: testament dans lequel je le priais
- Page 119 and 120: progressivement (mais avec une rage
- Page 121 and 122: déceler; d’abord à cause du min
- Page 123 and 124:
grande que les autres. Ainsi en a d
- Page 125 and 126:
en livre les notes destinées à sa
- Page 127:
Ah, il est si facile de désobéir