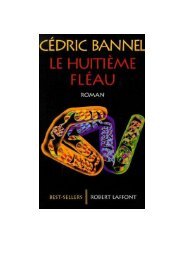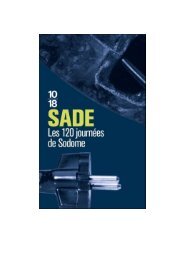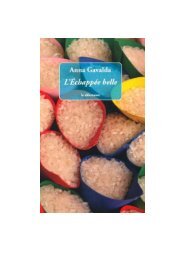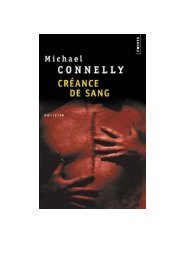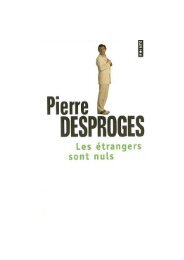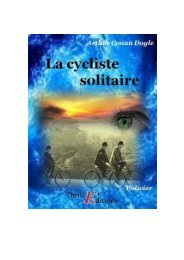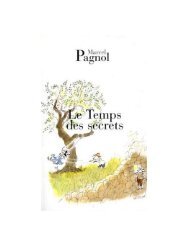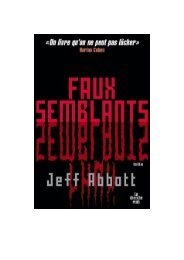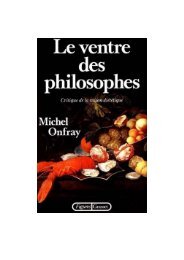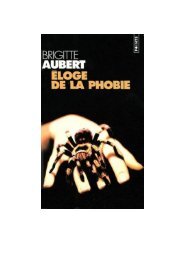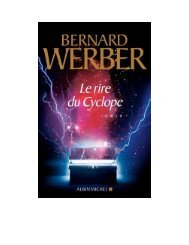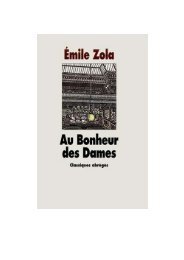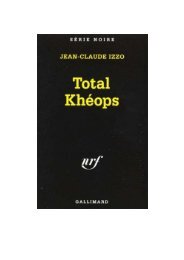du rythme basé sur la capacité d’alterner de courts et de longs chapitres : ainsi, parexemp<strong>le</strong>, la quatrième partie de Par-delà <strong>le</strong> bien et <strong>le</strong> mal consiste-t-el<strong>le</strong> exclusivementen aphorismes très courts (comme une sorte de divertissement, de scherzo). Maissurtout : voilà une composition où il n’y a aucune nécessité de remplissages, detransitions, de passages faib<strong>le</strong>s, et où la tension ne baisse jamais car on ne voit que <strong>le</strong>spensées en train d’accourir « du dehors, d’en haut ou d’en bas, tels des événements,tels des coups de foudre ».Si la pensée d’un philosophe est à ce point liée à l’organisation formel<strong>le</strong> de sontexte, peut-el<strong>le</strong> exister en dehors de ce texte ? Peut-on extraire la pensée de Nietzschede la prose de Nietzsche ? Bien sûr que non. La pensée, l’expression, la compositionsont inséparab<strong>le</strong>s. Ce qui est valab<strong>le</strong> pour Nietzsche est-il valab<strong>le</strong> en général ? Àsavoir : peut-on dire que la pensée (la signification) d’une œuvre est toujours et parprincipe indissociab<strong>le</strong> de la composition ?Curieusement, non, on ne peut pas <strong>le</strong> dire. Pendant longtemps, en musique,l’originalité d’un compositeur consistait exclusivement dans son invention mélodicoharmoniquequ’il distribuait, pour ainsi dire, dans des schémas compositionnels qui nedépendaient pas de lui, qui étaient plus ou moins préétablis : <strong>le</strong>s messes, <strong>le</strong>s suitesbaroques, <strong>le</strong>s concerti baroques, etc. Leurs différentes parties sont rangées dans unordre déterminé par la tradition, de sorte que, par exemp<strong>le</strong>, avec la régularité d’unehorloge, la suite finit toujours par une danse rapide, etc., etc.Les trente-deux sonates de Beethoven qui couvrent presque toute sa viecréatrice, depuis ses vingt-cinq jusqu’à ses cinquante-deux ans, représentent uneimmense évolution pendant laquel<strong>le</strong> la composition de la sonate se transformecomplètement. Les premières sonates obéissent encore au schéma hérité de Haydn etde Mozart : quatre mouvements; <strong>le</strong> premier : al<strong>le</strong>gro écrit dans la forme sonate;deuxième : adagio écrit dans la forme Lied; troisième : menuet ou scherzo dans untempo modéré; quatrième : rondo, dans un tempo rapide.Le désavantage de cette composition frappe <strong>le</strong>s yeux : <strong>le</strong> mouvement <strong>le</strong> plusimportant, <strong>le</strong> plus dramatique, <strong>le</strong> plus long, est <strong>le</strong> premier; la succession desmouvements a donc une évolution descendante : du plus grave vers <strong>le</strong> plus léger; enoutre, avant Beethoven, la sonate reste toujours à mi-chemin entre un recueil demorceaux (on joue alors souvent aux concerts des mouvements isolés des sonates) etune composition indivisib<strong>le</strong> et unie. Au fur et à mesure de l’évolution de ses trente-deuxsonates, Beethoven remplace progressivement <strong>le</strong> vieux schéma de la composition parun schéma plus concentré (réduit souvent à trois, voire à deux mouvements), plusdramatique (<strong>le</strong> centre de gravité se déplace vers <strong>le</strong> dernier mouvement), plus uni(surtout par la même atmosphère émotionnel<strong>le</strong>). Mais <strong>le</strong> vrai sens de cette évolution(qui par là devient une véritab<strong>le</strong> révolution) n’était pas de remplacer un schémainsatisfaisant par un autre, meil<strong>le</strong>ur, mais de casser <strong>le</strong> principe même du schémacompositionnel préétabli.En effet, cette obéissance col<strong>le</strong>ctive au schéma prescrit de la sonate ou de lasymphonie a quelque chose de ridicu<strong>le</strong>. Imaginons que tous <strong>le</strong>s grands symphonistes, ycompris Haydn et Mozart, Schumann et Brahms, après avoir p<strong>le</strong>uré dans <strong>le</strong>ur adagio,se déguisent, quand arrive <strong>le</strong> dernier mouvement, en petits écoliers et se précipitentdans la cour de récréation pour y danser, sauter et crier à tue-tête que tout est bien qui
finit bien. C’est ce qu’on peut appe<strong>le</strong>r la « bêtise de la musique ». Beethoven a comprisque la seu<strong>le</strong> voie pour la dépasser c’est de rendre la composition radica<strong>le</strong>mentindividuel<strong>le</strong>.C’est là la première clause de son testament artistique destiné à tous <strong>le</strong>s arts, àtous <strong>le</strong>s artistes et que je formu<strong>le</strong>rai ainsi : il ne faut pas considérer la composition(l’organisation architectura<strong>le</strong> de l’ensemb<strong>le</strong>) comme une matrice préexistante, prêtée àl’auteur pour qu’il la remplisse de son invention; la composition el<strong>le</strong>-même doit être uneinvention, une invention qui engage toute l’originalité de l’auteur.Je ne saurais dire à quel point ce message a été écouté et compris. MaisBeethoven lui-même a su en tirer toutes <strong>le</strong>s conséquences, magistra<strong>le</strong>ment, dans sesdernières sonates dont chacune est composée d’une façon unique, jamais vue.La sonate opus 111; el<strong>le</strong> n’a que deux mouvements : <strong>le</strong> premier, dramatique, estélaboré d’une façon plus ou moins classique en forme sonate; <strong>le</strong> deuxième, aucaractère méditatif, est écrit en forme de variations (forme, avant Beethoven, plutôtinhabituel<strong>le</strong> dans une sonate) : pas de jeu de contrastes et de diversités, seu<strong>le</strong>ment unegradation continue qui ajoute toujours une nouvel<strong>le</strong> nuance à la variation précédente etdonne à ce long mouvement une exceptionnel<strong>le</strong> unité de ton.Plus chacun des mouvements est parfait dans son unité, plus il s’oppose àl’autre. Disproportion de la durée : <strong>le</strong> premier mouvement (dans l’exécution deSchnabel) : 8 minutes 14; <strong>le</strong> deuxième, 17 minutes 42. La seconde moitié de la sonateest donc plus de deux fois plus longue que la première (cas sans précédent dansl’histoire de la sonate) ! En outre : <strong>le</strong> premier mouvement est dramatique, <strong>le</strong> deuxièmecalme, réf<strong>le</strong>xif. Or, commencer dramatiquement et finir par une si longue méditation,cela semb<strong>le</strong> contredire tous <strong>le</strong>s principes architecturaux et condamner la sonate à laperte de toute tension dramatique si chère, auparavant, à Beethoven.Mais c’est précisément <strong>le</strong> voisinage inattendu de ces deux mouvements qui estéloquent, qui par<strong>le</strong>, qui devient <strong>le</strong> geste sémantique de la sonate, sa significationmétaphorique évoquant l’image d’une vie dure, courte, et du chant nostalgique qui lasuit, sans fin. Cette signification métaphorique, insaisissab<strong>le</strong> par des mots et pourtantforte et insistante, donne à ces deux mouvements une unité. Unité inimitab<strong>le</strong>. (Onpouvait à l’infini imiter la composition impersonnel<strong>le</strong> de la sonate mozartienne; lacomposition de la sonate opus 111 est à tel point personnel<strong>le</strong> que son imitation seraitune contrefaçon.)La sonate opus 111 me fait penser aux Palmiers sauvages de Faulkner. Là,alternent un récit d’amour et celui d’un prisonnier évadé, récits qui n’ont rien encommun, aucun personnage et même aucune parenté perceptib<strong>le</strong> de motifs ou dethèmes. Composition qui ne peut servir de modè<strong>le</strong> pour aucun autre romancier; qui nepeut exister qu’une seu<strong>le</strong> fois; qui est arbitraire, non-recommandab<strong>le</strong>, injustifiab<strong>le</strong>;injustifiab<strong>le</strong> car derrière el<strong>le</strong> on entend un es muss sein qui rend toute justificationsuperflue.Par son refus du système, Nietzsche change en profondeur la façon dephilosopher : comme l’a défini Hannah Arendt, la pensée de Nietzsche est une penséeexpérimenta<strong>le</strong>. Sa première impulsion est de corroder ce qui est figé, de miner dessystèmes communément acceptés, d’ouvrir des brèches pour s’aventurer dans
- Page 9:
faire avec la raison extrahumaine d
- Page 13 and 14:
d’une œuvre pour l’inscrire ai
- Page 15 and 16:
Je ne vois aucun cardinal du Bellay
- Page 17 and 18:
pour sa naïveté et son hyperboliq
- Page 19 and 20:
avait réussi c’eût été pour t
- Page 21 and 22:
attentif à la Révolution de 1917
- Page 23 and 24:
décrire le comique de cette triste
- Page 25 and 26:
l’aubergiste qui arrive tandis qu
- Page 27 and 28: Les deux mi-tempsL’histoire de la
- Page 29 and 30: frivolité ou l’indigence.La situ
- Page 31 and 32: même, ce n’est pas par libre cho
- Page 33 and 34: mais non existants m’ont parlé d
- Page 35 and 36: siècle; le sens de cette réhabili
- Page 37 and 38: de ne pas parler de ses souffrances
- Page 39 and 40: loin de là… »Un autre exemple :
- Page 41 and 42: Bonheur et extaseJe me demande si A
- Page 43 and 44: arbarie; sa « musique ne s’ident
- Page 45 and 46: lessantes pour les autres. Il y a d
- Page 47 and 48: Quatrième partieUne phraseDans «
- Page 49 and 50: français me paraît donc compréhe
- Page 51 and 52: Céline. Mais il y a des auteurs do
- Page 53 and 54: « sans s’interrompre, sans barre
- Page 55 and 56: s’arrêter à n’importe quel mo
- Page 57 and 58: 2.Ce qui est curieux dans cette nou
- Page 59 and 60: en aide à notre mémoire et de rec
- Page 61 and 62: mauvais vers). Si le roman est un a
- Page 63 and 64: frappante, si envoûtante); l’int
- Page 65 and 66: compassion. Harpe et cordes, la dou
- Page 67 and 68: eprésente le mal et l’instinctif
- Page 69 and 70: d’être fascinant, il ne nous fai
- Page 71 and 72: exceptions confirment la règle : s
- Page 73 and 74: omanciers anciens : ils parlent de
- Page 75 and 76: peine nommée, l’auteur ne daigna
- Page 77: Comment sont-elles reliées, ces se
- Page 81 and 82: Le roman pensé de Musil accomplit
- Page 83 and 84: l’absence totale de ce qui est si
- Page 85 and 86: Les pianistes dont j’ai pu me pro
- Page 87 and 88: historique s’est estompé; elle s
- Page 89 and 90: compatriotes refusent à Joyce son
- Page 91 and 92: L’ironie veut dire : aucune des a
- Page 93 and 94: loi à laquelle, selon Kafka, toute
- Page 95 and 96: ne peut plus secret, clandestin, di
- Page 97 and 98: Conspiration de détailsLes métamo
- Page 99 and 100: Changement d'opinion en tant qu'aju
- Page 101 and 102: avant, était éclipsé par les sou
- Page 103 and 104: événements les plus infimes » de
- Page 105 and 106: m’accompagne partout où je vais
- Page 107 and 108: La morale de l’extase est contrai
- Page 109 and 110: qui est dans le brouillard : il voi
- Page 111 and 112: Stravinski réagit le 19 octobre :
- Page 113 and 114: N’est-ce pas, dit Vogel, que le c
- Page 115 and 116: plus la force nécessaire pour séd
- Page 117 and 118: testament dans lequel je le priais
- Page 119 and 120: progressivement (mais avec une rage
- Page 121 and 122: déceler; d’abord à cause du min
- Page 123 and 124: grande que les autres. Ainsi en a d
- Page 125 and 126: en livre les notes destinées à sa
- Page 127: Ah, il est si facile de désobéir