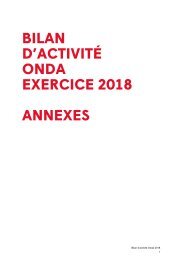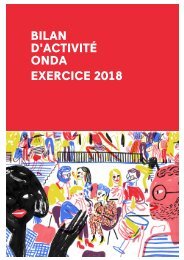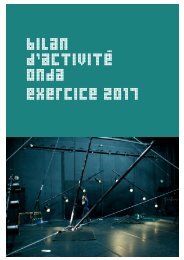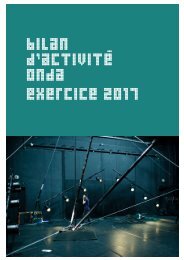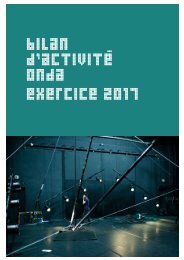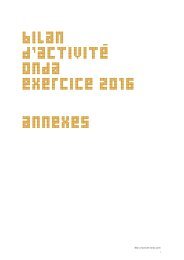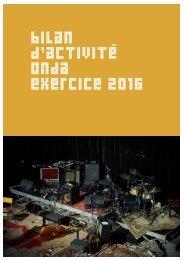Onda_etudedanse_complet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
106 LA DIFFUSION DE LA DANSE EN FRANCE DE 2011 À 2017 ONDA.FR<br />
Les réponses majoritairement dubitatives des structures sur le<br />
potentiel offert par les créations associant les professionnels et les<br />
amateurs sur le développement des publics de la danse conduisent à<br />
s’interroger sur l’identité des participants et participantes. N’ont-ils/<br />
elles pas déjà une appétence pour les pratiques artistiques ?<br />
Les questionnements sur les outils de médiation<br />
Le développement de propositions participatives est tourné<br />
vers un objectif de plus grande inclusion sociale par des mises<br />
en relation avec l’altérité qui brassent les références musicales<br />
populaires et plus savantes, les codes chorégraphiques, les rituels<br />
folkloriques. Il s’agit ainsi de diversifier les sources de résonances<br />
culturelles intimes et de stimuler auprès des spectateurs et spectatrices<br />
une envie de fredonner les airs connus, de danser avec les<br />
participants et participantes. La reconnaissance de ces spectacles<br />
interactifs comme une œuvre in situ digne d’être soutenue par les<br />
collectivités publiques renvoie à un questionnement en termes de<br />
relativisme culturel. Doit-on les considérer comme des animations<br />
artistiques divertissantes ou comme des recherches esthétiques<br />
hybrides destinées à renouveler les rapports de projection-identification<br />
des publics ?<br />
Le degré de pertinence d’une restitution des résultats des<br />
actions des chorégraphes ou des danseurs auprès de groupes de<br />
participants sous la forme de spectacles en clôture des ateliers<br />
fait aussi l’objet d’interrogations. Il s’agit d’une attente souvent<br />
portée par les équipes des lieux de façon à donner une visibilité<br />
aux actions artistiques qu’elles ont organisées. La durée courte<br />
de certaines interventions est inappropriée pour placer les participants<br />
dans un cadre de construction et d’apprentissage d’une<br />
partition chorégraphique. Cela les place en position de fragilisation<br />
même si le public, constitué essentiellement par des membres<br />
de leur entourage familial, amical ou professionnel, se montre<br />
bienveillant.<br />
“ On a tendance à oublier que la création artistique, c’est long, et<br />
que ça peut être traumatisant de monter sur scène quand on n’est<br />
pas prêt. ”<br />
(Chorégraphe, compagnie 12)<br />
L’implication de personnes non formées en danse dans des<br />
projets chorégraphiques peut s’effectuer par d’autres voies qu’une<br />
finalisation sous la forme d’une représentation scénique. Les pensées<br />
des habitants sur les espaces de leur territoire et les temporalités<br />
de leur vie se concrétisent par des paroles et des images diffusées<br />
dans différents supports écrits, audiovisuels, numériques. Une<br />
exploration artistique sensible de ces pensées consiste à placer les<br />
personnes en situation d’enquête sur les souvenirs marquants de<br />
leurs rapports à des lieux ou de veille méditative sur les espaces et<br />
édifices de leur commune.<br />
“ Une transfiguration artistique de la situation d’observation s’effectue<br />
d’emblée si les personnes sont invitées à adopter une posture<br />
d’immobilité face au spectacle de la ville en prenant des photos . ”<br />
(Chorégraphe, compagnie 20).<br />
Les matériaux collectés au cours de ces expériences se concrétisent<br />
par des récits sur leur expérience, des photographies, des films<br />
sur les rapports des personnes aux espaces et aux mouvements.<br />
La construction puis la lecture d’un texte commun, le montage et<br />
la projection de films sur ces expériences réflexives et sensibles,<br />
encadrées par des chorégraphes, constituent ainsi des formes de<br />
restitution alternatives si le temps disponible, l’envie du groupe<br />
ou l’orientation du projet d’action artistique écartent la faisabilité<br />
d’une création de spectacle.<br />
“ Je propose maintenant de passer par la vidéo ou la photo ; cela<br />
place les personnes dans une situation moins angoissante pour le<br />
rendu et ça laisse plus de place à la transmission, à la rencontre. ”<br />
(Chorégraphe, compagnie 12)<br />
La question de la valorisation institutionnelle de ces formes<br />
atypiques, relayée par les artistes associé∙es des CCN et des CDCN 79 ,<br />
porte sur leur reconnaissance comme faisant partie des dispositifs<br />
légitimes pour l’éducation artistique et culturelle. Ce questionnement<br />
est partagé par des structures.<br />
L’évaluation des dispositifs d’action culturelle par les collectivités<br />
publiques s’effectue essentiellement par une approche<br />
quantitative qui recense les volumes horaires dispensés et le nombre<br />
de participants. Une question posée de façon assez récurrente par<br />
des chorégraphes est la prise en compte complémentaire d’une évaluation<br />
qualitative de ces actions, en concertation avec les équipes<br />
des lieux, sur les transformations comportementales des personnes<br />
bénéficiaires, au moins à court terme. Il s’agirait de préciser les<br />
objectifs fixés à l’éducation artistique et culturelle par chacune<br />
des parties prenantes afin de clarifier la conduite des projets sur<br />
la base d’un objectif commun accepté par les financeurs, les opérateurs<br />
culturels, les équipes artistiques et les relais. Une prise en<br />
compte des récits d’expérience des chorégraphes, des personnes en<br />
charge des relations avec les publics et des responsables des groupes<br />
impliqués permettrait d’apporter des éclairages susceptibles de valoriser<br />
les dimensions artistiques de l’encadrement, les innovations<br />
pédagogiques, et d’ajuster la conduite des actions en fonction des<br />
objectifs fixés en termes d’acquisition de compétences personnelles<br />
et/ou d’éveil d’un désir de fréquenter les spectacles programmés. À<br />
ressources budgétaires et humaines équivalentes, cela requiert un<br />
redéploiement de la charge de travail entre la conception, la conduite<br />
et l’évaluation des dispositifs d’action expérimentés.<br />
Il serait utile de mener des enquêtes longitudinales sur l’évolution<br />
comportementale des personnes qui ont suivi ces dispositifs<br />
d’action chorégraphique, notamment sur leurs choix de spectacles<br />
dans ou en dehors de la structure organisatrice mais aussi sur les<br />
compétences acquises.<br />
“ Mesure-t-on les effets de l’action culturelle uniquement par l’autonomie<br />
du spectateur, c’est-à-dire sa capacité à prendre tout seul un<br />
billet de théâtre lorsqu’il n’est plus en projet avec le théâtre ? Ou bien<br />
est-ce que ça se mesure également en termes de réussite scolaire, en<br />
termes d’évolution de son rapport aux autres en règle générale, de<br />
confiance en lui dans le cadre scolaire ou en dehors du cadre scolaire ?<br />
C’est tout ça qu’il faudrait mesurer si on veut connaître véritablement<br />
les effets de l’action culturelle. C’est un travail sociologique profond<br />
à faire. Je trouve inquiétant qu’on n’évalue pas. ”<br />
(Directeur, structure dédiée 21)<br />
79. Compte rendu de la réunion du comité de suivi des artistes associé∙e∙s aux CCNs et aux CDCNs, 18 septembre 2018.