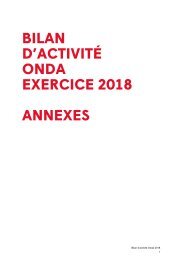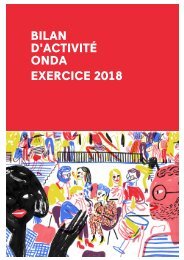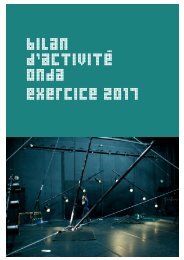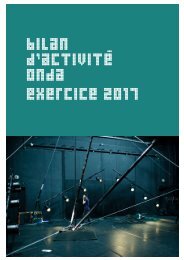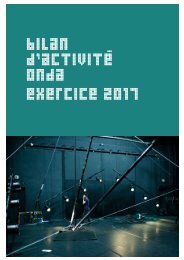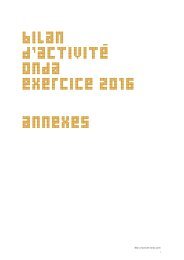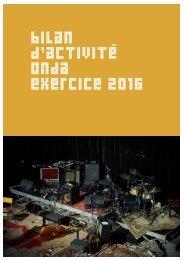Onda_etudedanse_complet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
INTRODUCTION<br />
07<br />
En complément, un questionnaire en ligne a été adressé aux<br />
compagnies répertoriées par le CN D et aux lieux de spectacles identifiés<br />
par l’<strong>Onda</strong>. Enfin, des études de cas ont été menées auprès de<br />
21 compagnies et de 21 structures de diffusion aux profils contrastés.<br />
Un CCN a été interrogé au prisme de ses activités en tant que compagnie<br />
et en tant que structure de diffusion.<br />
La base de la SACD<br />
La base de données apporte des informations précises sur les<br />
spectacles de danse qui ont fait l’objet d’une perception de droits<br />
d’auteur par la SACD en France. Elle renseigne les titres de spectacles,<br />
leurs auteurs, les dates de représentations, les noms, lieux et villes<br />
des diffuseurs, des producteurs, et, de façon plus partielle, les prix de<br />
cession, les recettes de billetterie et la fréquentation. Elle ne recouvre<br />
pas l’intégralité de la diffusion de la danse ; les représentations des<br />
spectacles des compagnies françaises à l’international n’y figurent<br />
pas tandis que certaines productions étrangères en France n’ont<br />
pas fait l’objet d’une déclaration pour la perception des droits par<br />
la SACD. Il s’agit néanmoins d’une source d’informations inédites<br />
sur la diffusion de la danse en France.<br />
La base de données a fait l’objet d’un traitement complémentaire<br />
collectif à partir de juillet 2017. Philippe Le Moal, Inspection<br />
danse de la DGCA a identifié les maîtres d’œuvre artistique des<br />
spectacles, c’est-à-dire les chorégraphes créateurs de leurs œuvres<br />
et les directeurs de ballets d’opéra ; la famille esthétique dominante<br />
des spectacles en sept catégories principales : baroque, butõ, classique<br />
2 , contemporain, danses du monde, hip-hop, jazz. La famille<br />
esthétique mineure de 23 % des spectacles, qui croisent des langages<br />
artistiques, a été également spécifiée, ainsi que certaines modalités<br />
particulières comme des représentations dans l’espace public ou<br />
la danse verticale. Pour les spectacles de danse contemporaine,<br />
l’hybridation la plus fréquente a concerné la danse et le théâtre.<br />
Sur la période 2011-2015, ce style a concerné 7,7 % des spectacles<br />
diffusés et 10,2 % des représentations. Le croisement de la danse<br />
contemporaine avec le hip-hop a concerné 1,5 % des spectacles,<br />
1,2 % des représentations et avec les performances 1,7 % des spectacles<br />
et 1 % des représentations. Les années de première création<br />
des spectacles ont été également identifiées. Enfin, la base a été<br />
nettoyée de ses scories.<br />
Les spectacles des ballets d’opéra ont été distribués selon leur<br />
catégorie esthétique dominante. En raison de l’importance de sa<br />
diffusion, le ballet de l’Opéra national de Paris (ONP) a été distingué<br />
des autres ballets d’opéra.<br />
La base de données a été complétée par des informations issues<br />
d’autres sources. Les aides de l’État (conventionnement triennal, aide<br />
à la structuration bisannuelle, aide à la production ponctuelle) 3 ont<br />
été renseignées précisément par l’inspection de la création artistique<br />
de la DGCA. Le répertoire des compagnies du Centre national de la<br />
danse (CN D) a permis de compléter la base avec les aides accordées<br />
par les Régions. Une catégorie spécifique a été créée pour le<br />
2. La famille classique inclut ici le répertoire historique du ballet de la fin du XVIII e<br />
siècle jusqu’au répertoire de Maurice Petitpa du début du XX e siècle et son héritage<br />
soviétique et cubain, l’esthétique néoclassique qui correspond aux ruptures introduites<br />
par les Ballets Russes, avec leurs nombreux héritiers jusqu’à Roland Petit,<br />
Maurice Béjart, Jy i Kilián, Mats Ek, et l’esthétique alter-classique, portée par William<br />
Forsythe, basée sur une hybridation entre techniques et vocabulaire classiques et<br />
des protocoles empruntés à la danse contemporaine.<br />
3. Il s’agit des aides allouées par les Directions régionales des affaires culturelles<br />
(DRAC), à l’exception des chorégraphes en sortie de direction de CCN, qui sont<br />
accompagnés par la DGCA pendant leur première convention triennale, ainsi que<br />
de quelques autres compagnies suivies par la DGCA pour des raisons historiques.<br />
soutien financier de la Région sans l’État. En revanche, comme les<br />
déclarations des aides des Communes et des Départements par les<br />
compagnies n’ont pas fait l’objet d’une vérification par le CN D, à<br />
l’inverse de celles qui sont octroyées par les Régions, la catégorie<br />
« autres » comprend les compagnies aidées seulement par les Communes,<br />
les Intercommunalités et/ou les Départements ainsi que<br />
celles qui n’ont reçu aucune subvention publique.<br />
L’équipe de l’<strong>Onda</strong> a identifié les statuts institutionnels des<br />
structures de diffusion, les spectacles pour l’enfance et jeunesse<br />
et les compagnies dédiées à l’enfance et la jeunesse (distinguées des<br />
compagnies tous publics dans l’étude), et le nombre d’artistes-interprètes<br />
impliqués dans les 113 spectacles ayant été diffusés chaque<br />
année pendant la période 2011-2015.<br />
Les données sur la fréquentation des représentations sont<br />
beaucoup trop partielles pour être prises en considération. Les<br />
prix de cession sont à exploiter avec précaution puisque des structures<br />
de diffusion intègrent parfois les frais annexes dans leurs<br />
déclarations, ce qui les rend hétérogènes. La présente étude ne<br />
les a pas traités.<br />
Les questionnaires<br />
Un questionnaire a été distribué en ligne de mars à juillet 2018<br />
aux compagnies répertoriées par le CN D et aux lieux de spectacle<br />
ou festivals, dédiés à la danse ou pluridisciplinaires, qui figurent<br />
dans la base de données de l’<strong>Onda</strong>.<br />
Le questionnaire adressé aux compagnies concernait les activités<br />
des années 2014 à 2016 et était structuré en quatre parties :<br />
• l’état de la diffusion avec l’identification du genre chorégraphique<br />
dominant, le nombre de spectacles et de représentations selon<br />
l’année de création, le type de contrat, le nombre d’interprètes, la<br />
zone de diffusion territoriale, le statut des diffuseurs, l’évolution<br />
observée en explicitant ses causes ;<br />
• les conditions de la diffusion selon les liens avec la production, la<br />
méthodologie de la prospection, les négociations sur les prix de<br />
cession, la couverture médiatique des spectacles, les résidences<br />
obtenues, l’engagement dans les actions de sensibilisation artistique<br />
;<br />
• la vision du devenir de la diffusion chorégraphique et ses causes<br />
apparentes ;<br />
• l’identité de la compagnie (budget, composition sexuée et âge de<br />
la direction, année de création, types de subventions, hiérarchisation<br />
des fonctions).<br />
Le questionnaire adressé aux deux types de lieux de spectacles<br />
était similaire en dehors des questions spécifiques sur l’importance<br />
de la danse dans la programmation des établissements pluridisciplinaires.<br />
Il portait sur les trois saisons 2014/15, 2015/16 et 2016/17<br />
et était divisé en quatre parties :<br />
• les choix de programmation effectués avec le nombre de représentations<br />
par genre chorégraphique, celles destinées à l’enfance<br />
et à la jeunesse, selon la taille de la distribution, le rayonnement<br />
territorial et la direction sexuée des compagnies, l’évolution observée<br />
et ses causes apparentes ;<br />
• les modalités de la programmation chorégraphique avec les critères<br />
de choix, la temporalité, les types de collaboration avec les équipes<br />
artistiques ainsi que les autres lieux du territoire, l’évolution des<br />
prix de cession, de la fréquentation, les moyens perçus comme<br />
pertinents pour développer les publics ;<br />
• la perception du devenir de la programmation chorégraphique<br />
et ses raisons ;<br />
• l’identité de la structure selon son statut, la composition sexuée