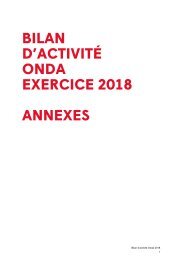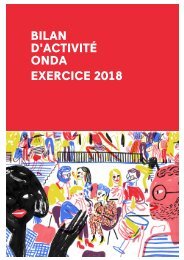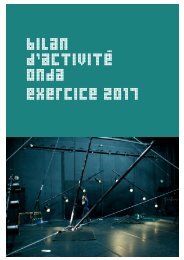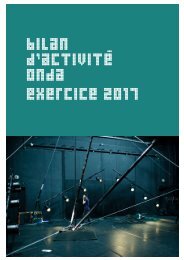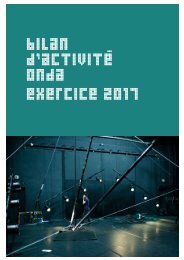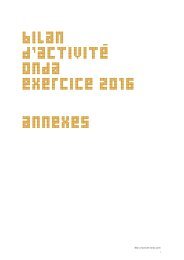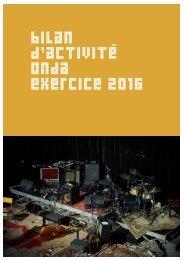Onda_etudedanse_complet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
68 LA DIFFUSION DE LA DANSE EN FRANCE DE 2011 À 2017 ONDA.FR<br />
La coproduction de spectacles comprend le plus souvent un volet<br />
de diffusion avec la signature conjointe d’un contrat de cession du<br />
droit de représenter le spectacle. L’importance des contreparties<br />
demandées en termes de participation à des actions de sensibilisation<br />
artistique ou à des créations participatives sur le territoire<br />
dépend du projet culturel de la structure. Par exemple, la direction<br />
de la structure 18 a indiqué axer son budget de coproduction sur le<br />
soutien des équipes qui privilégient les actions artistiques en dehors<br />
des murs de l’établissement culturel.<br />
Dans l’ensemble, les contrats de cession avec coproduction ont<br />
représenté moins de 1 % des contrats de cession pour 36,3 % des<br />
compagnies, de 1 % à moins de 32 % pour 33,3 % des équipes et<br />
au moins 32 % dans 30,4 % des cas. Les compagnies au plus haut<br />
niveau de diffusion (plus de 33 représentations par an) sont moins<br />
tributaires des contrats de cession avec coproduction tandis que la<br />
situation est la plus contrastée pour les équipes au plus bas niveau<br />
de diffusion (moins de 13 représentations par an).<br />
Part des contrats de cession avec coproduction selon le niveau<br />
annuel moyen de diffusion des compagnies en % (2014-2016)<br />
Comme le préachat des spectacles coproduits tend à s’effectuer<br />
au coût du plateau, le montant de la coproduction conjointe est un<br />
enjeu important pour les conditions de financement du spectacle.<br />
La nécessité de multiplier les coproducteurs, en raison de la réduction<br />
de leurs apports moyens notée dès le début des années 2000<br />
par le rapport Latarjet 47 , présente l’avantage d’élargir le réseau des<br />
premières séries de représentations mais l’inconvénient d’allonger<br />
le temps de travail pour prospecter les financements nécessaires et<br />
reporte les négociations sur les marges bénéficiaires afin d’amortir<br />
au mieux les coûts du montage sur la tournée postérieure.<br />
Les équipes chorégraphiques les plus anciennes ont témoigné<br />
de la raréfaction des coproductions et de la baisse drastique des<br />
montants habituellement mis en jeu en raison du resserrement de<br />
la contrainte d’équilibre budgétaire des structures.<br />
“ Avant [en 2000] je pouvais obtenir des apports de 80 à 100 000 €<br />
avec le Théâtre X ; aujourd’hui, je suis content avec 5000 €. ”<br />
(Chorégraphe, compagnie 13)<br />
“ Ça a pas mal changé depuis 5-6 ans en termes de montant. Avant<br />
on pouvait avoir des co-productions de l’ordre de 15/20 000 €, même<br />
plus. Aujourd’hui ce n’est plus possible ça. C’est des co-productions<br />
qui tournent entre 5 et 10 000 €. Et 10 000 € c’est une bonne nouvelle.<br />
On est obligé de multiplier les co-productions et on se retrouve à avoir<br />
des listes de coproducteurs qui sont énormes. Ce qui rend le travail<br />
encore plus difficile, aller chercher 5000 € par ci, 5000 € par là… ”<br />
(Chorégraphe, compagnie 18)<br />
Moins de<br />
13 repr.<br />
de 13 à<br />
33 repr.<br />
plus de<br />
33 repr.<br />
TOTAL<br />
Moins de 1% 48,5 40 20,6 36,3<br />
De 1% à moins<br />
de 32%<br />
9,1 34,3 55,9 33,3<br />
32% et plus 42,4 25,7 23,5 30,4<br />
TOTAL 100 100 100 100<br />
Les ordres de grandeur avancés oscillent entre 20 000 € quand il<br />
s’agit de grosses coproductions accordées à des artistes associé·es,<br />
des montants de 10 à 15 000 € pour les grandes structures pluridisciplinaires,<br />
de 5 à 10 000 € pour les autres structures. Les montants<br />
peuvent être parfois inférieurs :<br />
“ On a eu parfois 3 000 euros pour 1a coproduction d’une scène<br />
nationale par exemple. ”<br />
(Codirectrice, compagnie 11)<br />
Des structures ont indiqué fournir un effort budgétaire plus<br />
important en termes d’apport monétaire pour soutenir leurs artistes<br />
associées. Si certains grands établissements peuvent proposer des<br />
apports plus conséquents, de 20 000 à 50 000 €, les moyens budgétaires<br />
contraignent des structures plus petites à se confiner à des<br />
montants moyens plus faibles.<br />
“ Aujourd’hui on se retrouve confronté à la question de faire remonter<br />
la moyenne de 7 500 €. La question n’est pas tranchée pour le<br />
moment. […] Pour les résidences longues, l’apport est de 10 000 €<br />
par an. Les autres coproductions oscillent de 3 000 à 7 000 €. On<br />
ne pourra pas faire plus. ”<br />
(Directeur, structure dédiée 9)<br />
La dérive vers des coproductions à un niveau similaire à celui<br />
de préachats de représentations à peine améliorés est dénoncée par<br />
certaines directions de structures.<br />
“ On a un problème dans la profession parce que les définitions ne<br />
sont pas les mêmes, tout comme pour les résidences. […] J’ai passé<br />
cinq ans en tant que Président du réseau X à me battre avec mes<br />
collègues pour qu’ils ne mettent pas indûment sur un dossier préachat<br />
ou coproduction. Par exemple, le spectacle vaut 5000 € ; je mets<br />
4000 en coproduction, je les verse quand je peux et je te rajouterai<br />
1000 € au moment du spectacle. ”<br />
(Directeur, structure pluridisciplinaire 8)<br />
Les accords de coproduction s’accompagnent souvent d’une<br />
mise à disposition gracieuse des compétences du personnel de la<br />
structure. Cependant, l’emploi d’intermittents pour les besoins du<br />
montage et de l’exploitation de la création sur place peut être refacturé<br />
aux compagnies. La prise en charge de dépassements de frais,<br />
par exemple pour la construction des décors, est difficile à faire<br />
accepter (compagnie 13).<br />
Les sociétés en participation permettent de solidariser financièrement<br />
les partenaires dans la conduite du projet de spectacle, en<br />
partageant le résultat final selon la clé de répartition convenue, ce<br />
qui les incite à suivre les étapes du projet sur les plans artistique<br />
et budgétaire. Les accords de coproduction simple sont beaucoup<br />
plus fréquents que la formation de sociétés en participation dans<br />
le monde de la danse. Cela constitue un obstacle à l’engagement<br />
des coproducteurs dans le suivi budgétaire du projet.<br />
47. Bernard Latarjet, « Pour un débat sur l’avenir du spectacle vivant. Compte-rendu de mission », Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, 2004.