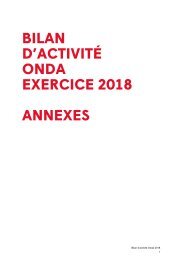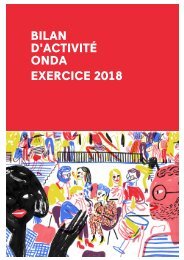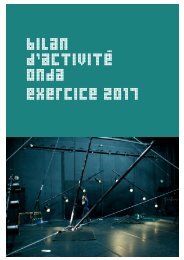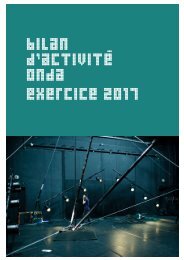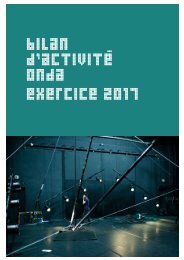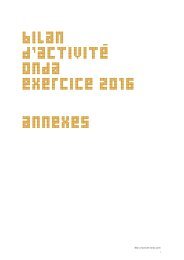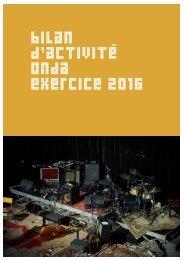Onda_etudedanse_complet
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
LA MISE EN RELATION DES COMPAGNIES ET DES STRUCTURES DE DIFFUSION<br />
47<br />
“ Il faut se méfier du jeunisme qui traîne. Et puis cette histoire d’artistes<br />
qui ont été découverts à un moment donné ; les directeurs<br />
aiment bien être ceux qui ont découvert, qui portent et puis plus rien.<br />
Ce sont des effets de mode qui ont fait énormément de mal. Dans les<br />
années 90, c’était exactement la même chose ; ce n’est pas nouveau. ”<br />
(Directeur, structure dédiée 9)<br />
La construction de l’équilibre de la programmation suppose de<br />
pondérer la place offerte aux équipes renommées, susceptibles de<br />
drainer un public élargi. Par exemple dans la structure pluridisciplinaire<br />
8, « il y a un quart de gros porteurs, un quart d’émergence<br />
et une moitié intermédiaire ». Une limite soulignée par des directions<br />
de structures dans plusieurs entretiens porte néanmoins sur le<br />
manque de culture chorégraphique des spectateurs et spectatrices<br />
occasionnelles, qui ne connaissent pas les noms des chorégraphes<br />
réputés dans le monde de la danse contemporaine professionnel<br />
lors de la présentation de saison. La formation d’un effet de locomotive<br />
par des équipes renommées requiert donc un investissement<br />
relationnel de l’équipe pour faire connaître leur travail auprès du<br />
public et stimuler une fréquentation plus importante.<br />
La position intermédiaire des compagnies, après l’émergence et<br />
avant une reconnaissance confirmée, peut être considérée comme<br />
un obstacle à la programmation dans les structures quand celle-ci<br />
est perçue sous la forme d’une bipolarisation autour de ces deux<br />
niveaux de réputation. Cela pose la question cruciale d’un défaut<br />
systémique d’accompagnement des parcours des chorégraphes.<br />
“ Et d’un autre côté, les gens qui commencent à prendre de l’ampleur,<br />
on va les jeter parce que finalement ce n’est plus nouveau. Mais qui<br />
s’engage pour continuer à développer et à accompagner ? Ce que<br />
disait X, il m’a dit, un jour, tu es dans la merde parce que pour toi<br />
commence la traversée du désert : tu n’es plus un jeune chorégraphe<br />
et en plus tu n’es pas encore assez connu, bon courage ! ”<br />
(Directeur, structure dédiée 2)<br />
Les lacunes de la parité dans le secteur des arts de la scène 30<br />
obligent les directions des structures à prendre en compte la sexuation<br />
des maîtrises d’œuvre lors des arbitrages de programmation, en<br />
complément de l’appréciation des qualités artistiques. L'exploitation<br />
de la base de données de la SACD a confirmé la domination des<br />
directions artistiques masculines dans la diffusion des spectacles par<br />
des séries de représentations plus nombreuses. De plus, le public de<br />
la danse est majoritairement féminin 31 . L’exploitation des données<br />
du questionnaire adressé aux compagnies, sous la forme d’une analyse<br />
factorielle des correspondances 32 concernant la diffusion des<br />
spectacles selon la composition sexuée des directions, le niveau de<br />
rayonnement et de subventionnement des équipes artistiques (voir<br />
annexe 1), confirme la diffusion moins importante des spectacles<br />
produits par des directions féminines, ainsi que leur surreprésentation<br />
parmi les compagnies au rayonnement local et les équipes qui<br />
ne sont soutenues ni par l’État, ni par la Région. Les femmes sont<br />
également sous-représentées dans les directions actuelles des 19<br />
CCN avec trois directions uninominales, un duo mixte et un collectif<br />
constitué à parité égale 33 .<br />
Lors des entretiens, certaines directions masculines, comme<br />
dans les structures 9 et 12, ont affirmé attacher une importance<br />
cruciale à la parité dans la façon de penser l’équilibre de leur programmation<br />
chorégraphique.<br />
Le choix des œuvres selon leur ancienneté<br />
Le choix de programmation des œuvres selon leur ancienneté<br />
influence l’étendue du répertoire que les compagnies peuvent entretenir<br />
de façon viable. L’attrait de la nouveauté tendrait à privilégier<br />
les dernières créations des producteurs et les préachats de représentations<br />
de spectacles en gestation. L’esthétique parfois datée des<br />
pièces du répertoire des compagnies constitue un obstacle à leur<br />
reprise si le spectacle n’a pas bénéficié d’une valorisation patrimoniale,<br />
comme les « titres phares » évoqués dans la partie 1.<br />
Cette attraction de la nouveauté ne se traduit pas forcément<br />
par des tournées plus importantes pour la dernière création. En<br />
effet, la présence des programmateurs est souvent concentrée sur la<br />
première série de représentations, à un moment où la pièce a encore<br />
des fragilités. La perception d’un manque de maturité du spectacle<br />
constituera un obstacle pour sa future diffusion.<br />
Les choix des directions de structures en faveur des dernières<br />
créations entrent également en interaction avec les capacités de<br />
diffusion des compagnies.<br />
“ On programme plutôt les dernières créations. Mais on a entrepris<br />
la présentation de reprises en même temps, à partir de la dernière<br />
création qu’on a eue, quand les compagnies le peuvent - parce que les<br />
compagnies n’ont pas forcément de répertoire car ça peut créer des problèmes<br />
financiers. Donc certaines peuvent reprendre des pièces qu’elles<br />
ont déjà jouées, et on les suit dans les créations, d’année en année. ”<br />
(Directeur, structure 10)<br />
La possibilité de programmer les pièces du répertoire d’une<br />
compagnie est notamment liée à son ancrage dans la structure.<br />
“ Pour les artistes que l’on coproduit, on est souvent sur la dernière<br />
création ou l’avant-dernière. Pour les artistes qui sont en résidence<br />
longue, on travaille sur cette histoire de répertoire. Pour permettre<br />
aux œuvres de vivre, pour permettre aux spectateurs de faire dialoguer<br />
des pièces, de voir plusieurs facettes. ”<br />
(Directrice déléguée, structure dédiée 9)<br />
L’exploitation de la base de la SACD a néanmoins indiqué une<br />
tendance à l’allongement de la durée d’exploitation des spectacles<br />
entre 2011 et 2015, notamment pour les durées se situant entre deux<br />
et quatre années.<br />
Les réponses des compagnies au questionnaire tendent à confirmer<br />
cette évolution quand on compare le nombre moyen de spectacles<br />
créés l’année même de leur diffusion avec celui des spectacles créés<br />
antérieurement encore en diffusion. Le nombre moyen de spectacles<br />
créés et joués la même année est passé de 23,6 % du total moyen<br />
des spectacles diffusés en 2014 à 19 % en 2016. Le nombre moyen<br />
de représentations par spectacle a été cependant plus élevé pour<br />
les nouveaux spectacles et cet écart s’est creusé entre 2014 et 2016.<br />
30. DEPS, Observatoire de l’égalité entre hommes et femmes dans la culture et la communication. 2019, Paris, MCC, 2019.<br />
31. D’après l’enquête nationale ministérielle de 2008 sur les pratiques culturelles des Français, les femmes représentent 62% du public de la danse. (Laurent Babé, « Les<br />
publics de la danse. Exploitation de la base d’enquête du DEPS Les pratiques culturelles des Français à l’ère du numérique. Année 2008 », Repères DGCA, N°6.03, 2012, p. 3).<br />
32. L’analyse factorielle des correspondances a consisté à calculer des distances entre différentes variables caractéristiques des compagnies répondantes en les proportionnant<br />
à leur degré de corrélation positive ou négative. Les distances sont minimes quand deux variables sont fortement corrélées et importantes quand ces deux variables<br />
sont indépendantes. La projection de ces distances sur un plan permet ainsi de visualiser l’intensité de ces corrélations selon le degré de proximité ou d’éloignement spatial<br />
des variables représentées sur le plan.<br />
33. Le collectif (La) Horde nommé à la direction du CCN de Marseille à partir de septembre 2019 est majoritairement masculin.