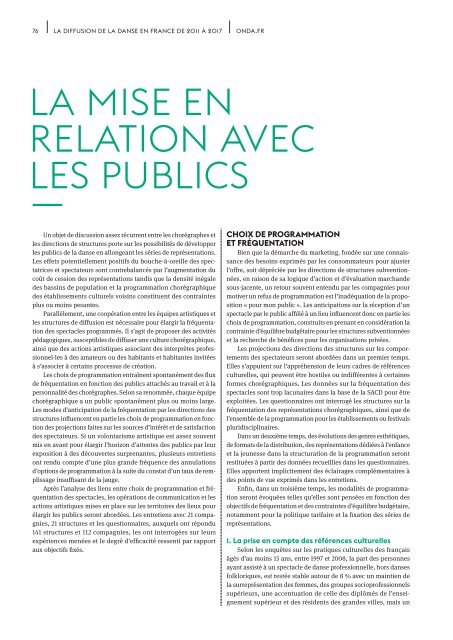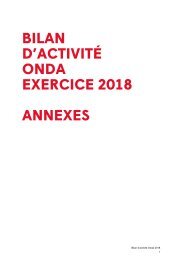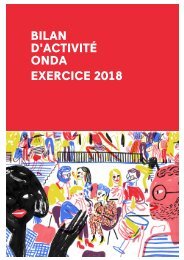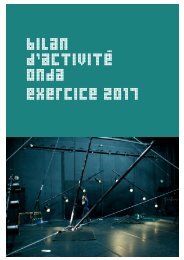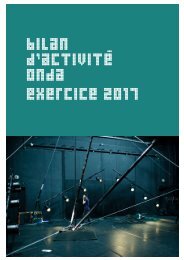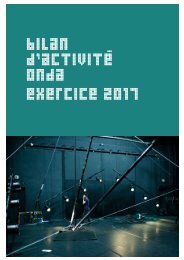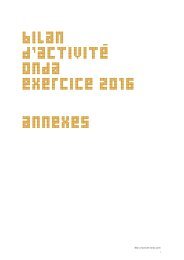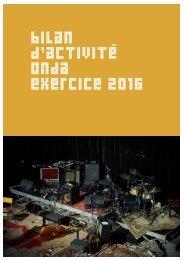Onda_etudedanse_complet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
76 LA DIFFUSION DE LA DANSE EN FRANCE DE 2011 À 2017 ONDA.FR<br />
LA MISE EN<br />
RELATION AVEC<br />
LES PUBLICS<br />
––<br />
Un objet de discussion assez récurrent entre les chorégraphes et<br />
les directions de structures porte sur les possibilités de développer<br />
les publics de la danse en allongeant les séries de représentations.<br />
Les effets potentiellement positifs du bouche-à-oreille des spectatrices<br />
et spectateurs sont contrebalancés par l’augmentation du<br />
coût de cession des représentations tandis que la densité inégale<br />
des bassins de population et la programmation chorégraphique<br />
des établissements culturels voisins constituent des contraintes<br />
plus ou moins pesantes.<br />
Parallèlement, une coopération entre les équipes artistiques et<br />
les structures de diffusion est nécessaire pour élargir la fréquentation<br />
des spectacles programmés. Il s’agit de proposer des activités<br />
pédagogiques, susceptibles de diffuser une culture chorégraphique,<br />
ainsi que des actions artistiques associant des interprètes professionnel∙les<br />
à des amateurs ou des habitants et habitantes invitées<br />
à s’associer à certains processus de création.<br />
Les choix de programmation entraînent spontanément des flux<br />
de fréquentation en fonction des publics attachés au travail et à la<br />
personnalité des chorégraphes. Selon sa renommée, chaque équipe<br />
chorégraphique a un public spontanément plus ou moins large.<br />
Les modes d’anticipation de la fréquentation par les directions des<br />
structures influencent en partie les choix de programmation en fonction<br />
des projections faites sur les sources d’intérêt et de satisfaction<br />
des spectateurs. Si un volontarisme artistique est assez souvent<br />
mis en avant pour élargir l’horizon d’attentes des publics par leur<br />
exposition à des découvertes surprenantes, plusieurs entretiens<br />
ont rendu compte d’une plus grande fréquence des annulations<br />
d’options de programmation à la suite du constat d’un taux de remplissage<br />
insuffisant de la jauge.<br />
Après l’analyse des liens entre choix de programmation et fréquentation<br />
des spectacles, les opérations de communication et les<br />
actions artistiques mises en place sur les territoires des lieux pour<br />
élargir les publics seront abordées. Les entretiens avec 21 compagnies,<br />
21 structures et les questionnaires, auxquels ont répondu<br />
141 structures et 112 compagnies, les ont interrogées sur leurs<br />
expériences menées et le degré d’efficacité ressenti par rapport<br />
aux objectifs fixés.<br />
CHOIX DE PROGRAMMATION<br />
ET FRÉQUENTATION<br />
Bien que la démarche du marketing, fondée sur une connaissance<br />
des besoins exprimés par les consommateurs pour ajuster<br />
l’offre, soit dépréciée par les directions de structures subventionnées,<br />
en raison de sa logique d’action et d’évaluation marchande<br />
sous-jacente, un retour souvent entendu par les compagnies pour<br />
motiver un refus de programmation est l’inadéquation de la proposition<br />
« pour mon public ». Les anticipations sur la réception d’un<br />
spectacle par le public affilié à un lieu influencent donc en partie les<br />
choix de programmation, construits en prenant en considération la<br />
contrainte d’équilibre budgétaire pour les structures subventionnées<br />
et la recherche de bénéfices pour les organisations privées.<br />
Les projections des directions des structures sur les comportements<br />
des spectateurs seront abordées dans un premier temps.<br />
Elles s’appuient sur l’appréhension de leurs cadres de références<br />
culturelles, qui peuvent être hostiles ou indifférentes à certaines<br />
formes chorégraphiques. Les données sur la fréquentation des<br />
spectacles sont trop lacunaires dans la base de la SACD pour être<br />
exploitées. Les questionnaires ont interrogé les structures sur la<br />
fréquentation des représentations chorégraphiques, ainsi que de<br />
l’ensemble de la programmation pour les établissements ou festivals<br />
pluridisciplinaires.<br />
Dans un deuxième temps, des évolutions des genres esthétiques,<br />
de formats de la distribution, des représentations dédiées à l’enfance<br />
et la jeunesse dans la structuration de la programmation seront<br />
restituées à partir des données recueillies dans les questionnaires.<br />
Elles apportent implicitement des éclairages complémentaires à<br />
des points de vue exprimés dans les entretiens.<br />
Enfin, dans un troisième temps, les modalités de programmation<br />
seront évoquées telles qu’elles sont pensées en fonction des<br />
objectifs de fréquentation et des contraintes d’équilibre budgétaire,<br />
notamment pour la politique tarifaire et la fixation des séries de<br />
représentations.<br />
1. La prise en compte des références culturelles<br />
Selon les enquêtes sur les pratiques culturelles des français<br />
âgés d’au moins 15 ans, entre 1997 et 2008, la part des personnes<br />
ayant assisté à un spectacle de danse professionnelle, hors danses<br />
folkloriques, est restée stable autour de 8 % avec un maintien de<br />
la surreprésentation des femmes, des groupes socioprofessionnels<br />
supérieurs, une accentuation de celle des diplômés de l’enseignement<br />
supérieur et des résidents des grandes villes, mais un