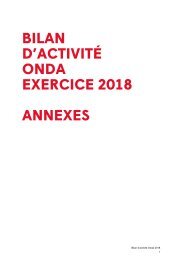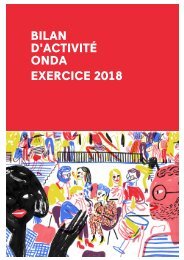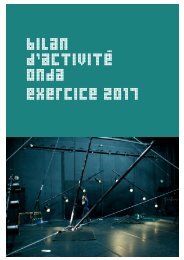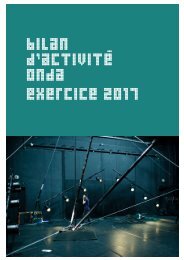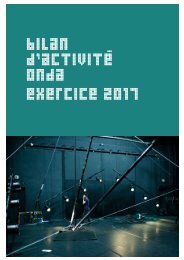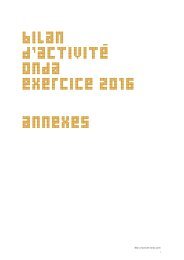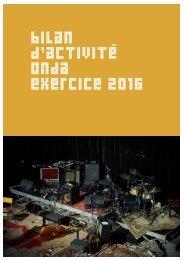Onda_etudedanse_complet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
88 LA DIFFUSION DE LA DANSE EN FRANCE DE 2011 À 2017 ONDA.FR<br />
D’autres structures misent sur la temporalité événementielle afin<br />
de gagner en visibilité sur le territoire, auprès des professionnel∙les<br />
de la danse, qui peuvent découvrir une diversité de spectacles dans<br />
un espace-temps resserré, et pour diversifier les publics.<br />
“ J’ai fait un festival, un temps fort dédié à la création, pour que,<br />
médiatiquement, il y ait quelque chose de visible et pour amener un<br />
autre type de public. Et la diversité du festival a créé le fait que des<br />
gens de l’art contemporain, du cinéma, de l’art visuel sont venus dans<br />
notre établissement alors qu’ils l’avaient un peu déserté. ”<br />
(Directrice, structure dédiée 11)<br />
Dans certains cas, à défaut d’avoir les moyens de financer une<br />
programmation saisonnière en danse, la création d’un festival peut<br />
offrir une opportunité pour gagner en visibilité professionnelle à<br />
l’égard de ses partenaires.<br />
“ En termes de visibilité, le festival donnait un coup de projecteur.<br />
Notre travail n’était plus que souterrain. La création, l’éducation artistique<br />
et culturelle sont souterrains, la coréalisation met en lumière<br />
les autres lieux. Le festival nous met en lumière. Et donc ça amène<br />
plus de reconnaissance. ”<br />
(Directeur, structure dédiée 9)<br />
Des temps forts s’articulent à la programmation saisonnière<br />
dans un esprit de renforcement de la présence de la danse dans<br />
l’offre artistique de la structure.<br />
“ Je voulais une programmation régulière de la danse. J’ai infléchi<br />
sérieusement la première année en faisait un temps fort tous les ans<br />
et non plus seulement tous les deux ans tout en ayant une programmation<br />
dans l’année. ”<br />
(Directrice, structure pluridisciplinaire 19)<br />
Certains temps forts peuvent programmer exclusivement des<br />
compagnies régionales afin de sensibiliser les organisateurs et organisatrices<br />
de spectacles locaux aux intérêts de la danse contemporaine<br />
par le visionnement de ces spectacles et l’organisation de rencontres<br />
réflexives afin de consolider leur argumentaire de justifications pour<br />
négocier avec les collectivités territoriales (structure dédiée 2).<br />
En conclusion de cette section, la politique tarifaire apparaît<br />
majoritairement comme un moyen assez important pour développer<br />
les publics de la danse pour les structures de diffusion. La fixation<br />
des niveaux des bas tarifs engage des choix conditionnés par la vision<br />
du projet artistique et culturel de la direction, la situation socioéconomique<br />
et le degré d’appétence pour la culture chorégraphique<br />
de la population locale. Elle constitue un outil complémentaire des<br />
actions d’éveil pour les spectacles de danse.<br />
À l’opposé d’une opinion répandue parmi les chorégraphes,<br />
l’allongement des séries de représentations est considéré par les<br />
structures comme un moyen peu important pour favoriser le développement<br />
du public de la danse. Pourtant une corrélation positive est<br />
discernable entre la longueur des séries et le nombre total de représentations.<br />
Selon la vision dominante des structures, l’importance<br />
de la fréquentation serait ainsi la condition pour un allongement<br />
des séries de représentations et non pas sa résultante.<br />
Enfin les temps forts concentrent la majeure partie de la programmation<br />
chorégraphique des lieux de spectacles du panel. Cette part<br />
est plus élevée pour les structures dédiées à la danse et est d’autant<br />
plus forte pour les programmations chorégraphiques en expansion<br />
ou plus centrées sur des équipes régionales.<br />
LA COMMUNICATION<br />
Dans un environnement marqué par une sur sollicitation informationnelle<br />
des attentions individuelles, une diversité de canaux de<br />
distribution et de supports (en papier, numériques, audiovisuels) est<br />
mobilisée pour tenter d’éveiller un intérêt pour la programmation et<br />
les activités artistiques menées sur le territoire, et susciter un désir<br />
de les fréquenter. Dans le cadre contractuel habituel, les structures<br />
de diffusion se chargent de la promotion locale des spectacles en<br />
s’appuyant sur les matériaux informationnels et graphiques fournis<br />
par les compagnies. Cette sous-partie sera donc centrée sur la<br />
communication effectuée par les structures en s’appuyant sur les<br />
matériaux fournis par les compagnies programmées.<br />
La mission de service public a défini historiquement le projet<br />
de démocratisation culturelle autour d’une adresse au plus<br />
grand nombre. La diversité des cadres de références culturelles,<br />
des connaissances chorégraphiques et des revenus requiert néanmoins<br />
un ajustement des messages selon les cibles choisies. En<br />
réponse à la question de l’importance des moyens utilisés pour<br />
développer le public de la danse, les structures répondantes ont<br />
ainsi classé en moyenne « une communication plus adaptée » au<br />
troisième rang, derrière « la diversification des partenariats avec les<br />
relais (non culturels) » puis un « développement des relations avec<br />
les artistes avant / après le spectacle ».<br />
La communication institutionnelle est plus orientée vers la valorisation<br />
de l’image d’une structure et complète les opérations de<br />
promotion des différents spectacles programmés. Les rapports aux<br />
médias se caractérisent par des sollicitations pour obtenir le relais<br />
des informations sur les activités artistiques auprès de la presse<br />
écrite et audiovisuelle.<br />
1. Les stratégies de communication<br />
La stratégie de communication repose d’abord sur l’identité<br />
de la structure que l’équipe souhaite projeter afin de valoriser la<br />
conduite de son projet artistique et culturel, et s’appuie sur l’image<br />
des compagnies programmées qui ont construit un micro-public<br />
fidélisé. La mise en avant des thématiques culturelles des spectacles<br />
présentés, des dispositifs d’action artistique sur le territoire et de la<br />
vie du lieu constitue un axe complémentaire pour attirer l’attention<br />
des spectateurs, spectatrices et des personnes résidentes dans le<br />
territoire qui ne fréquentent pas le lieu.<br />
Comme les moyens budgétaires sont limités, les arbitrages<br />
conduisent à hiérarchiser des cibles dans la population locale et<br />
à décider d’une adaptation ou non des messages en fonction de la<br />
vision de leurs grilles de références culturelles partagée par l’équipe<br />
de la structure.<br />
L’image de l’organisation<br />
Selon une logique de communication institutionnelle, une<br />
fonction du site Internet est de constituer une vitrine d’exposition<br />
des activités artistiques menées par la structure ou la compagnie<br />
en fonction de la philosophie d’action culturelle de sa direction.<br />
La visibilité des activités artistiques et culturelles est également<br />
un enjeu pour les relations avec les collectivités publiques qui les<br />
subventionnent.