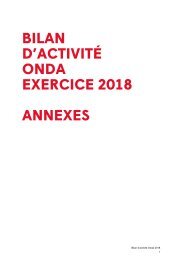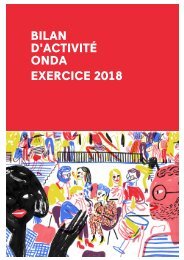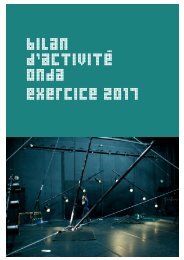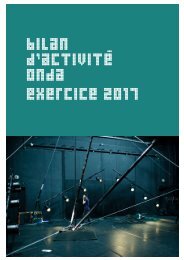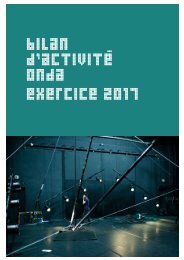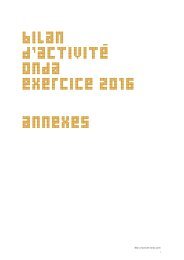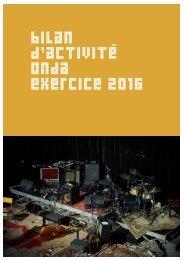Onda_etudedanse_complet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LA MISE EN RELATION DES COMPAGNIES ET DES STRUCTURES DE DIFFUSION<br />
53<br />
En conclusion de cette sous-partie, les critères subjectifs d’appréciation<br />
des spectacles sont complétés dans les choix de programmation par<br />
la prise en compte de critères plus objectivés, fondés sur les contraintes<br />
budgétaires, matérielles, politiques locales des structures et la recherche<br />
d’un équilibrage entre les familles esthétiques, la composition sexuée<br />
des directions artistiques, le degré de complexité et la renommée des<br />
spectacles.<br />
Les rapports de concurrence des structures de diffusion en fonction<br />
de leur niveau de réputation sont complétés par de nécessaires liens de<br />
coopération avec des établissements culturels ou festivals du territoire<br />
mais aussi des lieux non dédiés au spectacle vivant, notamment en<br />
lien avec des relais dans les domaines social, scolaire ou patrimonial.<br />
Une pression systémique s’exerce sur les compagnies pour créer de<br />
nouveaux spectacles afin de maintenir leur visibilité professionnelle<br />
et tenter de capter le soutien de structures pour leur coproduction, le<br />
plus souvent liée aux premières séries de représentations, ainsi que<br />
leur programmation ultérieure.<br />
LES STRATÉGIES DES COMPAGNIES<br />
Les compagnies s’appuient sur un projet d’entreprise construit<br />
en fonction de leurs nécessités artistiques et du choix d’un territoire<br />
d’implantation qui oriente les activités de formation professionnelle<br />
ou de sensibilisation artistique. Les réponses au questionnaire ont<br />
confirmé une corrélation significativement positive entre le niveau du<br />
budget, l’ancienneté de la compagnie et le nombre de représentations<br />
chorégraphiques. Le développement des équipes artistiques est ainsi<br />
conditionné par leur capacité à étendre leur réseau de diffusion.<br />
La reconnaissance de l’originalité des spécificités esthétiques et<br />
d’une réflexion dramaturgique pertinente constitue un enjeu important<br />
pour construire une identité qui permette de se positionner dans des<br />
circuits de production et de distribution devenus plus concurrentiels.<br />
Les choix effectués par les équipes chorégraphiques en termes<br />
d’organisation du travail pour tenter de capter des opportunités de<br />
production et de diffusion des spectacles seront d’abord questionnés.<br />
La mise en visibilité des créations constitue un enjeu majeur pour le<br />
devenir de la diffusion et l’évolution de la réputation professionnelle<br />
des compagnies. Enfin, la recherche de lieux pour créer les spectacles<br />
est vitale et passe notamment par la quête de résidences dans les établissements<br />
culturels.<br />
1. L’organisation du travail des compagnies<br />
L’évolution du positionnement artistique des compagnies est<br />
tributaire de la perception positive ou négative de la démarche des<br />
chorégraphes par les programmateurs et programmatrices, ce qui<br />
influence le niveau des recettes d’activité et donc les capacités organisationnelles.<br />
L’organisation du travail administratif de prospection<br />
des opportunités de coproduction et de diffusion engage des choix en<br />
termes d’internalisation des missions au sein de l’équipe artistique ou de<br />
leur externalisation auprès de bureaux d’accompagnement. Les outils<br />
de communication utilisés pour la diffusion auprès des professionnels<br />
ont été interrogés dans les entretiens et le questionnaire en ligne.<br />
Le positionnement artistique : quels enjeux organisationnels ?<br />
Les entretiens ont dégagé plusieurs sources principales d’obstacles<br />
à la programmation, liés aux perceptions contrastées du positionnement<br />
artistique des compagnies et à son évolution.<br />
Deux compagnies qui se situent entre la danse et les arts de la rue,<br />
ou les arts du cirque, ont relevé un problème d’identification pour les<br />
réseaux de diffusion qui ont tendance à se spécialiser dans un domaine<br />
artistique spécifique. La relative indétermination pour situer le travail<br />
de la compagnie entre deux genres constitue ainsi un enjeu de<br />
négociation avec les établissements culturels pour les partenariats de<br />
production et de diffusion.<br />
“ Pour nous, on est vraiment dans de la danse, et quand on prétend à des<br />
aides, des accueils studios c’est de la danse, et souvent on met cirque en<br />
face et ce n’est pas le cas. Oui, parfois il faut réajuster un petit peu mais<br />
ce n’est pas forcément problématique. Ça ne nous empêche pas de faire<br />
notre route et d’avoir une reconnaissance dans le milieu de la danse. ”<br />
(Administratrice, compagnie 2)<br />
Le trouble d’identification disciplinaire est compensé par l’intérêt<br />
esthétique porté pour le travail de ces chorégraphes, d’autant plus qu’une<br />
logique de programmation mise en avant dans les entretiens tend à privilégier<br />
l’appréciation des œuvres sans se référer aux catégorisations<br />
artistiques. L’entre-deux artistique peut ainsi servir à la construction d’un<br />
positionnement esthétique original, apprécié lors du début de carrière<br />
de la compagnie, et être vécu par la suite comme un obstacle durable à<br />
l’élargissement des réseaux de production et de diffusion.<br />
“ On a une reconnaissance institutionnelle totale et, malgré tout, on<br />
pêche dans les partenariats en production et diffusion : il y a une<br />
sorte d’inadaptation du projet de la compagnie aux programmes<br />
des uns et des autres. ”<br />
(Chorégraphe, compagnie 9)<br />
La séparation de chorégraphes ayant formé un duo reconnu crée<br />
un flottement dans l’identification des nouvelles compagnies qu’ils ou<br />
elles ont créées et leur accompagnement par des programmateurs et<br />
programmatrices, qui peuvent se placer majoritairement en position<br />
d’attente. Le travail relationnel à mener pour convaincre des directions<br />
de structures de s’engager dans le soutien des projets de spectacles est<br />
ainsi sensiblement augmenté dans un premier temps. Il en va de même,<br />
dans une moindre mesure, lors des moments de transition quand des<br />
chorégraphes particulièrement apprécié·es en tant que danseuses ou<br />
danseurs laissent la place à des artistes interprètes dans la distribution<br />
de nouveaux spectacles sans leur présence.<br />
L’appréciation de la pertinence des parti-pris esthétiques dans les<br />
réseaux de structures labellisées s’appuie aussi a priori sur le discours<br />
des chorégraphes pour situer le sens de leur travail. L’attente tacite de<br />
références philosophiques ou à l’histoire de la danse peut décontenancer<br />
certaines équipes à la démarche plus pragmatique.<br />
“ Même pour le tout jeune public, là on est en création d’un projet sur<br />
l’enfant et le jeu. On a tous, gamin, eu l’idée de prendre des cartons<br />
et de jouer avec ; ça devient ceci, cela, et ça laisse juste la place à<br />
l’imaginaire. Donc on part juste de ça, et première question : qu’est-ce<br />
que tu veux dire vraiment là-dedans ? Qu’est-ce que tu veux chercher<br />
comme sens, le propos ? Mais ce que je viens de dire ce n’est pas<br />
suffisant ? C’est toujours comme s’il faut, pour être reconnu, avoir<br />
une espèce d’intellect pas possible autour des envies. Pourquoi il faut<br />
toujours lier ça avec un propos intellectuel qu’il faut aller triturer ? ”<br />
(Codirectrice, compagnie 1)<br />
Le problème se pose aussi pour des compagnies confirmées de<br />
longue date quand l’esthétique du chorégraphe s’appuie sur une<br />
démarche plus instinctive que théorique et est perçue comme datée<br />
par de nouvelles directions de lieux. L'effort d'adaptation est d'autant<br />
plus grand que le resserrement de la contrainte budgétaire des structures<br />
a réduit leur propension à consentir à des prix de cession élevés.