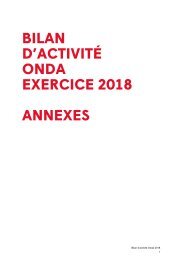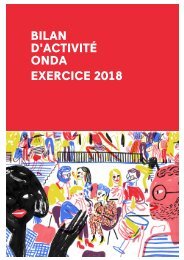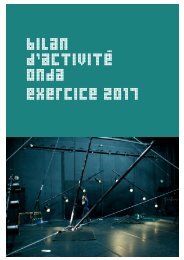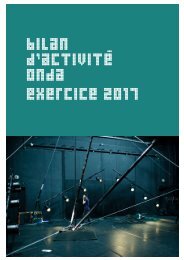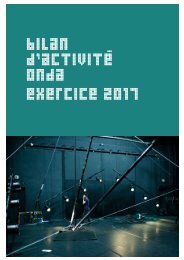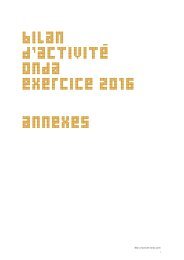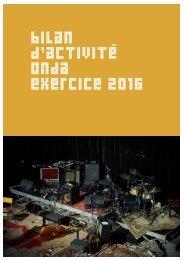Onda_etudedanse_complet
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
LA MISE EN RELATION AVEC LES PUBLICS<br />
79<br />
supérieures et des moyens pour améliorer leur visibilité professionnelle<br />
sur les scènes. De plus, les rapports de projection-identification<br />
des membres des catégories sociales populaires lors des spectacles<br />
sont-ils plus facilement stimulés par des équipes plus mixtes dans leur<br />
composition sociale et culturelle ?<br />
Des constats sur le parallélisme entre la composition socio-ethnique<br />
des compagnies programmées et celle de la salle ont été effectués,<br />
notamment en ce qui concerne la programmation du hip-hop :<br />
“Après la mixité, on l’a créée plus quand il y a des personnes sur<br />
scène qui représentent aussi cette diversité. D’ailleurs la plus grande<br />
mixité généralement dans la salle, on la trouve quand on a fait par<br />
exemple le concert avec X et Y, un musicien congolais ; je crois que<br />
c’était le public le plus mixte que j’ai vu. Après en danse ça dépend,<br />
quand il y a des choses qui sont empruntées aux cultures urbaines… ;<br />
il y a plus de jeunes, plus de diversité dans la salle.”<br />
(Responsable des relations publiques, structure dédiée 6)<br />
D’autres positionnements se montrent plus prudents sur les<br />
risques d’une segmentation communautaire d’une offre artistique<br />
qui serait ajustée aux attentes supposées de groupes sociaux dominés<br />
en privilégiant la recherche de la pertinence des propositions<br />
dans le contexte territorial.<br />
“ Sur la question de la diversité, on est vigilant qu’il y ait une diversité<br />
dans la salle mais aussi une diversité au plateau. Mais on ne se<br />
méprend pas sur la diversité au plateau. Programmer du hip-hop,<br />
c’est une réalité stigmatisée ; programmer X, c’est une écriture du<br />
monde. La diversité, c’est programmer du droit commun porté par<br />
des noirs, des arabes, etc.”<br />
(Directeur, structure pluridisciplinaire 18)<br />
Programmer des œuvres chorégraphiques de référence nationale<br />
ou internationale en complément de pratiques artistiques locales<br />
fait sens dans une mission de service public culturel.<br />
Dans un climat politique marqué par la perception d’une<br />
recrudescence des tensions interculturelles, en lien notamment<br />
avec l’accentuation des inégalités socio-économiques, le positionnement<br />
artistique des structures est exposé à des situations<br />
parfois plus délicates pour la liberté de programmation. La nudité<br />
des corps dans un spectacle de danse semble devenue un tabou<br />
culturel plus prégnant, notamment pour les représentations adressées<br />
à l’enfance et la jeunesse ou organisées en dehors des murs.<br />
Les émotions négatives soulevées par la vision de la nudité, même<br />
si elle est très brève, pour des personnes sensibles à la pudeur par<br />
leurs valeurs culturelles peuvent avoir des effets contre-productifs<br />
pour la conduite d’un projet artistique. Le risque est de bloquer<br />
une partie des spectateurs et spectatrices sur des a priori négatifs<br />
si des séquences dansées sont seulement perçues sous l’angle de<br />
la provocation.<br />
“ La nudité à l’extérieur, ce n’est pas possible ne serait-ce qu’une<br />
seconde. Il faut avoir conscience de la place du rapport au corps par<br />
le fait religieux qui n’est pas que le fait de l’islam ; les évangélistes<br />
sont très présents et on trouve le même phénomène. La transgression<br />
d’un certain nombre de tabous, il faut l’aborder de manière un peu<br />
fine. Je pense que l’on a besoin de faire un peu creuset commun dans<br />
ce pays. Dans la salle, on y est attentif aussi. C’est trop dégradé. ”<br />
(Directeur, structure pluridisciplinaire 18)<br />
La question est d’autant plus paradoxale que l’exposition de la<br />
nudité s’est développée dans les médias audiovisuels et les publicités.<br />
Cela incite certaines directions de structures de diffusion<br />
à traiter leurs arbitrages de programmation sans s’autocensurer<br />
vis-à-vis des risques accrus de surinterprétation et à s’impliquer<br />
dans des discussions pédagogiques avec leurs partenaires non<br />
artistiques.<br />
“ La question de la nudité ne nous pose aucun problème mais, à<br />
un moment donné, c’est important de la montrer aujourd’hui<br />
alors qu’avant, il a pu y avoir un effet de mode ; ça ne faisait rien.<br />
Aujourd’hui ça se resserre ; avec le corps performatif, sportif, le bien<br />
être, le culte du corps a changé. Comment montrer la nudité sur scène<br />
alors qu’on en voit partout sur les écrans ? C’est pire qu’il y a 10 ou<br />
15 ans. Si ça a du sens on doit pouvoir le montrer sans se poser la<br />
question de savoir si ça va choquer ou pas. ”<br />
(Directrice déléguée, structure dédiée 9)<br />
Aborder les questions de violence, de sexualité dans les spectacles<br />
chorégraphiques, même de façon indirecte, suscite néanmoins<br />
des appréhensions accrues pour la programmation dans des structures<br />
dépendantes du seul financement municipal.<br />
“ On sent une difficulté pour les programmateurs à convaincre,<br />
surtout quand c’est du jeune public, à convaincre les instituteurs<br />
et les chargés culturels municipaux. On sent qu’il y a quelque chose<br />
qui se tend ; ça s’est accentué après les attentats. Il y a cette peur<br />
des instituteurs de qu’est ce qui va être montré aux enfants et il y a<br />
la peur des élus sur la responsabilité du théâtre municipal d’avoir<br />
programmé ça. Qu’est-ce que ça va renvoyer ? Comment ça va être<br />
interprété ? Est-ce qu’ils ne vont pas se taper un parent d’élève qui<br />
va venir hurler ? Ça s’est vraiment tendu. ”<br />
(Chorégraphe, compagnie 11).<br />
En conclusion de cette section, les structures minorent l’utilité<br />
de la programmation de spectacles grand public comme un<br />
moyen de développement des publics en préférant les relations<br />
de partenariat et les rencontres des publics avec les artistes. Dans<br />
un contexte où la part du public de la danse dans la population<br />
française est restée stable à un niveau assez bas mais s’est rajeunie,<br />
les préjugés contre la danse contemporaine constituent un<br />
obstacle à l’élargissement de la circulation de ces spectacles. Les<br />
structures de diffusion sont incitées à prêter plus d’attention à la<br />
diversité des grilles de références culturelles et sont confrontées<br />
à un renforcement de tabous sociaux.<br />
2. Les observations sur la fréquentation<br />
des spectacles de danse<br />
En réponse au questionnaire, 87 structures ont renseigné la fréquentation<br />
payante et gratuite des spectacles de danse qu’elles ont<br />
programmés ainsi que de l’ensemble de la saison pour les structures<br />
pluridisciplinaires. Ces premiers éclairages, à mettre en perspective<br />
avec la taille limitée de l’échantillon de réponses détaillées, peuvent<br />
être complétés par une analyse de l’évolution des spectacles programmés<br />
par les structures selon l’évolution du nombre de leurs<br />
représentations.