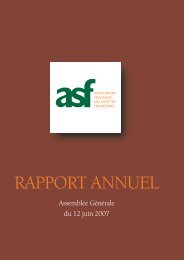2011 Le rapport annuel de l'ASF
2011 Le rapport annuel de l'ASF
2011 Le rapport annuel de l'ASF
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>de</strong> traitement entre les Etats émetteurs <strong>de</strong> la zone euro.La crise a eu pour effet <strong>de</strong> créer <strong>de</strong> la défiance et <strong>de</strong>transformer brusquement, aux yeux <strong>de</strong> ces prêteurs, <strong>de</strong>stitres souverains en placements à risque et <strong>de</strong> considérerdésormais certaines <strong>de</strong>ttes souveraines en pur objet <strong>de</strong>spéculation. La capacité <strong>de</strong> certains Etats emprunteursà honorer leurs engagements - la « soutenabilité » <strong>de</strong> la<strong>de</strong>tte - a donc été directement mise en cause.Si l’élément directement déclencheur a été la découverte <strong>de</strong>la réalité - jusque là tronquée - <strong>de</strong>s comptes grecs, chacundisposait pourtant d’éléments précis permettant <strong>de</strong> pointerles handicaps <strong>de</strong> la zone euro.• En premier lieu, c’est la fragilité originelle <strong>de</strong> laconstruction qui surprend. Au plan <strong>de</strong> la conception, iln’est semble-t-il pas d’exemple, non <strong>de</strong> création, mais<strong>de</strong> fonctionnement pérenne d’une monnaie unique enl’absence <strong>de</strong> toute structure économique ou fiscale unifiant,au moins pour partie, l’action <strong>de</strong>s divers participants auprojet commun. <strong>Le</strong> seul instrument imaginé pour assurerun minimum <strong>de</strong> discipline bugétaire commune (le Pacte<strong>de</strong> stabilité et <strong>de</strong> croissance) a été gran<strong>de</strong>ment affaibli(la limite <strong>de</strong> 3% <strong>de</strong> déficit a <strong>de</strong> fait été interprétée commeune norme et les sanctions prévues en cas d’excès n’ontjamais été appliquées). Dans le même ordre d’idée, aucuneffort n’a jamais véritablement été fait en termes <strong>de</strong> suivi<strong>de</strong> la compétitivité entre ces mêmes participants. Une telleconfiguration paraît répondre davantage aux conditions <strong>de</strong>fonctionnement d’une monnaie commune, venant s’ajouteraux <strong>de</strong>vises nationales, qu’à celles d’une monnaie uniques’y substituant.• Sur un plan plus factuel, il est certain que l’écart d’inflationconstaté entre les pays <strong>de</strong> la zone euro a permis à certains<strong>de</strong> bénéficier <strong>de</strong> taux d’intérêt réels particulièrementavantageux, facilitant un en<strong>de</strong>ttement excessif, tant du point<strong>de</strong> vue <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte publique (Grèce) que <strong>de</strong> l’en<strong>de</strong>ttementprivé (ménages et entreprises confondus) et participant,dans ce <strong>de</strong>rnier cas, à la formation d’une importante bulleimmobilière dont l’explosion n’a fait qu’aggraver encore lasituation (Espagne et Irlan<strong>de</strong>) (3).• En <strong>de</strong>rnier lieu, on ne saurait oublier qu’en toile <strong>de</strong> fondrègne toujours, <strong>de</strong>puis <strong>de</strong>s dizaines d’années, pour certainspays <strong>de</strong> la zone, la funeste accoutumance aux déficitspublics, qui participent, jour après jour, à la constructiondu mur <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte.Quoi qu’il en soit, il était nécessaire d’agir face à la crise.Deux types <strong>de</strong> moyens ont été activés : l’action <strong>de</strong>s Etatset <strong>de</strong>s structures spécialisées (FMI, G20...) et l’action <strong>de</strong> laBanque centrale européenne (BCE).• Pour les trois pays les plus directement touchés (Grèce,Irlan<strong>de</strong> et Portugal), la priorité a été <strong>de</strong> faire en sortequ’ils puissent continuer à se financer. En échanged’engagements <strong>de</strong> leur part sur la mise en œuvre <strong>de</strong>mesures <strong>de</strong> rétablissement <strong>de</strong>s finances publiques et <strong>de</strong>réformes structurelles, les Etats européens et le FMI ontapporté une ai<strong>de</strong> par voie <strong>de</strong> prêts bilatéraux puis parl’intermédiaire d’une structure dédiée (le Fonds européen<strong>de</strong> stabilité financière ou FESF). Si <strong>de</strong>s progrès ont étéconstatés pour le Portugal et l’Irlan<strong>de</strong>, il n’en a pas été<strong>de</strong> même pour la Grèce, visiblement dans l’incapacitéd’atteindre les objectifs fixés. De nouvelles mesures ont doncété adoptées par les gouvernements <strong>de</strong> la zone euro et leFMI, le 21 juillet <strong>2011</strong>, renforçant les moyens d’action duFESF et adaptant le dispositif d’ai<strong>de</strong> à la situation grecque(avec, notamment, un effacement partiel - à hauteur <strong>de</strong>21% - <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte du pays). A partir du mois d’août, dansun contexte <strong>de</strong> ralentissement économique, <strong>de</strong> nouvelles ettrès fortes tensions sont apparues sur les marchés, attiséespar la crainte <strong>de</strong>s conséquences que pourrait avoir, surun système bancaire fortement détenteur <strong>de</strong> titres <strong>de</strong><strong>de</strong>ttes souveraines <strong>de</strong> pays <strong>de</strong> la zone euro, un défaut <strong>de</strong>ceux-ci dans la soutenabilité <strong>de</strong> leurs <strong>de</strong>ttes. A l’automne,<strong>de</strong> nouvelles mesures ont été adoptées, notamment unnouveau renforcement <strong>de</strong>s moyens d’action du FESF et uneffacement <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte grecque porté à 50%.Parallèlement à ces dispositifs, les réflexions se sontpoursuivies et <strong>de</strong>s décisions ont été prises au sein d’autresstructures. C’est le cas pour le G20 et également pourl’institut d’émission <strong>de</strong> la zone euro, qui a vu ses moyensd’action évoluer au fil <strong>de</strong>s différentes crises et dont le rôles’est considérablement accru.• Outre la stabilité <strong>de</strong>s prix, la Banque centrale européennedoit assurer la stabilité financière <strong>de</strong> la zone euro. Pourremplir ce second volet <strong>de</strong> sa mission dans l’environnementtourmenté <strong>de</strong> <strong>2011</strong>, l’institut d’émission européen amultiplié les initiatives innovantes, allant parfois jusqu’àl’extrême limite du cadre <strong>de</strong> règles contraignantes quifon<strong>de</strong> son statut.Ainsi <strong>de</strong> l’achat - pour <strong>de</strong>s montants cependant limités - par laBCE d’emprunts d’Etat, dont le principe même a été vivementcritiqué par certains représentants au Conseil <strong>de</strong> la Banque(allemand notamment) aux motifs qu’une telle pratiquesoulève, outre le risque inflationniste, celui d’aléa moral. Ce<strong>de</strong>rnier risque sera d’ailleurs explicitement évoqué à propos<strong>de</strong> l’Italie lorsque le Gouverneur Trichet fera dépendre lapoursuite du financement <strong>de</strong> la <strong>de</strong>tte italienne <strong>de</strong> la mise enœuvre, par les autorités publiques, <strong>de</strong> réformes structurellesfondamentales dans les meilleurs délais.Pour la BCE, la « ligne jaune » à ne pas franchir consisteraità jouer le rôle <strong>de</strong> prêteur en <strong>de</strong>rnier ressort <strong>de</strong>s Etats <strong>de</strong>la zone euro, à l’image <strong>de</strong>s mesures d’assouplissementquantitatif (« quantitative easing ») mises en œuvre parla Fe<strong>de</strong>ral Reserve américaine et par la Bank of England.Face au risque déflationniste résultant <strong>de</strong> la premièrephase <strong>de</strong> la crise, ces <strong>de</strong>ux instituts ont choisi d’injecterdirectement <strong>de</strong>s liquidités dans les circuits économiques en(3) Sur la base d’un indice 100 en 1997 - point <strong>de</strong> départ du processus<strong>de</strong> convergence vers l’adoption <strong>de</strong> la monnaie unique -, le niveau <strong>de</strong>sprix dans l’ensemble <strong>de</strong> la zone s’établit en <strong>2011</strong> à 132. L’Allemagneet la France sont en-<strong>de</strong>çà <strong>de</strong> cette moyenne (respectivement 123 et127), mais l’Irlan<strong>de</strong>, le Portugal, l’Espagne et la Grèce sont bien au<strong>de</strong>ssus (respectivement 139, 141, 146 et 158), avec un différentielallant jusqu’à 26 points pour la Grèce.Rapport ASF – juin 2012 12