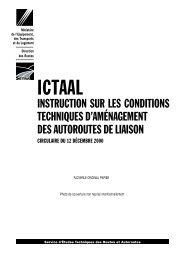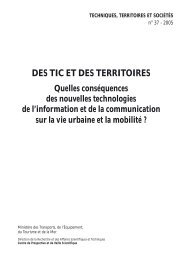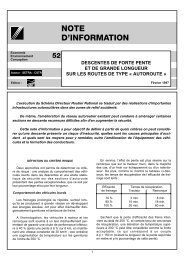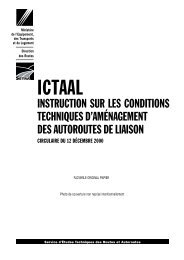Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Elles sont responsables pénalem<strong>en</strong>t. Dans le cadre de la 3CPS, la responsabilité est plus relative car il<br />
n‟y a aucun <strong>en</strong>gagem<strong>en</strong>t au regard <strong>des</strong> actions <strong>et</strong> <strong>des</strong> obligations de la commission, dans les dossiers <strong>et</strong><br />
les proj<strong>et</strong>s consultés.<br />
En résumé, le fonctionnem<strong>en</strong>t de la 3CPS inspiré de ceux <strong>des</strong> Commissions qui lui sont antérieures ne<br />
pouvait qu‟être limité dans son efficacité <strong>en</strong> raison <strong>des</strong> obj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> <strong>en</strong> conséqu<strong>en</strong>ces <strong>des</strong> objectifs très<br />
différ<strong>en</strong>ts <strong>des</strong> commissions respectives. C<strong>et</strong> échec n‟est pas le produit d‟une mauvaise volonté. La<br />
volonté sincère <strong>des</strong> gestionnaires du risque de s‟ouvrir à <strong>des</strong> pratiques moins normalisantes fondées<br />
sur l‟échange <strong>et</strong> la concertation était sincère. Le souhait d‟intégrer leur analyse dans un proj<strong>et</strong> urbain<br />
concerté n‟est pas plus suj<strong>et</strong> aux doutes. Il reste que les t<strong>en</strong>tatives d‟adaptation ne pouvai<strong>en</strong>t avoir que<br />
peu d‟eff<strong>et</strong> car ils étai<strong>en</strong>t construits sur une logique d‟expertise difficile à faire partager à <strong>des</strong><br />
part<strong>en</strong>aires d‟une culture très différ<strong>en</strong>tes de celles <strong>des</strong> gestionnaires <strong>des</strong> risques.<br />
L‟échec de la 3 CPS : impasse méthodologique sur fond de différ<strong>en</strong>ces culturelles<br />
L‟analyse du proj<strong>et</strong> <strong>des</strong> « Berges du Rhône » sous l‟angle de la prév<strong>en</strong>tion situationnelle montre que<br />
les difficultés r<strong>en</strong>contrées par la 3CPS, ti<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t moins d‟un fonctionnem<strong>en</strong>t méthodologique (qui est<br />
plus de l‟ordre d‟une conséqu<strong>en</strong>ce que d‟une cause) que d‟une forme d‟incompréh<strong>en</strong>sion. Le proj<strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> « Berges du Rhône » a <strong>en</strong> eff<strong>et</strong> mis <strong>en</strong> exergue un fossé <strong>en</strong>tre deux univers d'expertise. Celui <strong>des</strong><br />
gestionnaires du risque, d‟une part <strong>et</strong> celui <strong>des</strong> urbanistes d‟autre part. Ce fossé n„est pas que culturel<br />
il est aussi le produit du rôle social attribué aux deux parties. Comme on l‟a déjà évoqué, la Direction<br />
de la Sécurité <strong>et</strong> de la Prév<strong>en</strong>tion fait preuve d‟un s<strong>en</strong>s autocritique rare. Si la formation de<br />
gestionnaire du risque de ses membres contribue sous certains angles à creuser ce fossé, le rôle qu‟on<br />
lui attribue <strong>et</strong> surtout ce que l‟on att<strong>en</strong>d de sa fonction r<strong>en</strong>d difficile leur marge de manoeuvre, quand<br />
bi<strong>en</strong> même souhaiterait-on remplacer le terme sécurité par celui de sûr<strong>et</strong>é. Ce double handicap a<br />
conduit les membres de la commission à faire <strong>des</strong> préconisations peu conciliables avec le mode de<br />
p<strong>en</strong>sée, les formes de raisonnem<strong>en</strong>t <strong>et</strong> donc la formalisation concrète de la sûr<strong>et</strong>é <strong>en</strong> milieu urbain <strong>des</strong><br />
urbanistes. Il n‟est pas question ici de réduire les concepteurs à un mode de p<strong>en</strong>sée unique (ni à une<br />
fonction spécifique <strong>et</strong> univoque <strong>et</strong> un mode de fonctionnem<strong>en</strong>t indép<strong>en</strong>dant de conting<strong>en</strong>ces diverses,<br />
politiques, économiques <strong>et</strong> sociales) pas plus que les gestionnaires du risque dont ont soulignera<br />
<strong>en</strong>core chez certains, notamm<strong>en</strong>t responsables, une capacité d‟autoévaluation relativem<strong>en</strong>t rare. Les<br />
remarques qui suiv<strong>en</strong>t n‟ont donc qu‟une dim<strong>en</strong>sion réduite <strong>et</strong> concerne avant tout le contexte<br />
lyonnais, même si la singularité lyonnaise est relative <strong>et</strong> traduit pour partie <strong>des</strong> problèmes de fond qui<br />
ne relèv<strong>en</strong>t pas d‟une spécificité, comme on pourra le rappeler ponctuellem<strong>en</strong>t. Elle souligne, par<br />
ailleurs, une forme d‟incompréh<strong>en</strong>sion <strong>en</strong>tre les gestionnaires du risque de la ville de Lyon <strong>et</strong> les «<br />
concepteurs » du Grand Lyon plus qu‟avec ceux de la ville de Lyon peu mobiliser dans c<strong>et</strong>te étude (<strong>en</strong><br />
raison de l‟étude de cas spécifique du proj<strong>et</strong> <strong>des</strong> « Berges du Rhône »), qui ne résume pas à elle seule<br />
l‟<strong>en</strong>semble <strong>des</strong> difficultés référ<strong>en</strong>t au suj<strong>et</strong>, <strong>en</strong>tre ces deux institutions publiques.<br />
Le problème r<strong>en</strong>voie à une question précédemm<strong>en</strong>t évoquée. La délinquance n‟étant plus considérée<br />
comme un fait de société mais comme un risque son approche est nécessairem<strong>en</strong>t suj<strong>et</strong>te « à <strong>des</strong><br />
dérives bi<strong>en</strong> connu dans l‟approche <strong>des</strong> risques de types fonctionnaliste <strong>et</strong> normative <strong>et</strong> plus ou moins<br />
sectorielles » (voir chapitre précéd<strong>en</strong>t). Le premier « risque » est de rec<strong>en</strong>trer la question urbaine sur<br />
une évaluation très conting<strong>en</strong>te à une spécialité, celle d‟un gestionnaire du risque qui placerait la<br />
sécurité au c<strong>en</strong>tre <strong>des</strong> débats, ce qui peut favoriser le développem<strong>en</strong>t de solutions de résistance de type<br />
nécessairem<strong>en</strong>t très sécuritaire <strong>et</strong> très influ<strong>en</strong>te sur proj<strong>et</strong> urbain. En analysant l‟incivilité sociale par le<br />
biais d‟une id<strong>en</strong>tification à un risque sommairem<strong>en</strong>t défini par un rapport aléa/vulnérabilité, le « risque<br />
» est grand de désociabiliser la délinquance (ou tout au moins de l‟<strong>en</strong>visagée sous une forme très<br />
réductrice qui r<strong>en</strong>voie aux seuls faits). C<strong>et</strong>te approche du risque que l‟on qualifiera de très « naturaliste<br />
» pose un triple problème. La vulnérabilité n‟est conçue que par référ<strong>en</strong>ce à sa plus ou moins grande<br />
résistance à un aléa (soit ici la délinquance). Envisager sous c<strong>et</strong> angle la réponse att<strong>en</strong>due devi<strong>en</strong>t alors<br />
nécessairem<strong>en</strong>t d‟ordre technique, notamm<strong>en</strong>t <strong>en</strong> matière d‟aménagem<strong>en</strong>t, <strong>et</strong> d‟urbanisme. En r<strong>et</strong>our la<br />
<strong>prise</strong> <strong>en</strong> <strong>compte</strong> du « risque » devi<strong>en</strong>t un déterminant très puissant du proj<strong>et</strong> urbain <strong>et</strong> <strong>des</strong> formes<br />
d‟urbanisme <strong>et</strong> d‟architecture. Les <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>s conduits avec les concepteurs lyonnais actuellem<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
place montr<strong>en</strong>t, même s‟il peut être exprimée sous d‟autres <strong>et</strong> sous diverses formes, que le risque<br />
d‟une telle approche les inquiète <strong>et</strong> que dans tous les cas c<strong>et</strong>te approche n‟est pas conciliable avec<br />
leurs raisonnem<strong>en</strong>ts « l’approche de la prév<strong>en</strong>tion situationnelle <strong>et</strong> de la sûr<strong>et</strong>é devi<strong>en</strong>t l’obj<strong>et</strong> d’une<br />
question alors qu’elle est d’abord un obj<strong>et</strong> de questionnem<strong>en</strong>t ». Il serait très injuste de réduire à c<strong>et</strong>te<br />
124