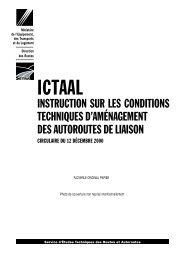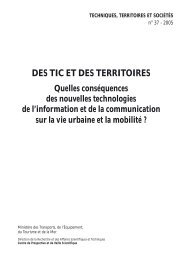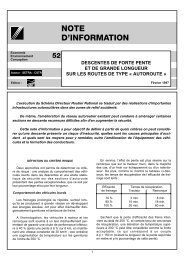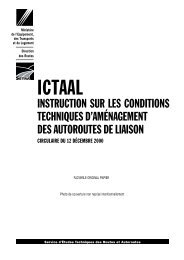Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
d<strong>en</strong>ses sur les communes de première voire de deuxième couronne <strong>des</strong> gran<strong>des</strong> agglomérations.<br />
Pourtant, s‟il n‟y a pas d‟équivoque possible sur le suj<strong>et</strong>, le grand <strong>en</strong>semble n‟a pas de définition<br />
juridique. Il ne désigne même pas un mode d‟édification, mais plutôt un paysage caractérisé par un<br />
regroupem<strong>en</strong>t de barres <strong>et</strong> de tours sur un espace limité. Il n‟est pas marqué historiquem<strong>en</strong>t, <strong>compte</strong><br />
t<strong>en</strong>u de son inexist<strong>en</strong>ce, si ce n‟est à partir de sa construction dans les années 1950. Ce terme n‟est pas<br />
connoté <strong>et</strong> nous apparaît plus neutre pour une analyse territoriale. Débarrassé de l‟<strong>en</strong>semble <strong>des</strong><br />
préjugés, nous le voyons, <strong>en</strong> premier lieu, comme une forme d‟habitat social dans laquelle évolue une<br />
population aux caractéristiques précises (statut socioprofessionnel, <strong>et</strong>hnie, <strong>et</strong>c.). Le grand <strong>en</strong>semble ne<br />
r<strong>en</strong>voie pas une notion de zonage, contrairem<strong>en</strong>t aux supports utilisés tels que la ZUP 222 ou la ZAC 223 .<br />
Mais il perm<strong>et</strong> toutefois une délimitation physique urbaine bi<strong>en</strong> définie sur laquelle se greffe une<br />
id<strong>en</strong>tité sociale <strong>des</strong> habitants. Ce concept de grand <strong>en</strong>semble nous semble donc être plus adapté, c‟est<br />
pourquoi nous l‟utiliserons tout au long de notre propos.<br />
Les travaux de recherche reli<strong>en</strong>t la question <strong>des</strong> grands <strong>en</strong>sembles à la question urbaine. Très tôt, <strong>des</strong><br />
interrogations ont été émises sur les conséqu<strong>en</strong>ces <strong>des</strong> structures architecturales <strong>et</strong> urbaines du grand<br />
<strong>en</strong>semble, sur les comportem<strong>en</strong>ts <strong>des</strong> habitants <strong>et</strong> sur la vie sociale qui s‟y déroule. La forme urbaine<br />
provoque <strong>des</strong> troubles ou <strong>des</strong> déséquilibres m<strong>en</strong>taux (George, 1963 224 ). Aujourd‟hui, on n‟attribue plus<br />
à l‟architecture <strong>et</strong> au gigantisme les névroses <strong>et</strong> les suici<strong>des</strong> mais les t<strong>en</strong>sions urbaines <strong>et</strong> la<br />
délinquance. Roncayolo 225 établit un li<strong>en</strong> direct <strong>en</strong>tre forme matérielle <strong>et</strong> li<strong>en</strong> social. Gidd<strong>en</strong>s 226 montre<br />
que le logem<strong>en</strong>t, tel qu‟il est réalisé, implique une certaine utilisation. C<strong>et</strong>te organisation spatiale n‟est<br />
pas neutre <strong>en</strong> matière de comportem<strong>en</strong>ts, de pratiques <strong>et</strong> d‟opinions.<br />
D‟autres recherches affirm<strong>en</strong>t, au contraire, que l‟urbanisation, même la plus austère, ne détermine<br />
pas, à elle seule, un mode de vie, <strong>et</strong> <strong>en</strong>core moins une organisation sociale unique. Pour Rey 227 , les<br />
problèmes que connaiss<strong>en</strong>t les grands <strong>en</strong>sembles ne provi<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t pas de leur construction mais de la<br />
conjonction de trois processus : la crise du logem<strong>en</strong>t social, le chômage d‟exclusion <strong>et</strong> l‟intégration<br />
<strong>des</strong> populations d‟origine étrangère. C<strong>et</strong>te thèse se vérifie par le développem<strong>en</strong>t historique <strong>des</strong> grands<br />
<strong>en</strong>sembles. En eff<strong>et</strong>, <strong>en</strong> période de crise économique, c‟est la population <strong>des</strong> grands <strong>en</strong>sembles qui est<br />
touchée majoritairem<strong>en</strong>t car elle comporte une proportion plus élevée, que la moy<strong>en</strong>ne nationale, de<br />
ménages dont la personne de référ<strong>en</strong>ce est ouvrier ou employé, <strong>et</strong> de personnes faiblem<strong>en</strong>t qualifiées.<br />
Et, pour être <strong>en</strong>tièrem<strong>en</strong>t posée, la question sociale doit aborder les processus id<strong>en</strong>titaires. Les<br />
premiers grands <strong>en</strong>sembles ont été bâtis pour abriter les plus pauvres dans l‟urg<strong>en</strong>ce. Pauvres <strong>et</strong> moins<br />
pauvres se côtoi<strong>en</strong>t ainsi que les travailleurs industriels v<strong>en</strong>us massivem<strong>en</strong>t <strong>en</strong> France. Un fort flux<br />
migratoire inonde <strong>et</strong> remplit les grands <strong>en</strong>sembles : Algéri<strong>en</strong>s, Marocains, Portugais, Mali<strong>en</strong>s,<br />
Sénégalais, Camerounais, Turcs (notamm<strong>en</strong>t Kur<strong>des</strong>) <strong>et</strong> Polonais… On constate donc une diversité<br />
culturelle <strong>et</strong> <strong>des</strong> croyances qui s‟accompagn<strong>en</strong>t souv<strong>en</strong>t de situations de précarité <strong>et</strong> de trajectoires<br />
d‟échec. Ainsi, le grand <strong>en</strong>semble se distingue <strong>des</strong> quartiers populaires traditionnels <strong>des</strong> années 1950-<br />
1960, régis par les mo<strong>des</strong> de vie <strong>et</strong> les valeurs du monde ouvrier. Mais il se distingue tout autant <strong>des</strong><br />
gh<strong>et</strong>tos qui, au s<strong>en</strong>s de l‟Ecole de Chicago, se caractéris<strong>en</strong>t à la fois par l‟unité de l‟origine <strong>et</strong>hnique <strong>et</strong><br />
par la diversité <strong>des</strong> métiers <strong>et</strong> <strong>des</strong> statuts sociaux. C<strong>et</strong>te définition, communém<strong>en</strong>t admise du<br />
« gh<strong>et</strong>to », ne semble donc pas adaptée à notre propos. Ainsi, la question sociale privilégie l‟étude <strong>des</strong><br />
grands <strong>en</strong>sembles par l‟<strong>en</strong>trée <strong>des</strong> habitants <strong>et</strong> le contexte économique, <strong>et</strong> non pas par celle du bâti.<br />
C‟est par ces approches urbaine <strong>et</strong> sociale qu‟on peut analyser la problématique de la sécurité dans le<br />
grand <strong>en</strong>semble. Nous verrons, dans notre développem<strong>en</strong>t, une évolution <strong>et</strong> une différ<strong>en</strong>ciation dans<br />
l‟emploi <strong>des</strong> termes pour qualifier les préoccupations sécuritaires : sécurité, s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t d‟insécurité,<br />
émeutes, viol<strong>en</strong>ces urbaines. Et, face à ces comportem<strong>en</strong>ts insécuritaires, nous constatons que<br />
différ<strong>en</strong>tes pratiques vont se m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong> place. Nous qualifierons donc de pratiques sécuritaires,<br />
l‟<strong>en</strong>semble <strong>des</strong> stratégies m<strong>en</strong>ées par les acteurs politiques (élus), sociaux (associations, groupes<br />
222<br />
ZUP : Zone à Urbaniser par Priorité.<br />
223<br />
ZAC : Zone d‟Aménagem<strong>en</strong>t Concerté.<br />
224<br />
GEORGE, P., 1963, Prés<strong>en</strong>t <strong>et</strong> av<strong>en</strong>ir <strong>des</strong> grands <strong>en</strong>sembles, Cahiers internationaux de sociologie, XXXV, p.25-42.<br />
225<br />
RONCAYOLO, M., 2001, La dim<strong>en</strong>sion historique, Mixité sociale <strong>et</strong> ségrégation : les réalités d‟hier <strong>et</strong> d‟aujourd‟hui <strong>et</strong><br />
les actions publiques, Habitat, N°29, p. 3-6.<br />
226<br />
GIDDENS, A., 1987, La constitution de la société, Paris, Presses Universitaires de France.<br />
227<br />
REY, H., 1996, La peur <strong>des</strong> banlieues, Presses de sci<strong>en</strong>ces Po.<br />
98