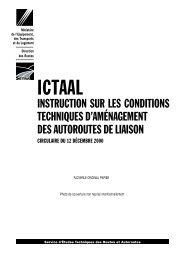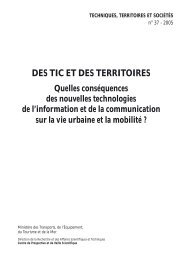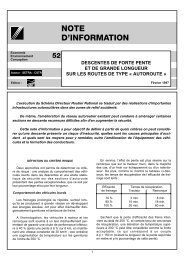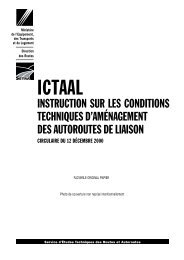Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
La sûr<strong>et</strong>é urbaine désigne donc tous les moy<strong>en</strong>s de réduire, prév<strong>en</strong>ir <strong>et</strong> contrôler les risques qui sont<br />
liés à la malveillance.<br />
« La sécurité ne désigne pas la malveillance mais elle désigne <strong>des</strong> risques qui sont propres au même<br />
d'un établissem<strong>en</strong>t ou d'une organisation. Ce sont <strong>des</strong> risques qui sont générés par le fonctionnem<strong>en</strong>t<br />
(sécurité inc<strong>en</strong>die, sécurité au travail, risque industriel sont dans le registre de la sécurité c'est-à-dire<br />
<strong>des</strong> risques qui sont provoqués par l'organisation ou l'établissem<strong>en</strong>t lui-même). La sûr<strong>et</strong>é r<strong>en</strong>voie à un<br />
type de risque qui sont les risques de malveillance int<strong>en</strong>tionnel » (d‟E Chalumeau, <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong> 2008). On<br />
ne s‟arrêtera pas ici sur les recoupem<strong>en</strong>ts avec la proposition de PUCA (même si certaines nuances<br />
mériterai<strong>en</strong>t d‟être faites), ni sur les justifications très intéressantes de l‟auteur du glissem<strong>en</strong>t d‟un<br />
terme vers l‟autres (E. Chalumeau, 2007, on y revi<strong>en</strong>dra dans un chapitre suivant). L‟un <strong>des</strong> intérêts de<br />
c<strong>et</strong>te définition est qu‟elle ouvre de nouvelles perspectives aux questionnem<strong>en</strong>ts <strong>en</strong> faisant référ<strong>en</strong>ce<br />
au terme risque. Elle marque <strong>en</strong> eff<strong>et</strong> un « mom<strong>en</strong>t » important dans l‟approche de la délinquance qui<br />
s‟est manifestée dans les années 90 (<strong>en</strong>viron 1995 « mom<strong>en</strong>t » sur lequel on revi<strong>en</strong>dra, là <strong>en</strong>core). La<br />
prév<strong>en</strong>tion de la délinquance considérée jusqu‟alors comme un fait de société suppose désormais une<br />
approche du « risque délinquance », de manière plus générale du risque sociétal. On notera <strong>en</strong> premier<br />
lieu que si les termes de sécurité <strong>et</strong> sûr<strong>et</strong>é sont distingués ils ne diffèr<strong>en</strong>t peut-être pas tant qu‟il y<br />
paraît puisqu‟ils sont tout deux associés à la notion de risque. Par ailleurs, l‟introduction du terme<br />
perm<strong>et</strong> de bénéficier de la réflexion <strong>en</strong>gagée sur ce thème depuis plusieurs années. Elle confirme<br />
l‟idée qu‟au-delà d‟un cons<strong>en</strong>sus de forme, les représ<strong>en</strong>tations vari<strong>en</strong>t beaucoup d‟un domaine de<br />
compét<strong>en</strong>ce à un autre <strong>et</strong> qu‟<strong>en</strong> la matière l‟interdisciplinarité ne va pas de soi. Sans explorer<br />
l‟<strong>en</strong>semble du champ <strong>des</strong> questionnem<strong>en</strong>ts sur ce thème on notera quelques pistes qui mérit<strong>en</strong>t<br />
analyse. Si l‟on se réfère par exemple à la définition dominante <strong>des</strong> risques la malveillance serait donc<br />
le produit d‟un aléa par la vulnérabilité (R = A x V), l‟aléa étant le malveillant <strong>et</strong> la vulnérabilité, ce<br />
terme trouble <strong>et</strong> <strong>en</strong>core mal (ou tout au moins très diversem<strong>en</strong>t) défini, associé aux <strong>en</strong>jeux. C<strong>et</strong>te<br />
définition n‟est pas sans poser de problème puisque si le risque est un « tout » elle r<strong>en</strong>voie pourtant à<br />
deux domaines de compét<strong>en</strong>ce distincts (celui de l‟aléa <strong>et</strong> celui de la vulnérabilité) ce qui, <strong>en</strong>tre autres,<br />
ne facilite pas le partage <strong>en</strong>tre <strong>des</strong> domaines aux cultures fort différ<strong>en</strong>tes. Dans tous les cas <strong>et</strong> quelle<br />
qu‟<strong>en</strong> soit la définition le risque r<strong>en</strong>voie à l‟idée d‟incertitude. En eff<strong>et</strong> si la catastrophe est avérée le<br />
risque est une pot<strong>en</strong>tialité. C‟est bi<strong>en</strong> là toute la difficulté qui s‟oppose aux gestionnaires <strong>et</strong> à tous ceux<br />
qui souhait<strong>en</strong>t réduire c<strong>et</strong>te incertitude. Le parallèle conduit <strong>en</strong>core à p<strong>en</strong>ser que gérer la sécurité c‟est<br />
donc, comme pour le risque, faire un scénario, c‟est r<strong>en</strong>dre visible l‟invisible. On compr<strong>en</strong>d <strong>en</strong> cela<br />
que la gestion de la sécurité <strong>et</strong>, <strong>en</strong>tre autres, la prév<strong>en</strong>tion situationnelle, ne possèd<strong>en</strong>t pas de rec<strong>et</strong>te<br />
miracle. En la matière les scénarii sont multiples <strong>et</strong> les formes dominantes qu‟ils pr<strong>en</strong>n<strong>en</strong>t dép<strong>en</strong>d<strong>en</strong>t<br />
beaucoup <strong>des</strong> acteurs qui les propos<strong>en</strong>t. On pr<strong>en</strong>dra alors le « risque » de considérer que comme le<br />
risque, la sécurité <strong>et</strong>/ou la sûr<strong>et</strong>é n‟exist<strong>en</strong>t pas <strong>en</strong> soi <strong>et</strong> qu‟elles sont avant tout le produit d‟une<br />
représ<strong>en</strong>tation, celles <strong>des</strong> populations à l‟évid<strong>en</strong>ce mais aussi celles <strong>des</strong> « dits » acteurs. L‟analyse <strong>des</strong><br />
représ<strong>en</strong>tations <strong>en</strong> cours <strong>et</strong> de leur construction, voire de leur instrum<strong>en</strong>talisation, n‟est <strong>en</strong> ce s<strong>en</strong>s pas<br />
sans intérêt. La délinquance n‟étant plus considérée comme un fait de société mais comme un risque,<br />
son approche pourrait être suj<strong>et</strong>te à <strong>des</strong> dérives bi<strong>en</strong> connues dans l‟approche <strong>des</strong> risques de types<br />
fonctionnaliste <strong>et</strong> normative <strong>et</strong> plus ou moins sectorielles. En outre alors que la question de la sécurité<br />
devrait être intégrée au proj<strong>et</strong> urbain, elle risque de dev<strong>en</strong>ir (elle est déjà dev<strong>en</strong>ue ?) une question <strong>en</strong><br />
soit, un « obj<strong>et</strong> » parmi tant d‟autres. Ainsi ces dérives <strong>et</strong> le cloisonnem<strong>en</strong>t disciplinaire <strong>des</strong> approches<br />
peuv<strong>en</strong>t redonner à la notion de sûr<strong>et</strong>é une valeur d‟obj<strong>et</strong> que le cons<strong>en</strong>sus sur sa dim<strong>en</strong>sion<br />
protéiforme visait à effacer (voir définition PUCA). Ne peut-on pas distinguer la t<strong>en</strong>tation de réduire à<br />
un obj<strong>et</strong> le concept de sûr<strong>et</strong>é dans certains proj<strong>et</strong>s de concepteurs (architectes, urbanistes, paysagistes,<br />
<strong>et</strong>c..), n‟est ce pas une crainte souv<strong>en</strong>t évoquée face aux pratiques spécifique <strong>des</strong> gestionnaires de la<br />
sécurité aujourd‟hui acteur aussi de la sûr<strong>et</strong>é? Le manque de partage dans la définition de la prév<strong>en</strong>tion<br />
situationnelle (voir thème suivant) à la française mais aussi chez les anglo-saxons (<strong>en</strong>tre gestionnaires<br />
de la sécurité <strong>et</strong> concepteurs) <strong>en</strong> est il pas une autre traduction ?<br />
La question fait déjà débat.<br />
Ces premiers constats sur une <strong>des</strong> formes de « la situation actuelle, voire réelle », montr<strong>en</strong>t l‟intérêt<br />
d‟un état <strong>des</strong> lieux <strong>en</strong> la question. A l‟évid<strong>en</strong>ce au delà du discours conv<strong>en</strong>u <strong>des</strong> acteurs sur les<br />
concepts l‟appropriation qui <strong>en</strong> est faite est très influ<strong>en</strong>cée (<strong>en</strong>tre autres) par <strong>des</strong> logiques internes<br />
(pratique, logique d‟action, <strong>et</strong>c..), <strong>des</strong> « cultures » très différ<strong>en</strong>tes. Ces logiques internes constitu<strong>en</strong>t<br />
souv<strong>en</strong>t, par ailleurs, un rempart <strong>en</strong>tre le discours <strong>des</strong> « élites » sur le concept <strong>et</strong> le s<strong>en</strong>tim<strong>en</strong>t <strong>des</strong><br />
9