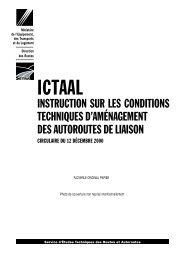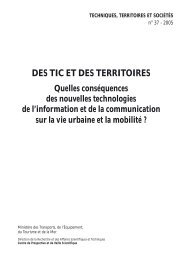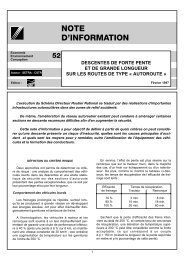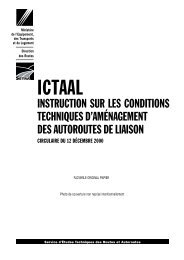Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Grands aménagements urbains et prise en compte des ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
dim<strong>en</strong>sion déterministe, <strong>et</strong> de manière univoque l‟approche, <strong>des</strong> gestionnaires du risque lyonnais.<br />
Dans les différ<strong>en</strong>ts <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>s conduits avec eux leur volonté de ne pas contraindre le proj<strong>et</strong> urbain a<br />
été constamm<strong>en</strong>t réaffirmée « le but de la 3CPS est que les maîtres d’ouvrages fass<strong>en</strong>t <strong>des</strong> choix <strong>en</strong><br />
connaissance de cause (sachant que les choix de conception ont <strong>des</strong> conséqu<strong>en</strong>ces sur les mo<strong>des</strong> de<br />
fonctionnem<strong>en</strong>t) tout <strong>en</strong> conservant leur liberté, <strong>et</strong> que les gestionnaires soi<strong>en</strong>t au courant de ces choix<br />
afin d’<strong>en</strong>visager les moy<strong>en</strong>s de gestion ». Une position cep<strong>en</strong>dant difficile à vivre <strong>et</strong> à m<strong>et</strong>tre <strong>en</strong><br />
pratique car « contrie » <strong>en</strong>tre leurs souhaits <strong>et</strong> leur fonction <strong>et</strong> leur formation qui conduit aussi l‟un<br />
d‟eux à déclarer qu‟<strong>en</strong> référ<strong>en</strong>ce aux questions de sûr<strong>et</strong>é « Il faut noter que, lors de l’élaboration d’un<br />
proj<strong>et</strong> on a trois types de risques dits « <strong>en</strong>courus » : le risque lié à la nature du proj<strong>et</strong>, le risque lié à<br />
l’<strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t du proj<strong>et</strong>, le risque lié à la conception <strong>et</strong> à la gestion ». Dans tous les cas, chez les<br />
concepteurs les diverg<strong>en</strong>ces d‟analyse exprimées avec celles <strong>des</strong> gestionnaires du risque, vari<strong>en</strong>t <strong>en</strong><br />
fonction de la conception plus ou moins changeante d‟un concepteur à un autre, de l‟aménagem<strong>en</strong>t<br />
urbain. En cela, le cas lyonnais est assez représ<strong>en</strong>tatif <strong>des</strong> débats sur la question <strong>en</strong> France. S‟il est un<br />
point sur lequel les concepteurs se rejoign<strong>en</strong>t c‟est que « la prév<strong>en</strong>tion situationnelle est surtout (voire<br />
pour certain au mieux) un mode de questionnem<strong>en</strong>t qu'on doit (pour certains là <strong>en</strong>core ce n‟est pas<br />
systématique) poser sur les proj<strong>et</strong>s <strong>et</strong> pas un suj<strong>et</strong> à traiter <strong>en</strong> soit » (<strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>).<br />
Pour résumer, là <strong>en</strong>core de manière simpliste la diversité <strong>des</strong> discours, la sûr<strong>et</strong>é n‟est donc pas du seul<br />
domaine <strong>des</strong> gestionnaires. Au-delà de ce point commun les positions diverg<strong>en</strong>t <strong>en</strong>tre urbanistes, <strong>en</strong>tre<br />
architectes, <strong>en</strong>tre les deux corps de métier parfois. On peut distinguer trois postures assez classiques.<br />
Les concepteurs qui adhèr<strong>en</strong>t à un certains fonctionnalisme urbain <strong>et</strong> qui se situ<strong>en</strong>t parmi les<br />
urbanistes <strong>et</strong> architectes qui considèr<strong>en</strong>t que la prév<strong>en</strong>tion situationnelle est tout d‟abord une question<br />
liée à l‟aménagem<strong>en</strong>t urbain. C<strong>et</strong>te posture r<strong>en</strong>voie globalem<strong>en</strong>t à la notion « d‟espace déf<strong>en</strong>dable »<br />
empruntée à la terminologie nord-américaine (« def<strong>en</strong>sible space ») <strong>et</strong> qui repose sur le principe (le<br />
postulat ?) selon lequel il est <strong>des</strong> types d‟espace construits propices aux actes délictueux “une<br />
meilleure conception de notre <strong>en</strong>vironnem<strong>en</strong>t architectural ” doit perm<strong>et</strong>tre de “ prév<strong>en</strong>ir la<br />
criminalité ” (Newman O., 1973).<br />
C<strong>et</strong>te approche qui relativise le rôle <strong>et</strong> l‟analyse <strong>des</strong> gestionnaires du risque <strong>en</strong> est cep<strong>en</strong>dant la moins<br />
éloignée. En ce s<strong>en</strong>s elle est par ses fondem<strong>en</strong>ts relativem<strong>en</strong>t assimilables aux approches technici<strong>en</strong>nes<br />
de la gestion du risque. Tout comme on peut lutter contre l‟inondation par l‟ouvrage <strong>et</strong> une certaine<br />
conception de l‟espace on peut « résister » se protéger d‟un autre fléau, ici social, la délinquance. Tout<br />
comme il faut aménager l‟espace pour se prémunir <strong>des</strong> « risques naturels » il faut « aménager<br />
l’espace, les lieux pour prév<strong>en</strong>ir la délinquance ». La question de la sûr<strong>et</strong>é/sécurité devi<strong>en</strong>t donc une<br />
question c<strong>en</strong>trale dans le proj<strong>et</strong> urbain. Si c<strong>et</strong>te approche recoupe une partie du discours politique <strong>et</strong><br />
<strong>des</strong> gestionnaires de la sécurité <strong>en</strong> adhérant fortem<strong>en</strong>t à la prév<strong>en</strong>tion situationnelle, elle n‟<strong>en</strong> reste pas<br />
moins indép<strong>en</strong>dante au s<strong>en</strong>s où les intéressés souhait<strong>en</strong>t être une force de propositions bénéficiant d‟un<br />
accompagnem<strong>en</strong>t plutôt que d‟un contrôle contraignant à la réalisation de leur proj<strong>et</strong>. Pour d‟autres,<br />
les proj<strong>et</strong>s doiv<strong>en</strong>t <strong>en</strong>visager les questions de sécurité mais comme une question parmi tant d‟autres.<br />
La sûr<strong>et</strong>é est ici <strong>en</strong>visagée au c<strong>en</strong>tre d‟un débat beaucoup plus général qu‟ils distingu<strong>en</strong>t d‟une<br />
approche gestionnaire dont le soucis, selon eux, est de tranquilliser l‟espace <strong>en</strong> <strong>en</strong> faisant un critère<br />
ess<strong>en</strong>tiel « d‟une qualité de vie », <strong>en</strong> milieu urbain. C<strong>et</strong>te opposition de fond traduit un rapport à<br />
l‟espace <strong>et</strong> plus généralem<strong>en</strong>t au territoire différ<strong>en</strong>cié « il convi<strong>en</strong>t d’arrêter de raisonner la ville <strong>en</strong><br />
terme de spatialisme linéaire déterministe où c'est l'espace qui construit <strong>des</strong> phénomènes sociaux ».<br />
C<strong>et</strong>te analyse avancée par un concepteur lyonnais, dans les années 1980, ne vise pas à l‟origine les<br />
gestionnaires du risque mais les pratiques antérieurs <strong>des</strong> urbanistes (notamm<strong>en</strong>t celles <strong>des</strong> années<br />
1970), voire celle <strong>en</strong> cours précédemm<strong>en</strong>t citées (parfois résumé à un urbanisme d‟ingénieur). Elle<br />
s‟oppos<strong>en</strong>t donc à un certain urbanisme <strong>et</strong> logiquem<strong>en</strong>t aux approches gestionnaires de la sûr<strong>et</strong>é<br />
urbaine qui sont résumés à l‟analyse « d’un espace sur lequel on id<strong>en</strong>tifie <strong>des</strong> problèmes <strong>et</strong> on t<strong>en</strong>te<br />
d’y apporter <strong>des</strong> solutions », soit ou l‟on « détermine » spatialem<strong>en</strong>t une réponse à <strong>des</strong> risques<br />
id<strong>en</strong>tifiés. Ainsi dans sa forme la plus ambitieuse le proj<strong>et</strong> <strong>des</strong> concepteurs tel qu‟il apparaît ici dans<br />
les <strong>en</strong>tr<strong>et</strong>i<strong>en</strong>s accordés par les concepteurs (notamm<strong>en</strong>t parmi ceux de fortes responsabilités) se situe<br />
lui dans un proj<strong>et</strong> politique <strong>en</strong> référ<strong>en</strong>ce aux constructions sociales, un proj<strong>et</strong> de société voire un «<br />
proj<strong>et</strong> social». C<strong>et</strong>te ambition qui situe le proj<strong>et</strong> dans « l‟expéri<strong>en</strong>ce sociale » est donc peu conciliable<br />
avec l‟idée de contrôle <strong>et</strong> qui plus est de celle d‟une gestion du risque. Ainsi, comme le<br />
125