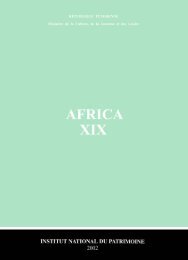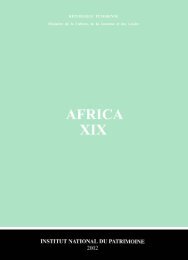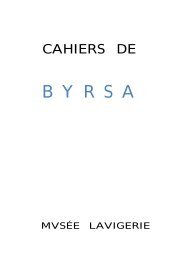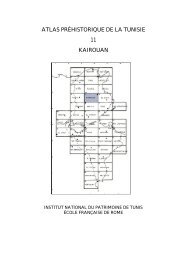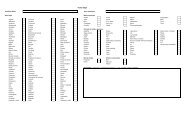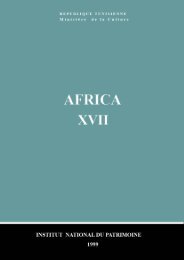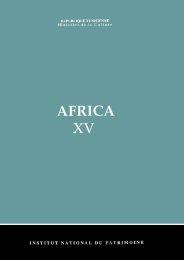africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
africa - Institut National du Patrimoine
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Africa XIII/L'Etat économique de l'Afrique byzantine d'après les récits des chroniqueurs arabes Abdelatif MRABET<br />
cinquième pour l'Etat donna 1000 dinars au fantassin et 3000 au cavalier soit 2000 pour<br />
la monture et 1000 pour son maître (10) .<br />
- En 665-666, Muawiya ibn Hùdayj prend la ville de Djalula (Cululis) et la met à sac;<br />
après prélèvement <strong>du</strong> quint habituel, le partage <strong>du</strong> butin donne 200 dinars au fantassin<br />
et 300 au cavalier (11) .-<br />
- En 682 Oqba b. Nafe', de retour en Ifriqiya destitue son prédécesseur Dinar ibn Abu-1-<br />
Muhajir et s'empare <strong>du</strong> trésor que celui-ci avait accumulé soit 100.000 dinars or (12) .<br />
- En 696-697 Hassan b. No'man quitte l'Ifriqya avec 80.000 dinars or (13) .<br />
- Entre 710 et 715, Busr ibn Arta occupe Majdjana et y fait un important butin dont il<br />
envoya le quint au gouverneur Musa b. Nusayr lequel à son tour en envoie une part<br />
(1/5) au calife Al-Walid ; selon Ar-Raqiq (14) ; la somme qui ainsi parvint à Damas fut<br />
de 20.000 dinars.<br />
Incontestablement, si l'on en juge d'après ces chiffres, au VIIème. siècle,<br />
d'importantes quantités d'or monnayé avaient ainsi quitté l'Afrique <strong>du</strong> Nord en<br />
direction de l'Orient ; les Arabes qui n'avaient pas encore leur propre<br />
monnayage (15) appréciaient d'autant les solidi byzantins d'Afrique qu'ils les trouvaient<br />
de très bon aloi ; Ibn Abd al-Hakam rapporte qu'un dinar <strong>africa</strong>in valait alors un<br />
dinar un quart égyptien (l6) .<br />
Cependant, notre jugement, pris en fonction de données chiffrées incontrôlables, peut<br />
paraître aléatoire, sinon aventureux ; il est vrai, qu'après coup, dans leur souci de<br />
vouloir magnifier l'action de l'Islam, les chroniqueurs arabes de la conquête pouvaient<br />
succomber à la tentation de l'exagération ; en matière de chiffres, on le sait, les<br />
glissements sont fréquents, voires même faciles (17) . En l'espèce, le chiffre qui ne fait<br />
pas unanimité est celui des 300 qintar préten<strong>du</strong>ment obtenus par Abdallah b. Saad<br />
après sa victoire sur le Patrice Grégoire ; le doute est d'autant plus fort que les<br />
chroniqueurs eux-mêmes semblent diverger sur le montant exact de la rançon accordée<br />
aux Arabes (18) . Néanmoins, comparé à d'autre données monétaires de l'antiquité<br />
(10) Ces chiffres contestés par De Slane (Histoire des Berbères, tome I, p. 305) sont invariablement rapportés par tous<br />
les chroniqueurs arabes.<br />
(11) Ibn Abd al-Hakam, "Conquête...", p. 59. An-Nuwaïri donne 300 dinars pour le clavier ; voir "Histoire des<br />
Berbères...", p..326.<br />
(12) Al-Maliki (Riadh an-noufous) d'après Caudel : "les premières invasions...", p.119. Ibid, dans Idris : "Le récit<br />
d'Al-Maliki...",p. 136. Nous ne retenons pas l'information donnée par le seul Al-Waqidi au sujet d'une<br />
invraisemblable conquête de la "Mualliqa" par oqba. Cet auteur précise qu'à l'issue de cette prise de Carthage, le<br />
butin monétaire, partagé entre les combattants, donna 20.000 dinars au cavalier et 10.000 au fantassin. Voir<br />
Al-Waqidi : "Futuh Ifriqiya", éd AT- Tidjani Mohammedi, Tunis, 1966, tome 1, p. 134.<br />
(13) Ibid, p. 175.<br />
(14) Abu Ishaq Ibrahim ibn al-Qasim al-Raqiq : "Tarikh ifriqiya wal-Maghreb", éd A. A. Al-Zaidane et E.O Mussa,<br />
Dar al-Gharb al-Islami, Beyrouth, 1990,p. 40.<br />
(15) D'après Miles G.C. " le plus ancien spécimen de dinar arabe, non daté, mais que l'on peut faire remonter<br />
approximativement à l'année 72/691-2 et qui a été probablement frappé à Damas, imite le soli<strong>du</strong>s d'Héraclius et de<br />
ses deux fils", Encyclopédie de l'Islam, II, 1977, p. 305.<br />
(16) Ibn Abd al-Hakam, "conquête...", p 45.<br />
(17) Comme le dit si bien Talbi M. "Les récits de la conquête très tardivement fixés selon trois traditions initialement<br />
enchevêtrées ne sont qu'une belle geste bien héroïque. Vouloir en tirer des chiffres précis, qu'ils offrent d'ailleurs,<br />
revient à considérer comme document d'archivé la chanson de Roland". Talbi M. : L'émirat aghlabide, histoire<br />
politique, 184-296 / 800-909", maisonneuve, Paris, 1966, p.23.<br />
(18) C'est le cas d'Al-Maliki qui, tout en mentionnant le chiffre de 300 qintar fait état d'une tradition selon laquelle<br />
Abdallah b. Saad aurait reçu seulement 100 qintar d'or, aussi Ibn Naji, dans ses "Maalem el Iman fi maarifat ahl<br />
al-Qaïrawan", donne le chiffre de 300 qintar mais, précise-t-il, cela fait 1.500 000 dinars ; cette somme est<br />
également donnée Par. Ibn al-Athir dans son " Al-Kamil"... Pour ces trois auteurs, voir Caudel M. dans "Les<br />
premières invasions", p.72 et p.74. An-Nuwaïri dans sa "Nihayat"... donne le chiffre de 2.500 000; voir Histoire des<br />
Berbères", Ibn Khal<strong>du</strong>n, trad De Slane, p. 322.<br />
Abu-1-Mahasseen, dans ses "Noudjoum", tome 1 p. 89, avance le chiffre de 2.520 000, ce qui en poids, même si<br />
l'ontient compte de l'effet <strong>du</strong> frais, dépasse les 300 qintar.<br />
Par contre, Ibn A'tham, contemporain de Tabari et auteur d'une chronique qui couvre la période des quatre premiers<br />
califes jusqu'à la mort de Husaïn, est le seul à donner le chiffre atypique de 520 000 pièces or, montant, dit-il,<br />
125